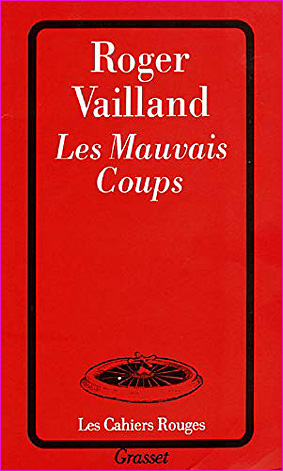
Le dandy libertin alcoolique né en 1907 raconte sous forme de roman une histoire proche de la sienne. Milan, au nom d’oiseau de proie, est marié avec Roberte, femme faussement libre et en manque d’excitation. Tous deux approchent la quarantaine, ce mitan de la vie. Ils se sont aimés, ils ne s’aiment plus ; ils se sont habitués l’un à l’autre, ils s’agacent d’être ensemble. L’amour-passion est une vaste blague, que les conditions économiques et sociales d’après-guerre condamnent irrémédiablement. Il s’agit désormais d’être camarades de travail dans le couple, comme les paysans Radiguet, pas de rêver à l’impossible.
Pour Vailland, résistant attiré alors par le communisme (il quittera le parti après la révolte hongroise de 1956 matée dans le sang par la brutalité soviétique), la condition de la femme est déterminée. Les structures masculines de la société les enferment et elles doivent s’y insérer, avec ruse, obstination, mensonge. « Je sais ce qu’il en coûte d’être ta femme, dit Roberte à Milan. Il m’a bien fallu abdiquer tout amour-propre. Pour vivre auprès de toi, il faut apprendre les vertus chrétiennes, l’humilité et la soumission » p.140 (pagination Livre de poche 1961). De celles qu’on enseigne à coups de schlague sur le torse des garçons et à coups de pied dans le ventre des filles chez les cathos Betharam. En contrepartie, pour assurer sa possession, la femme use d’artifices envers son homme : « C’est, pensa-t-il, la malhonnêteté de Roberte que d’avoir utilisé les nœuds, les replis, les ombres, les sueurs, les paniques, les hontes, tout ce qui d’une enfance opprimée subsiste de louche en un homme, pour entrer en possession de moi » p.144.
Dans le village du Bugey où le couple a décidé de passer une année entière, ils miment les attitudes de la passion devant les autres. En fait, ils se détestent, Roberte noie cela dans le marc et le jeu à la roulette à Aix-les-Bains ; Milan dans la chasse aux oiseaux et dans le flirt avec Hélène, la jeune institutrice de pas encore 20 ans qui les admire. Le mariage ? Un leurre et une apparence : « les mœurs de notre temps ne sont pas encore réformées, (…) la plupart des femmes se font honneur d’avoir leur homme, comme les gentilshommes de faire la preuve de leurs quartiers de noblesse ; c’est leur seule gloire et de le perdre la plus grande défaite qu’elles puissent éprouver » p.161. On est loin de l’amour-plaisir, du désir de l’autre assouvi ici ou là selon les besoins et les occasions. « Mais elle est la fille d’une prostituée, elle a été élevée par un homme qui ne considérait dans ses amies que sa commodité, elle a appris dès l’enfance que l’inégalité de la femme ne peut être compensée que par les artifices et les illusions de l’amour » p.162.
La passion est une emprise, on est – volontairement – « la chose » de quelqu’un. Mais cela ne dure pas. Ce ne sont pas les sens qui lient, mais le caractère. C’est l’appétit de bonheur qui prouve l’homme de cœur ; il ne subit pas la passion, il fait son destin en gardant la tête froide sous les sens allumés. « La passion, écrit Roger Vailland, offre au faible l’illusion de la violence, au solitaire le fait croire qu’il est mêlé à quelque chose, à l’impuissant qu’il agit. A ce titre, elle s’apparente à la religion. L’amour fou est une autre version de l’amour de Dieu » p.166. Cet « amour » est l’opium du peuple soumis, l’alcool de Roberte qui dépend pour tout de Milan, pour l’argent (elle ne travaille pas), pour l’affection (elle est terriblement jalouse), pour sa flamme (elle a besoin d’eau-de-vie, de jeu, de baise). Roberte est devenue pour Milan un oiseau de proie qui l’enserre, lui fait peur. Elle a des yeux de hibou, des mandibules acérées, l’air d’un corbeau noir et croassant.
Il en massacre un et lui apporte, alors qu’elle maquille Hélène pour la rendre séduisante – et avoir une raison de la jalouser. Milan refuse le « cadeau » de chair offerte, le sein qui sort de la bretelle trop lâche. Roberte va se saouler, prend la voiture et va se tuer.
Pour son second roman, Roger Vailland règle ses comptes avec l’amour – l’Hâmour, écrivait Flaubert pour railler son enflure. C’est un esclavage, une emprise, une soumission volontaire.
Roger Vailland, Les mauvais coups, 1948, Grasset poche Les cahiers rouges 1991, 266 pages, €7,95, e-book Kindle €5,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

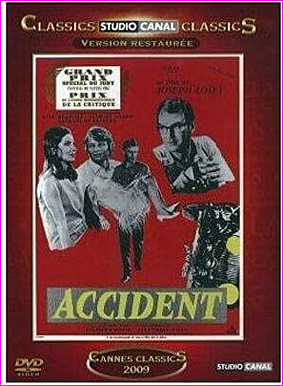
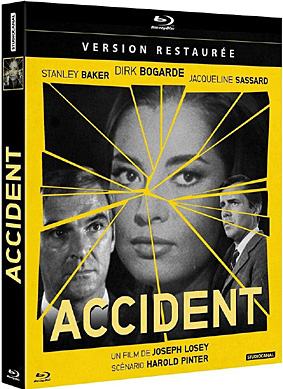




















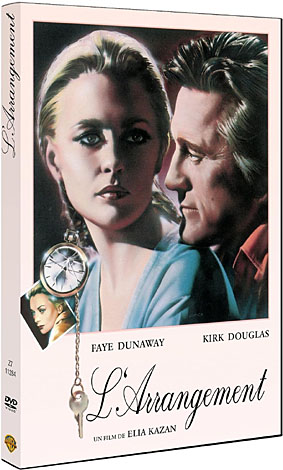









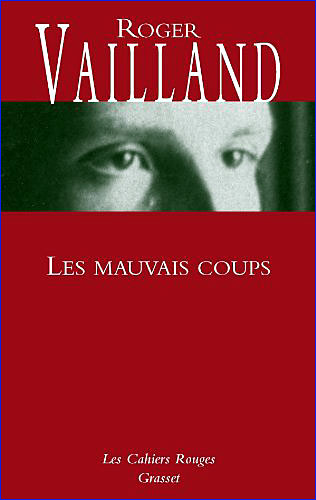





Commentaires récents