Encore une rencontre dans la montagne, décidément il y a foule ! Mais ce sera la dernière, cette fois il s’agit de « l’ombre » de Zarathoustra, celle qui ne le quitte pas d’un pouce. Elle est son double, mais sombre ; sa part malheureuse qui s’anémie à mesure du vagabondage.
« Je suis un voyageur, depuis longtemps attaché à tes talons ; toujours en route, mais sans but et sans foyer : en sorte qu’il ne me manque que peu de chose pour être le Juif errant, hors que je ne suis ni juif, ni éternel. » Vaguer va bien, c’est de la légitime curiosité. Mais vaguer sans but et sans foyer va mal, car c’est errer sans fin. Ainsi le voyageur va s’excentrer pour mieux se retrouver soi, pas pour se dissoudre ni se perdre. Ainsi va le bambin explorer les alentours, sûr de sa mère pas loin et de son père qui veille – mais le bambin qui va sans but se perd définitivement, on retrouve ses ossements au bas d’une pente, comme récemment le petit Émile de 2 ans et demi que son grand-père n’a pas su surveiller.

Tout tenter, tout explorer, c’est humain – mais pas sans but. Sinon, rien ne vaut plus, tout vaut tout, tout est égal : il s’agit du nihilisme. Les valeurs se séparent des faits et récusent toute hiérarchie. On devient amoral (sans morale), sceptique (qui doute perpétuellement de tout et se défie de tous) et relativiste (tout dépend). « Avec toi j’ai aspiré à tout ce qu’il y a de défendu, de plus mauvais et de plus lointain ; et si je possède quelque vertu, c’est de n’avoir jamais redouté aucune défense. Avec toi j’ai brisé ce que jamais mon cœur a adoré, j’ai renversé toutes les bornes et toutes les images, j’ai pourchassé les désirs les plus dangereux – en vérité, j’ai passé une fois sur tous les crimes », dit son ombre à Zarathoustra. Les Démons – possédés – de Dostoïevski constatent la perte de la foi et l’impuissance de la justice humaine à éradiquer le Mal.
C’est l’absurde négatif de Schopenhauer, contre lequel Nietzsche s’insurge, l’absurde aussi de Camus, « cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », mais qu’il rendra positif par le « il faut imaginer Sisyphe heureux ». L’ombre de Zarathoustra : « Avec toi j’ai perdu la foi en les mots, les valeurs consacrées et les grands noms. (…) Rien n’est vrai tout est permis ». Dostoïevski dans Les Frères Karamazov : « si Dieu n’existe pas, tout est permis ». Et l’ombre de Zarathoustra de regretter le bon vieux temps de « cette innocence mensongère que je possédais jadis, l’innocence des bons et de leurs nobles mensonges ! » La foi du charbonnier évite de penser, elle dicte sa conduite et rassure. Le sceptique est bien seul et s’angoisse, souvent pas assez fort pour le supporter. Pourtant, tel est le prix de la liberté.
« Ai-je encore un but ? un port vers lequel diriger ma voile ? un bon vent ? Hélas ! celui-là seul qui sait où il va, sait aussi qu’elle est pour lui le bon vent, le vent propice. » Justement, savoir où l’on va est le plus dur : le nihiliste ne le sait pas car, pour lui, tout vaut tout, et pourquoi aller ici plutôt qu’ailleurs ? L’existence (agir, souffrir, vouloir, sentir) n’a aucun sens. Pour Heidegger, le nihilisme est « l’oubli de l’être ». C’est un nihilisme passif qui fait se demander comme l’ombre : « Où est ma demeure ? C’est d’elle que je m’enquiers, c’est elle que je cherche, que j’ai cherchée, que je n’ai pas trouvée. »
Le risque est que, désorienté et éperdu de solitude, l’être cherche n’importe quelle demeure pour sa chaleur, ses murs rassurants. « Des vagabonds comme toi finissent par se sentir heureux, dit Zarathoustra à son ombre, même dans une prison. As-tu jamais vu comment dorme les criminels en prison ? Ils dorment en paix, ils jouissent de leur sécurité nouvelle. Prends garde qu’une foi étroite ne finissent par s’emparer de toi, une illusion dure et sévère ! Car tout ce qui est étroit et solide te séduira et te tentera désormais . » Ainsi le nihilisme commun conduit-il le plus souvent à la foi extrémiste la plus bornée, par exemple le communisme soviétique ou le fascisme nazi – ces fois qui allaient surgir un tiers de siècle après Nietzsche sur les décombres de la mort de Dieu. Est-ce pour cela qu’il faut préférer en revenir à Dieu, au c’était mieux avant ? Ou se livrer à un gourou à grande gueule comme Trump ou Mélenchon, dont le seul talent est « d’avoir l’air » énergique ?
Non pas, dit Nietzsche. Et Zarathoustra son prophète invite son ombre à venir avec lui et les autres dans sa caverne. Pour lui, le nihilisme est bienfaisant s’il est actif. Les illusions et les croyances s’effondrent parce que dépassées. Le fort en puissance vitale, en « volonté vers » la puissance, effectue sa mue. Il abandonne les valeurs toutes faites, conventionnelles, jamais remises en cause par tabou social – pour en adopter de nouvelles, à sa mesure. Il met ses propres tables de la loi au-dessus de sa tête, et pas celle de la tradition ni du dogme. Avec pour mesure l’éternel retour, c’est-à-dire le jugement des actions analogue au karma bouddhiste. Autrement dit, ce que je fais me reviendra éternellement : ai-je raison de le faire ? Ne vais-je pas le regretter ou en pâtir ? Cette façon utilitariste de penser les conséquences de ses actes, plutôt que de les mesurer à un dogme abstrait préétabli, est ce qui distingue Nietzsche de Platon. Pour Nietzsche, pas de « ciel des Idées », où elles disent éternellement « le » Bien et « le » Mal dans l’absolu, mais des actes concrets ici et maintenant, avec leurs suites bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles.
Zarathoustra a failli devenir l’ombre de lui-même par sa négation de toutes les valeurs – son nihilisme. Mais il surmonte ce négatif par le positif du vital qu’il sent en lui comme en tout être vivant : aller de l’avant, explorer, conquérir sa liberté pour vivre, mieux vivre, vivre plus fort. La force de vivre dans un monde où il n’y a plus de fondements. Avec les autres, qui attendent dans sa caverne.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

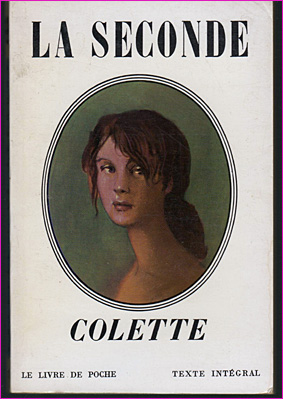



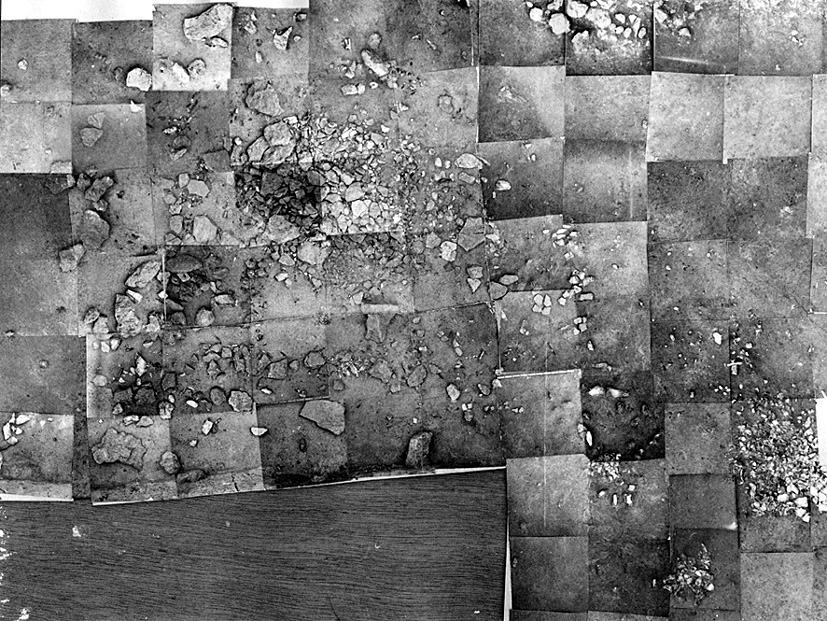
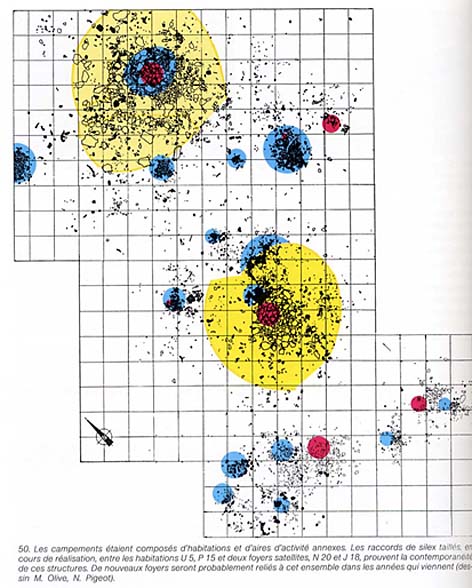
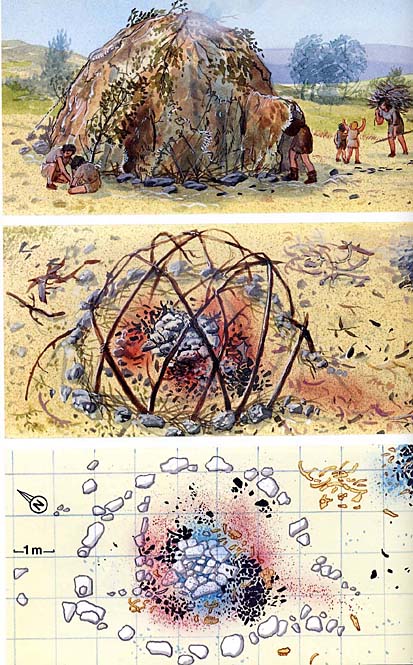


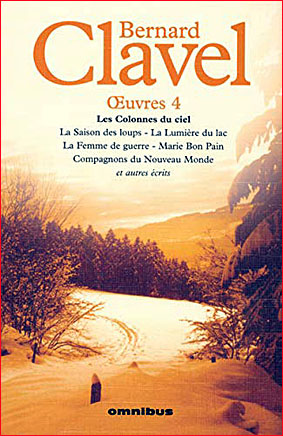












































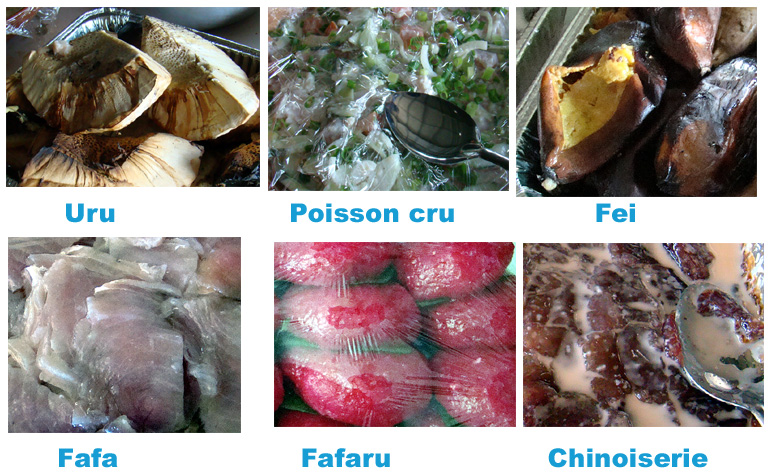



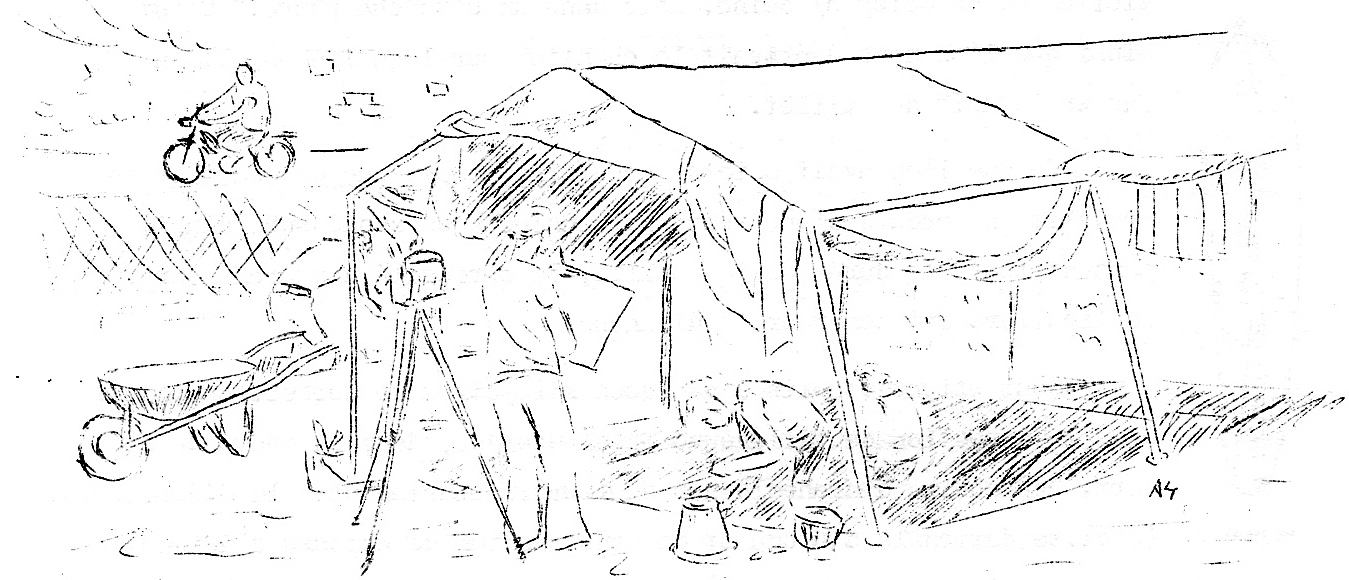

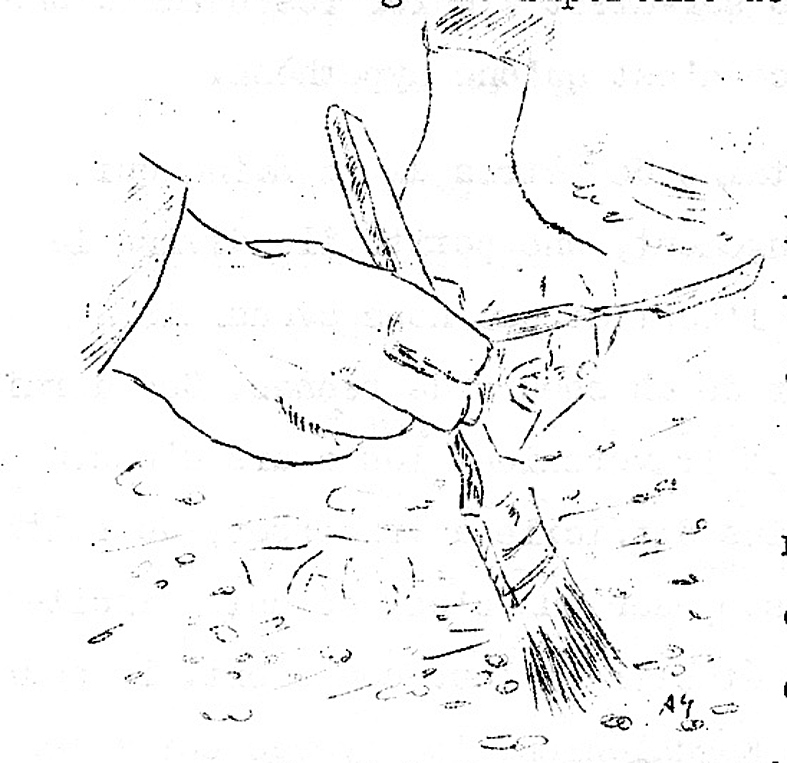




Commentaires récents