C’est une biographie en grande pompe que nous offre Philippe Soulier : 646 pages denses et de multiples notes. Il n’en fallait pas moins pour ce monstre sacré de l’ethnologie préhistorique française que ses étudiants et ses collaborateurs appelaient familièrement « Patron ». Il devient docteur ès lettres en 1944 sur l’archéologie du Pacifique Nord et docteur ès sciences en 1954 sur les traces d’équilibres mécaniques du crâne des vertébrés terrestres – après avoir quitté l’école à 14 ans. Il parle russe, chinois et japonais en plus des langues européennes. Nommé au Collège de France en 1969 et médaille d’or du CNRS en 1973, André Leroi-Gourhan a refondé la préhistoire française en homme de terrain avant d’être théoricien.
Vous allez lire une biographie intellectuelle, pas la « vie » d’un individu. Au détour d’une phrase, on apprend que le jeune Leroi, qui a accolé le nom de sa mère Gourhan pour avoir été élevé principalement par ses grands-parents maternels, s’est marié avec Arlette – mais cette dernière a assisté son mari et est devenue palynologue reconnue en étudiant les pollens fossiles. On apprend aussi que le couple a eu quatre enfants, mais on ne sait rien d’eux, sinon qu’un fils, Christian, jouait de la bombarde pour réveiller les fouilleurs de Pincevent.
Pour le reste, le dépouillement des œuvres, articles, rapports, cours et archives personnelles est une performance. Il a fallu plus de deux ans de travail pour ce faire, d’où l’abondance des références. Le processus de pensée de Leroi-Gourhan est approché pas à pas, au plus près du contexte, et son évolution démontrée en regard des éléments matériels. André Leroi-Gourhan n’est pas structuraliste comme son collègue Lévi-Strauss, il ne part pas d’un concept intellectuel pour tenter de le prouver dans la réalité. Il part au contraire des faits, qu’il essaye de décrire le plus complètement et le plus objectivement possible, avant de réfléchir aux éventuelles « structures » qui peuvent faire sens (mais aussi être interprétées différemment dans le futur).
Ainsi de l’art pariétal, les peintures sous grottes n’étant pas assemblées au hasard et pouvant faire l’objet d’une explication symbolique en analysant l’organisation de l’espace figuré, plus élaborée que leur simple description artistique.
Ainsi de la fouille : dans l’habitation n°1 de Pincevent, des « structures de combustion » (vocabulaire archéologique descriptif) peuvent devenir des « foyers » (vocabulaire ethnologique appliqué en préhistoire) lorsque leur situation permet d’en inférer leur usage pratique (chauffage, cuisine, préparation du silex). Car Leroi-Gourhan fut d’abord ethnologue avant de devenir archéologue. Ce ne sont que les circonstances qui l’ont fait passer du Musée de l’Homme à la Sorbonne puis au CNRS.
Ainsi aussi, ce qui est moins connu, les rapports de l’homme et de la technique et le rapport entre les humains par le biais de l’analyse de leurs productions matérielles (Milieu et techniques 1945, Le geste et la parole 1964 1 et 2). « Il définit le ‘comportement technique’ comme ‘l’ensemble des attitudes psychosomatiques (c’est-à-dire les rapports entre le corps et le système nerveux central) qui se traduisent par une action matérielle sur le milieu extérieur’ » p.172.
Il a commencé lors de la fondation du Musée de l’Homme en 1937 par une mission d’ethnographie au Japon durant deux ans avant la seconde guerre mondiale avant de réintégrer le pays et d’entrer en Résistance, moins dans le réseau du Musée de l’Homme trop amateur et trop « coco » pour ce catholique social baptisé volontairement à 20 ans, mais dans le maquis de l’Ain, où il fut cité pour fait d’armes et obtint la médaille de la Résistance, la Croix de guerre et la Légion d’Honneur. La reconstruction d’après-guerre lui permet d’émerger, d’abord comme maître de conférences d’ethnologie à Lyon et créateur d’une école de fouilles à Arcy-sur-Cure, puis en Sorbonne à Paris où il enseigne l’ethnologie et la préhistoire avant de confier le poste de préhistoire à Michel Brézillon, son dynamique adjoint depuis des années et devenu docteur en préhistoire.
Mais c’est surtout la découverte du site magdalénien de Pincevent en Seine-et-Marne, le 5 mai 1964 par des amateurs, qui va fonder sa méthode de fouilles. Contrairement à Arcy où la stratigraphie était fondamentale, Pincevent est un site à plat où la topographie des vestiges compte le plus. Il s’agit alors de dégager la plus grande surface possible en laissant en place les objets découverts, pour comprendre les structures mises au jour. Le travail scientifique ne peut se faire qu’en équipe, chacun étant spécialisé et positionné dans une hiérarchie selon ses compétences, la direction n’appartenant qu’à un seul qui opère la synthèse. Les stagiaires sont contrôlés par des fouilleurs expérimentés, les sections par des chefs et l’ensemble du chantier par lui-même (p.469). Un exercice collectif de débat, chaque soir après la fouille, permet de confronter les points de vue. La méthode est au fond celle de la médecine hospitalière où le patron suivi de ses internes visite les malades en observant, échangeant et faisant de la pédagogie (p.473).
Leroi-Gourhan dit de l’ethnologie, tant classique que celle qu’il va élaborer en préhistoire : « La signification réelle de notre discipline (…) est de rendre témoignage devant notre civilisation, de la part que tous les hommes ont prise dans l’édifice commun » cité p.267. Avant de changer le monde, il faut d’abord le comprendre. Par exemple, le capitalisme est surtout « la succession cumulative des techniques » (p.395) constatée dans l’évolution humaine. Leroi-Gourhan n’est d’ailleurs pas optimiste sur l’avenir de l’humanité ; elle pourrait disparaître d’ici quelques dizaines de milliers d’années, l’évolution étant désormais pour l’espèce moins biologique que technique et sociale, avec toutes les incertitudes que cela peut comporter, notamment « une rupture entre les hommes et la matière » (p.458). Il voit la prolifération humaine au XXe siècle comme une prolifération microbienne, aussi nocive pour l’environnement. Quant aux ethnies, elles sont un « groupement fondamental », mais « le résultat d’une dynamique tant historique que relationnelle entre ses milieux intérieur et extérieur : « Constituée par un faisceau de caractères (raciaux, linguistiques, techniques, sociaux…) en état d’équilibre économique, c’est donc un moment dans une évolution, un état de cohésion qui implique l’instabilité au moins relative de l’ethnie ». » cité p.378. L’important n’est pas l’essence mais la dynamique ; pas un âge d’or mythique qui n’a jamais existé mais l’avenir préparé en commun.
Les dernières années sont une consécration pour l’œuvre accomplie, notamment pour la méthode scientifique de fouilles, au plus près des vestiges et tendant à accumuler le plus de données brutes possibles avant toute interprétation, de façon à ce que les archéologues du futur puissent reprendre l’étude avec des idées neuves mais une base objective de renseignements. Car toute fouille détruit irrémédiablement son terrain – et c’est bien le malheur des fouilles amateurs que de saccager le passé au profit de « l’objet ».
Il se trouve que j’ai connu André Leroi-Gourhan au début des années 1970 et que j’ai suivi son école de fouille plusieurs années sur le chantier d’Etiolles (Essonne) sous la direction d’Yvette Taborin, avant de soutenir entre autres une maîtrise en Préhistoire à la Sorbonne des années plus tard. Philippe Soulier était encadrant en 1972 ; il est désormais ingénieur de recherche au CNRS et membre de l’équipe ‘ethnologie préhistorique’ fondée par A. L-G. J’ai participé au moulage de l’habitation U5 avec Michel Brézillon, chargé de cours en Sorbonne et Directeur de la circonscription préhistorique d’Île-de-France avant d’être nommé Inspecteur Général de l’Archéologie auprès du Ministre de la Culture ; il est décédé en 1993. André Leroi-Gourhan est mort en 1986 de la maladie de Parkinson. Je connais donc bien le contexte et les personnes et c’est toujours une surprise de les retrouver figés en un livre.
Cet ouvrage d’une lecture pas trop austère intéressera quiconque aime l’archéologie et non seulement veut en savoir plus sur la manière la plus scientifique possible de fouiller sans tout éliminer, mais aussi sur les interprétations ethnologiques possibles en préhistoire qui surgissent des objets découverts et de leur agencement en structures. Plus que l’objet, c’est bien l’humain qui est le plus séduisant dans la discipline – et il fallait un ethnologue de formation pour accomplir cette révolution de méthode !
Philippe Soulier, André Leroi-Gourhan – une vie 1911-1986, CNRS éditions 2018, 646 pages, €27.00

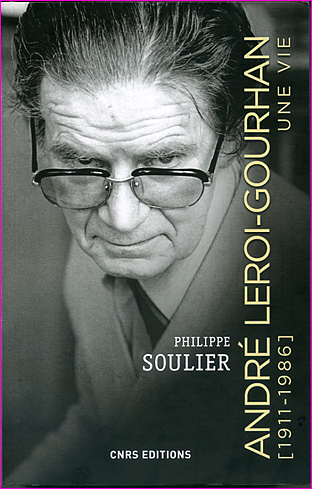
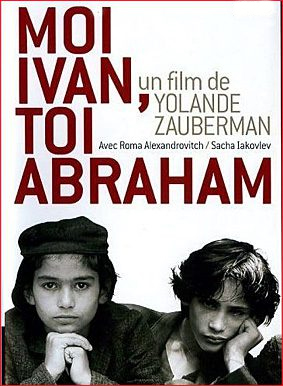



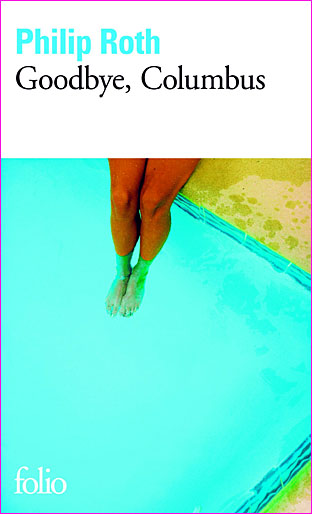
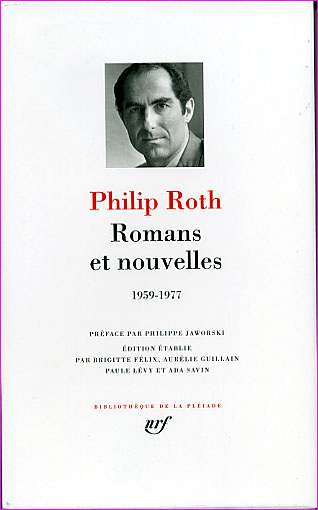
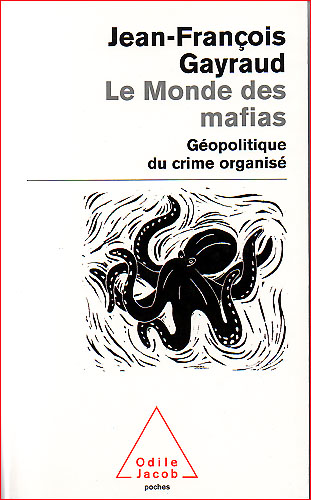















Commentaires récents