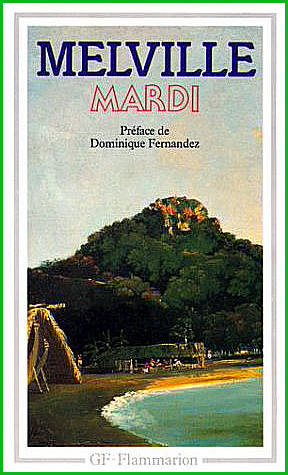 Ce titre n’a rien à voir avec le jour de la semaine. Ni même avec une quelconque réminiscence du compagnon d’un autre jour de Robinson. Figuraient en effet sur les cartes marines de cette région peu explorée du Pacifique, la mention « Mar di Sud » : la mer du sud en sabir d’époque, là où les îles surgissent des flots au gré du volcanisme. Et c’est ainsi que le troisième enfant littéraire d’Hermann Melville, qui se voulait la suite de Taïpi et d’Omou, quitte lentement les berges du réalisme pour aborder les bouillonnements du lyrisme et s’évader dans cette contrée inexplorée elle aussi de l’imaginaire. Les spécialistes de l’auteur datent de ce livre son entrée en littérature. Melville se libère du « vrai », peu romancé mais fondé (nombre de critiques ne le croyaient pas), pour laisser libre cours à la folle du logis : fantaisie, rêves, fantasmes.
Ce titre n’a rien à voir avec le jour de la semaine. Ni même avec une quelconque réminiscence du compagnon d’un autre jour de Robinson. Figuraient en effet sur les cartes marines de cette région peu explorée du Pacifique, la mention « Mar di Sud » : la mer du sud en sabir d’époque, là où les îles surgissent des flots au gré du volcanisme. Et c’est ainsi que le troisième enfant littéraire d’Hermann Melville, qui se voulait la suite de Taïpi et d’Omou, quitte lentement les berges du réalisme pour aborder les bouillonnements du lyrisme et s’évader dans cette contrée inexplorée elle aussi de l’imaginaire. Les spécialistes de l’auteur datent de ce livre son entrée en littérature. Melville se libère du « vrai », peu romancé mais fondé (nombre de critiques ne le croyaient pas), pour laisser libre cours à la folle du logis : fantaisie, rêves, fantasmes.
Dès les premiers chapitres, Melville remet en question les repères géographiques, ne sachant plus trop en quels passages erre le bateau baleinier où se narrateur se morfond après trois ans à bord. Il est quelque part entre Pitcairn et les îles Enchantées (futures Galápagos). Il rêve de sortir de l’ennui, d’être « ailleurs », de défier ce présent immuable par quelques passions et exercices, de remettre en cause sa condition routinière de matelot et d’ouvrir l’univers trop limité de ses connaissances. La bibliothèque du bord se réduit à deux manuels techniques ! Il s’évade donc en baleinière de ce camp de travail flottant, quelque part sur l’océan Pacifique, à un millier de milles d’un chapelet de ces îles du troisième sexe qui ont séduit Melville en sa jeunesse.
Il y deviendra, dans le roman, le demi-dieu Taji. Il n’est pas tout seul, ce jeune homme dans sa vingtaine ; il est chapeauté par son « copain » à la mode marine, un Scandinave d’âge mûr qui lui est fidèle et le protège. « Il m’adorait et, dès le début, s’était attaché à moi. Il arrive parfois qu’un vieux marin comme lui conçoive une très vive affection pour quelque jeune matelot de l’équipage ; une affection si dévouée qu’elle en devient tout à fait inexplicable, à moins qu’elle n’ait son origine dans cette solitude de cœur qui s’emparent de la plupart des marins qui vieillissent. » (chap.III)
Bien mieux écrit que les précédents livres, Mardi comporte encore trop d’adjectifs et trop de clins d’œil savants en références bibliques et dignes auteurs. On peut citer Platon, Montaigne, Shakespeare, Samuel Johnson… L’archipel fabuleux de Melville emprunte encore à Rabelais et à Swift, la fin à Dante. L’auteur se laisse aller à son lyrisme naturel, ose des comparaisons parfois somptueuses : une beauté comme un lac, des « dents si parfaites que lorsque leurs lèvres s’écartent, ont eût cru voir s’entrouvrir des huîtres perlières » (XL), les nuages au sommet de chaque île comme une fumée de wigwam indien, les jeunes guerriers « au teint de sherry doré », des « goyaves dont le parfum rappelait celui de lèvres à peine écloses. » (LXIII)
Chaque événement du récit change le narrateur. Il devient autre, son propre avatar sorti tout armé de ses rêves pour accompagner ce nouvel univers. Marin discipliné, aventureux évadé, conquérant de sa belle, amoureux transi, demi-dieu matois, presque philosophe, quêteur résigné… Le réel est désormais suspendu, plus question de faire le récit de ce qui serait vraiment arrivé. La vraisemblance est mise entre parenthèses au profit de la fantaisie ; l’espace-temps devient fluide. « Mais le désir nous donnerait-il l’objet du désir ?(…) Rien ne demeure. La rivière d’hier n’est pas celle qui coule aujourd’hui (…) Tout est en perpétuelle révolution (…) Ah ! dieux ! dans ce mouvement universel, comment croire que je serais moi, l’unique chose stable ? » (LXXVIII) D’ailleurs, on ne connaîtra jamais le « vrai » nom du narrateur. Un jour de lubie, il devient tout simplement Taji, demi-dieu pour vous servir. Nous n’en saurons pas plus, ni d’où il vient, ni pourquoi il était là. Tel l’adolescent en sa pire période, il ne vit que l’instant, tout fou, perpétuellement instable.
 Certains critiques ont vu trois parties en ce livre, d’autres cinq. Je penche pour ces derniers :
Certains critiques ont vu trois parties en ce livre, d’autres cinq. Je penche pour ces derniers :
- C’est l’ennui, l’évasion, la dérive. Mais la solide réalité d’une affection virile.
- Rencontre avec les « sauvages » qui détiennent une jeune fille blanche, enlevée dès l’enfance et destinée par le prêtre au sacrifice. Bataille, meurtre du père, enlèvement de Yillah, malédiction.
- Arrivée dans les îles, bref bonheur puis disparition mystérieuse de la fille, absence prédite, peut-être désirée, mais inacceptable. Nous n’en saurons pas plus sur cet élément féminin qui sert de prétexte et de décor convenable à quémander un sens dans la vie du narrateur/auteur.
- Suit une quête géographique et philosophique entre les îles enchantées ayant pour prétexte de rechercher la fille (ou l’amour ? ou l’existence adulte ? ou la sagesse ?). Impossibilité de la vérité, donc du réel. Le chapitre LXXXII en est la fable, mettant en scène deux envoyés du roi local dans une autre île, dont ils rapportent deux descriptions différentes.
- Fin du périple, échec de la quête. La satire de Sérénia, île de la Paix, est féroce. On ne sort pas de l’histoire par simple décision, même calquée du Christianisme. Taji, balloté, sans volonté, est escorté vers la reine magicienne Hautia, qui a ponctué son errance entre les îles de messages floraux portés par trois jeunes filles belles dehors, sorcières dedans (la hantise perpétuelle du jeune Melville). Taji refuse les enchantements de « l’amour » sorcier ; il force ses compagnons à l’abandonner ; il s’éloigne tout seul au large, par un étroit goulet qui n’est pas sans rappeler la façon dont il est venu au monde. Il demeure à la poursuite de sa chimère, poursuivi par la vengeance – l’aporie de la condition humaine sous l’angle puritain : rechercher Dieu/l’Amour, poursuivi par le Péché Originel. Son « dernier crime », si toute existence n’en est qu’une suite, peut-être est-ce le suicide d’une quête absolue de l’Absolu ?
Réalité/chimère, affection/espérance, du solide/de l’évanescent. Ces oppositions nous situent en pleine adolescence mentale. Un écrivain opère sa métamorphose, c’en est émouvant. Mais on quitte le roman avec le sentiment qu’il est raté. Même aujourd’hui, avec le recul du temps et la vision globale de l’œuvre.
Comme souvent, Melville ne sait pas maîtriser son ouvrage, il en fait « trop ». Il en rajoute, il renonce à élaguer, à décider. La partie quatre de la quête est particulièrement laborieuse, ennuyeuse, beaucoup trop longue par rapport au reste. Melville y déverse tout ce qu’il a appris des auteurs classiques en un périple à prétentions philosophiques qui tente d’embrasser toutes les expériences humaines. Le lecteur subit d’innombrables digressions documentaires, réelles ou imaginaires, d’une érudition inutile. Nous retrouvons une fois encore la coquetterie agaçante de l’autodidacte qui ne possède pas les instruments de la synthèse.
N’est pas Voltaire qui veut pour singer son Candide. Il ne parviendra à discipliner ce flot de notes et de références que dans Moby Dick – et encore, pas complètement.
Herman Melville, Mardi, poche Garnier-Flammarion 1999, 553 pages, €9.31
Retrouvez tous les romans d’Herman Melville chroniqués sur ce blog

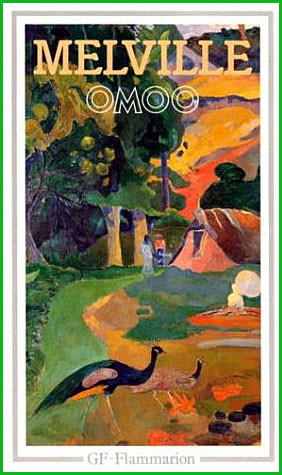






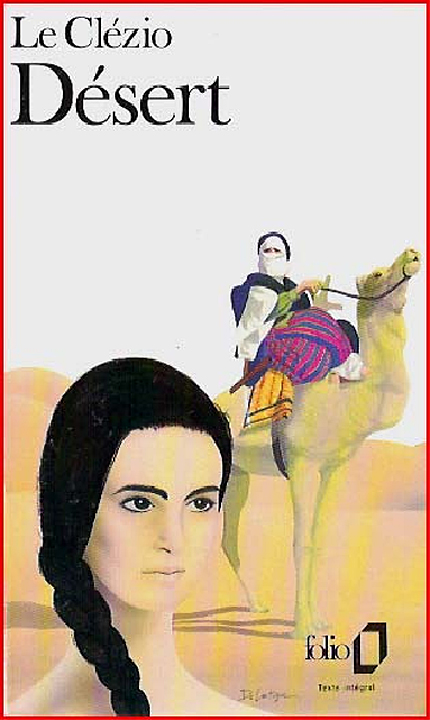

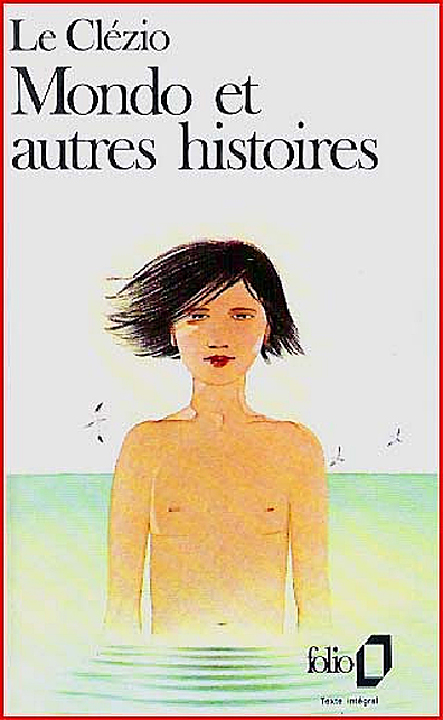
Commentaires récents