Les lettres de Flaubert sont moins empesées que ses œuvres littéraires. Il avait beaucoup de mal à « bien » écrire, écrasé par l’idée qu’il se faisait du Style. Il lui fallait gueuler ses textes pour qu’ils prennent quelque consistance à ses yeux et ses manuscrits ne sont qu’un ramassis de remords en pattes de mouche… Ses lettres le montrent en son intime, avec ses amis et sa famille, au débotté. Il argote, il familière, il dit comme il sent. Sa plume file comme sa conversation, ce qui est tout à fait vivant !
Né en décembre 1821, la première lettre de lui conservée date de ses 9 ans ; elle est à sa grand-mère pour les vœux. Le tome 1 de la Pléiade va jusqu’à ses 30 ans, en passant par ses amis de collège, ses études de droit interrompues par une épilepsie (à laquelle une syphilis ne serait pas étrangère), son amour pour la putain de haut vol Louise Colet dont l’époque ne compte plus les amants – enfin le plus intéressant, son fameux voyage en Orient avec Maxime du Camp. L’écrivain voyageur et l’auteur se sont rencontrés lorsque Gustave était étudiant. Maxime a 27 ans et Gustave 28 quand ils quittent Paris le 29 octobre 1849 pour embarquer en paquebot vers l’Égypte. Ils y séjournent 8 mois avant de poursuivre vers la Palestine, la Syrie, la Turquie, la Grèce et l’Italie. Ils ne reviennent en France qu’en 1851.
Flaubert collégien vomit l’école, son encasernement, ses frustrations physiques et sexuelles, sa politique du « concours » pour toutes matières et le mépris des pions pour les élèves. Misanthrope et ironique à 12 ans, il se gave d’auteurs grecs et latins, d’histoire antique. Amoureux à 13 ans de deux anglaises de 14 et 11 ans, il sera transi par la belle adulte Élisa, rencontrée aux bains de mer de Trouville. Gustave gardera des relations avec elles toutes car il aime les gens, frustré sans doute de s’être vu préférer son frère aîné Achille par son père et sa petite sœur Caroline par sa mère. C’est souvent le destin des seconds… Il se réfugie alors dans l’amitié des copains, Émile, Alfred, Louis, plus tard Maxime. Il invente et joue avec eux le rôle du Garçon, personnage de comédie : grotesque, rabelaisien, fouteur allègre, caricature de bêtise égoïste et pétante de santé. A 17 ans, il aime Hugo (d’avant Les Misérables, qu’il trouvera moraliste et naïf), Racine, Calderon, Montaigne, Rabelais, Byron. Il aime rire devant l’absurdité de toutes les croyances, la vanité étant pour lui la pire de toutes.
Gustave Flaubert se veut hors du siècle dont il méprise les « épiciers » – les bourgeois. Il n’hésite pas à provoquer « le système », se faisant virer du lycée pour avoir protesté, à la tête de ses camarades, contre le renvoi du professeur de philo. Il passera le bac en candidat libre – avec réussite ! A 18 ans, « Gustave était aussi beau qu’un jeune grec », affirme la biographie Troyat. Au retour d’un voyage en Corse, il est déniaisé par une tenancière d’hôtel à Marseille, Eulalie Foucaud, qu’il ne reverra jamais. Il aime ça, se repaît de la chair (« buffle indompté des déserts d’Amérique » versifiera la Colet), mais garde une tendresse romantique pour les amours platoniques. Il restera toujours partagé entre le cœur et le ventre, l’euphorie des passions et la « viande ». Pour lui, l’artiste est celui qui sait partager sa vie entre son œuvre et les nécessités, sans que ces dernières n’empiètent sur ce qui doit rester premier : le travail de créer. Ne pas « mêler à l’art un tas d’autres choses, le patriotisme, l’amour, la gloire » (lettre 7 nov. 1847).
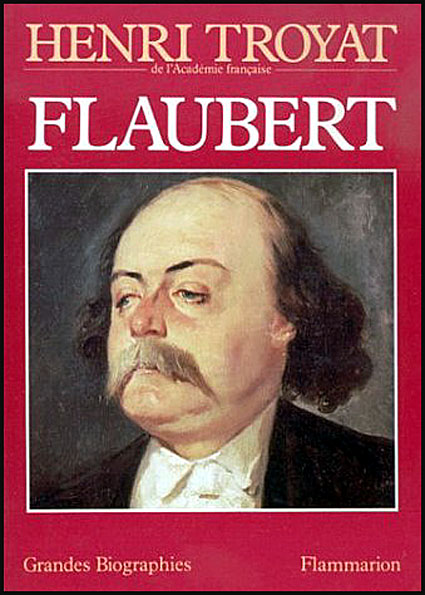 Le droit l’ennuie, occupé de propriété, d’héritage et d’argent. Paris, ses spectacles et ses cocottes, lui plaît bien mais il n’a pas les moyens. Première année de droit réussie, la seconde échoue sur une crise nerveuse à 22 ans (affectant le « lobe temporo-occipital gauche ») qui l’oblige à abandonner les études. Son père mort, sa sœur décédée, son beau-frère fou – il se trouve enchaîné par sa famille et s’enterre à Croisset, dans le fonds d’une province près de Rouen. Sa mère, sa nièce et les vagues visites de son frère médecin lui servent de boulet. Sa passion tumultueuse pour Louise Colet, parisienne, lui est l’occasion d’approfondir les variétés du sexe, du cœur et de la politique. Il rencontre la mauvaise foi, les accusations gratuites, l’injure suivie de repentir, la cocotte amoureuse. Possessive, susceptible, envahissante, jalouse, Louise Colet veut l’orage romantique de la passion tandis que Gustave a besoin de calme intérieur. Ils s’écriront 5 ans, se verront souvent, se baisant fougueusement. Puis la rupture sera d’évidence. Mais il lui écrit et l’appelle sa Muse.
Le droit l’ennuie, occupé de propriété, d’héritage et d’argent. Paris, ses spectacles et ses cocottes, lui plaît bien mais il n’a pas les moyens. Première année de droit réussie, la seconde échoue sur une crise nerveuse à 22 ans (affectant le « lobe temporo-occipital gauche ») qui l’oblige à abandonner les études. Son père mort, sa sœur décédée, son beau-frère fou – il se trouve enchaîné par sa famille et s’enterre à Croisset, dans le fonds d’une province près de Rouen. Sa mère, sa nièce et les vagues visites de son frère médecin lui servent de boulet. Sa passion tumultueuse pour Louise Colet, parisienne, lui est l’occasion d’approfondir les variétés du sexe, du cœur et de la politique. Il rencontre la mauvaise foi, les accusations gratuites, l’injure suivie de repentir, la cocotte amoureuse. Possessive, susceptible, envahissante, jalouse, Louise Colet veut l’orage romantique de la passion tandis que Gustave a besoin de calme intérieur. Ils s’écriront 5 ans, se verront souvent, se baisant fougueusement. Puis la rupture sera d’évidence. Mais il lui écrit et l’appelle sa Muse.
Le voyage en Orient sur 21 mois est une bouffée d’air frais. Certainement le plus vivant du recueil de lettres. Il est libre, enfin libre ! Délivré des bonnes femmes et des attaches du Devoir. Il va où il veut avec l’ami du Camp, il aime ce qu’il veut quand il veut. Il bâfre, galope, gamahuche ; il visite les sites antiques ; il est ébloui de « couleurs d’enfer ». L’Égypte lui paraît du dernier « grotesque » avec ses chameaux gracieux, ses indigènes crus, ses almées tétonnières. « Tout le vieux comique de l’esclave rossé, du vendeur de femmes bourru, du marchand filou, est ici très jeune, très vrai, charmant » (1er décembre 1849). Il goûtera des filles au bordel comme des garçons au hammam, jouera « le Cheik » sur le mode du Garçon dans ces rôles entre amis qu’il affectionne. Le ciel « casse-pète » de bleu, tandis que « rien n’est beau comme l’adolescent de Damas » (4 septembre 1850) et qu’il s’extasie sur un bas-relief de l’Acropole : « Il ne reste plus que les deux seins depuis la naissance du cou jusqu’au-dessus du nombril. L’un des seins est voilé, l’autre découvert. Quels tétons ! nom de Dieu ! quel téton ! Il est rond-pomme, plein, abondant… » (10 février 1851). Suivent deux pages de pur bonheur sur la typologie des tétons féminins.
Bien sûr, il n’écrit pas ce genre de chose à sa mère (60 lettres !) et le contraste des missives à ses copains est une drôlerie du recueil. Nous découvrons Flaubert intime, loin du « style » laborieusement accouché où architecture du récit, musique des phrases et précision des mots lui arrachent habituellement des mois de travail ! Un vrai bonheur de lecture.
Gustave Flaubert, Correspondance tome 1, 1830-1851, édition Jean Bruneau, La Pléiade Gallimard 1973, 1232 pages, €53.79
Henri Troyat, Gustave Flaubert, biographie 1992, Flammarion 410 pages, €18.05

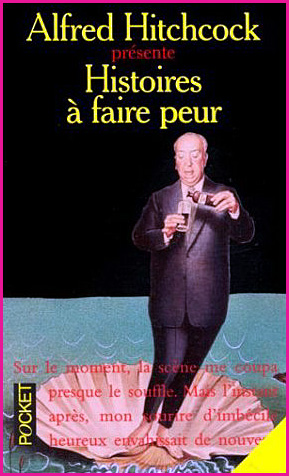

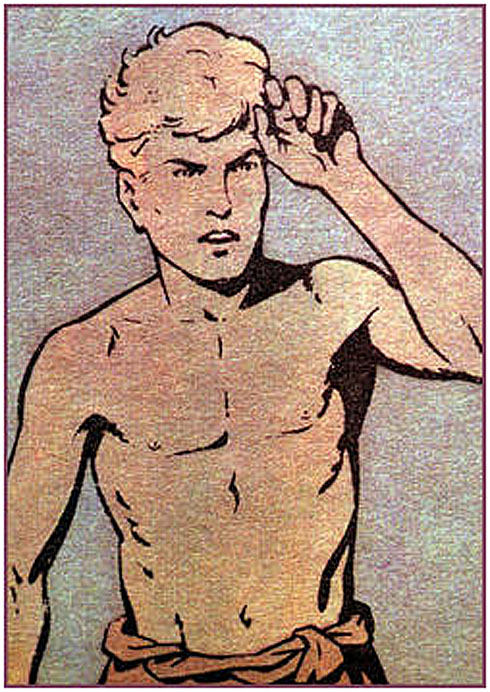


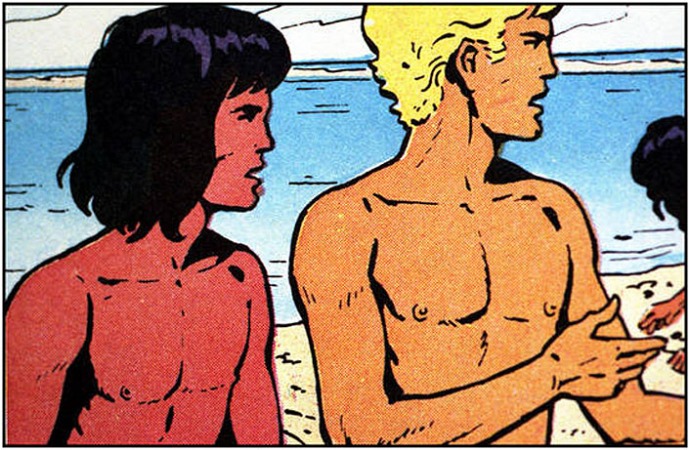

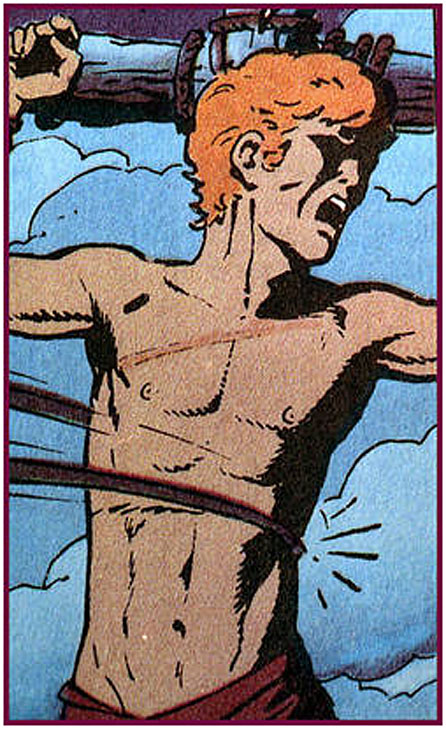
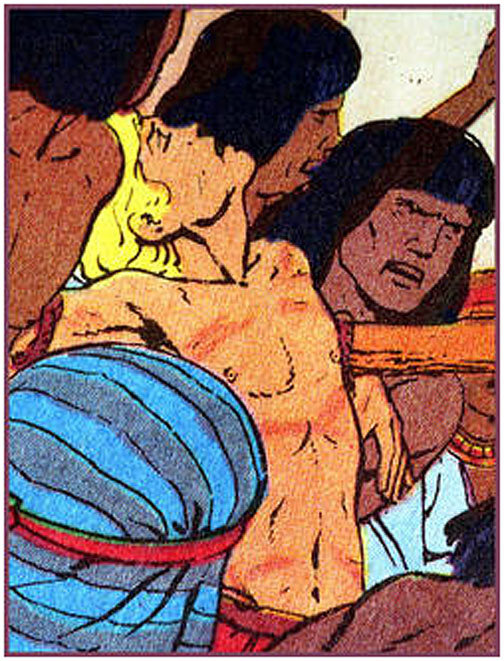
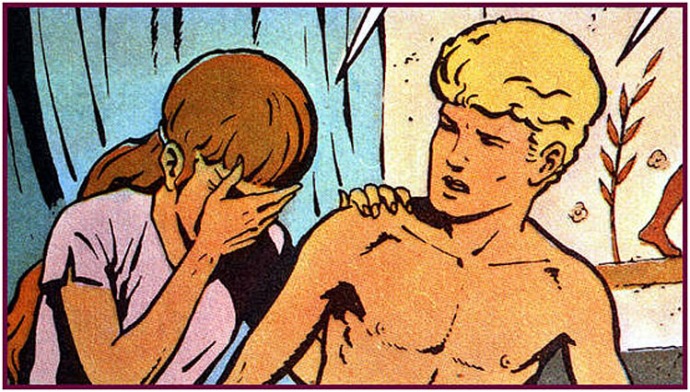
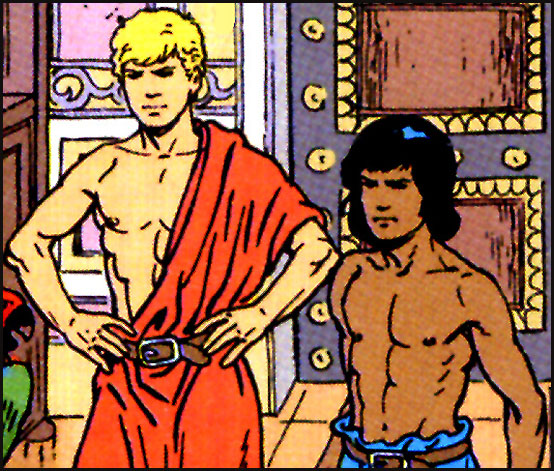


Commentaires récents