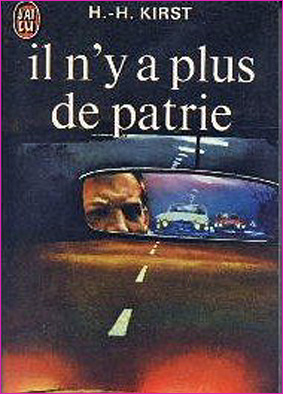
Kirst est un journaliste allemand né en 1914 et décédé en 1989 à 74 ans, avant la chute du Mur. Fils d’un agent de police et élevé en Prusse-Orientale, il s’engage dans la Reichswehr où il deviendra adjudant-chef. La Seconde guerre mondiale le promeut lieutenant et « officier instructeur national-socialiste. » Il est dénoncé aux Américains par Franz Josef Strauss, motocycliste nazi, chef du parti conservateur de Bavière et futur ministre de la Défense de la RFA. Interné, il passe neuf mois de camp avant d’être relâché sans charges. Il deviendra célèbre avec sa trilogie 08/15 qui raconte la vie de caserne, la guerre et le retour à la vie civile de l’adjudant Ash (ou H comme Hans ou Hellmut, autrement dit lui-même).
Kirst se dit « individualiste par conviction, réaliste par expérience, socialiste sans romantisme » – donc sans plus le « national » du nazisme. Il s’opposera vigoureusement dès 1950 au réarmement de l’Allemagne voulu par les Américains car, pense-t-il, le nazisme n’est pas éradiqué dans le pays, ni par le nombre des anciens toujours en poste, ni dans les façons de penser.
Ce roman, à la fois policier et politique, nous plonge dans l’Allemagne de l’Ouest vingt ans après la guerre. Il est à la fois obsolète et inactuel. Obsolète parce que l’Allemagne n’a plus grand-chose à voir quarante ans après, avec ce qu’elle était à peine relevée de ses ruines ; inactuel parce que les manipulations politiques restent le quotidien de tous les États, y compris de Schröder l’ancien Chancelier pro-russe et de Merkel qui lui a succédé, qui a elle-même laissé son pays devenir dépendant à l’énergie de Poutine.
Industriels et politiciens s’entendent comme larrons en foire dès qu’il s’agit d’utiliser les crédits publics pour assurer leur pouvoir et leurs bénéfices. Le héros, Karl Wander (le wanderer est le nomade sans attaches) a trouvé un emploi à Bonn, alors capitale de la RFA, auprès d’un conseiller politique qui sert un probable futur ministre. Il lui est demander d’enquêter et de servir d’intermédiaire pour servir les ambitions politiques – naturellement camouflées sous le vernis du renouveau démocratique allemand et de l’efficacité de la Bundeswehr.
Wander est un idéaliste, il sera broyé. Les politiciens réalistes et cyniques sauront le manipuler à loisir, usant pour cela de tous les « dossiers » constitués contre lui depuis des années. Heureusement, il était trop jeune sous le nazisme, mais il a connu charnellement Sabine W-W, maîtresse en titre d’un important industriel de l’armement, et accessoirement maîtresse occasionnelle de Krug, le patron de Wander.
Une jeune fille, Eva, est retrouvée tabassée à la porte de l’appartement alloué à Wander ; il la sauve, la met sur son lit, appelle un docteur des Urgences – mais le médecin traitant des stars de la politique et de l’industrie survient pour l’emmener, déclarant qu’elle est sa patiente. Eva est en effet la fille adoptive de l’industriel de l’armement Morgenrot (Matin rouge) qui fournit les renseignements à Wander sur ses concurrents et leurs échecs industriels – pour mieux bénéficier de la future manne gouvernementale.
Son demi-frère Martin, qui avait voulu la sauter enfant et reste jaloux de ses amants, tabasse Wander et voudra même le tuer à l’aide d’une de ces grosses « Mercedes coffre-fort » en projetant sa voiture d’un pont. Wander, à chaque fois, se laisse faire, comme si tout lui était égal depuis que son idéal ancien a disparu et que le nouveau n’est pas près de naître.
Karl Wander se fait aider par un médecin honnête, le Dr Bergner des Urgences, par un policier honnête à figure paternelle, Kohl, par un journaliste juif américain, Sandman. Lequel mandatera un agent des services secrets, Jérôme, pour démêler la pelote. Il agit comme un chœur antique lors de chapitres intercalaires d’analyses, un peu verbeuses mais qui donnent de l’air.
Ce thriller politique est un roman sans guère de saveur, non-engagé sauf en mots, pessimiste sur la démocratie, la politique et les Allemands. « Les Allemands n’ont pas la vie facile. Mais ils aiment bien se la rendre plus difficile encore. Ils n’auraient eu qu’à ouvrir les yeux et à réfléchir un peu : tirer un trait final, vraiment déterminant, eût été, sans aucun doute, possible. Mais c’est apparemment à cela que ce peuple ne pouvait se résoudre. C’est ainsi que les Allemands continuèrent à traîner avec eux, non seulement les officiers de Hitler, mais aussi leur soi-disant ‘esprit’, avec leurs ‘expériences’ et leurs ‘principes’ (ce qu’ils ont reconnu), donc toute l’étroitesse d’esprit de ces gens, leur obéissance de cadavres, leur incurable entêtement » p.268.
Juste un jalon de l’histoire écrit assez lourdement avec le formalisme des relations et les explications décortiquées. Un roman publié en collection de poche populaire, aujourd’hui oublié et qui gagne à le rester, sauf pour les spécialistes de la mentalité allemande.
Hans-Hellmut Kirst, Il n’y a plus de patrie, 1968, J’ai lu 1971, 373 pages, €7,40

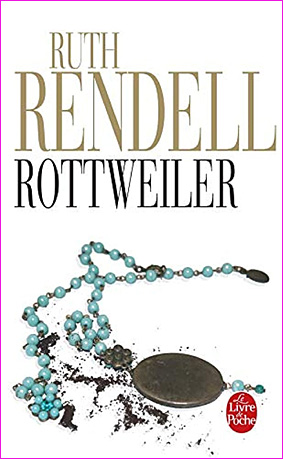
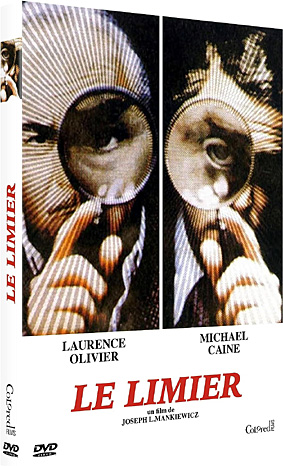










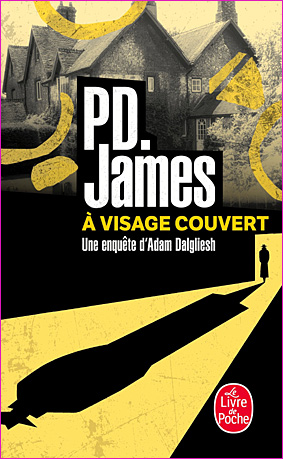

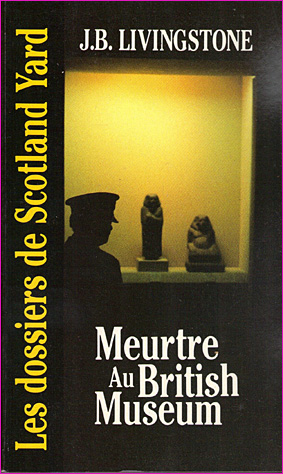
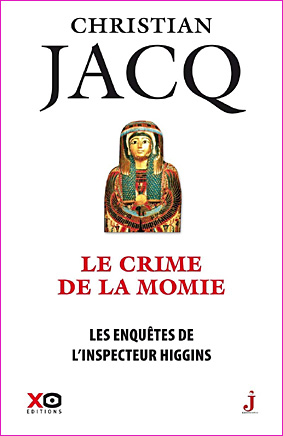
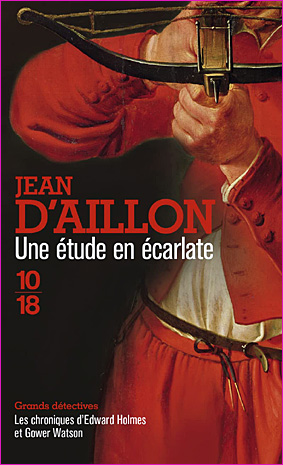
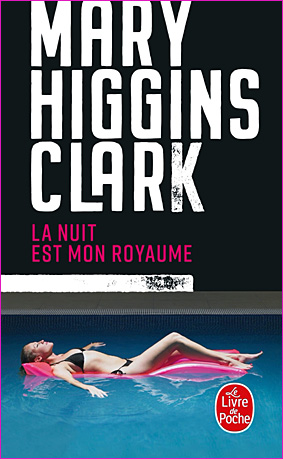
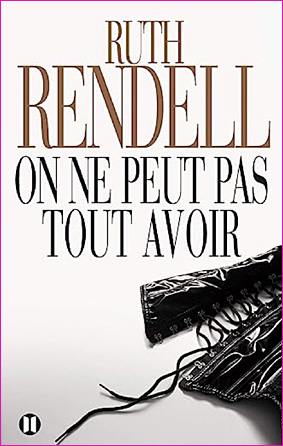

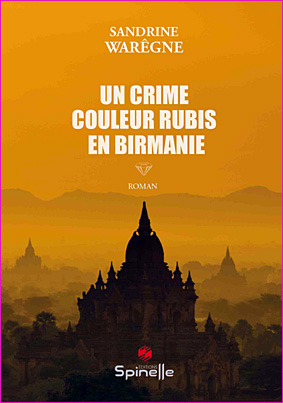

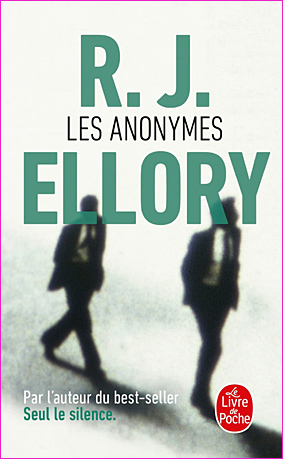

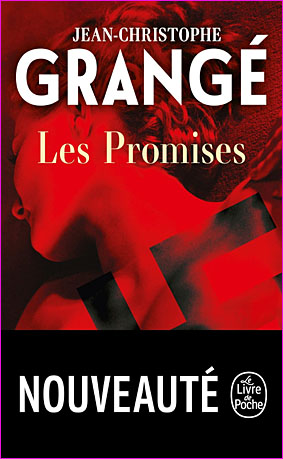


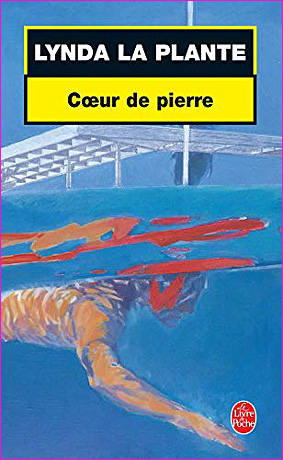
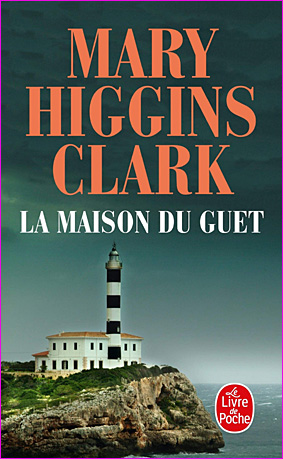





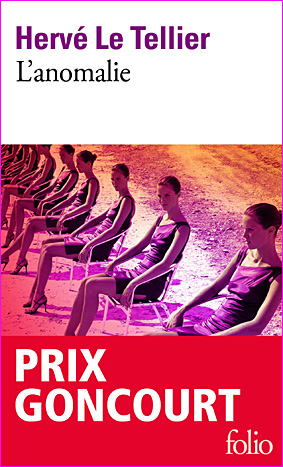


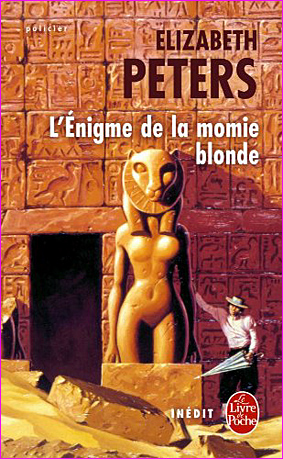

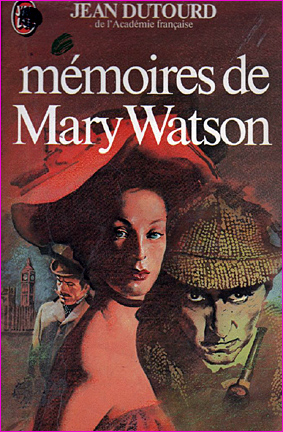
Commentaires récents