Une « novelle », ou court roman, intitulé en anglais The Ladybird, inspiré de la Première guerre mondiale. Lawrence était pacifiste, et réformé, il n’a pas fait la guerre mais en a vu toutes les conséquences horrifiques sur le physique des jeunes hommes, sur leur moral dévasté, sur les femmes qu’ils avaient épousées ou aimées. Toute la société, les normes, les mœurs, les classes, les rapports économiques – tout a été bouleversé par cette boucherie industrielle fomentée par des badernes imbéciles, sur des valeurs d’un autre âge. Quand je pense qu’on a « commémoré » il y a peu cet abrutissement d’État, ce suicide européen… « Les années 1916 et 1917 furent celles où l’esprit d’antan mourut à jamais en Angleterre », écrit lugubrement l’auteur p.546 Pléiade.

Le propos de cette longue nouvelle est l’effet miroir. Lady Daphné a épousé un fils d’ancien ministre fort honorable, mais pauvre, et qui s’est retrouvé blessé et prisonnier des Turcs pro-allemands à Chypre. En 1918, il va être libéré et rentrer en Angleterre, défiguré, mais surtout châtré moralement. Sa mère, Lady Beveridge a vu ses frères et ses fils mourir à la guerre, mais son empathie native la pousse à aller visiter les blessés prisonniers à l’hôpital. Elle y rencontre une ancienne connaissance, le comte Johann Dionys Psanek, originaire de Bohême. Il a reçu deux balles dans la poitrine, mais se remet peu à peu.
Lorsqu’elle en parle à sa fille, celle-ci se souvient qu’il lui avait offert, à ses 17 ans, un dé à coudre doré orné d’un serpent et d’une coccinelle en pierre vert pomme, peut-être de la jade. La coccinelle est dans le blason des Psanek, venue droit du scarabée égyptien, animal qui a donné l’idée du soleil qui parcourt les mondes en roulant sa bouse entre ses pinces. Le comte est adepte initié d’une société occulte qui croit que « le véritable feu est invisible. (…) Le jaune du soleil, la lumière même, ce n’est que le regard latéral du véritable feu originel. (…) Même le soleil est noir » p.571. Tout ce que nous vivons n’est que l’envers du vrai. Même l’amour est « le sépulcre blanchi de l’amour vrai ».
Lady Daphné, en oie bête, est ensorcelée par ce magicien gnome, noir de poil et de petite taille, un rejeton d’une population préhistorique au centre de l’Europe, dit l’auteur, plutôt poussé vers les grands nordiques blonds. Dès lors, malgré son mari revenu, elle va se tourner vers le comte, lequel va bientôt repartir libéré vers la Bohême. Il prône des valeurs antérieures au christianisme, lorgnant vers l’Égypte et ses mystères, et la domination des plus forts – qui soumettront naturellement à leur aura la masse des faibles (dont les femmes). Elle est enchantée par une chanson triste qu’il murmure le soir en sa langue. Elle va lui vouer une pulsion amoureuse qu’il accepte, mais comme amour de la nuit, le jour étant réservé à son mari. L’amour habituel n’est que superficiel, social, conventionnel, alors que celui qu’elle a découvert lui apparaît comme le véritable, le viscéral, le seul vrai.
Cette fable entre le mari Basil (basileus le roi), la femme (Isis l’égyptienne), l’amant Dionys (Dionysos platonique) est revisitée en contraste. Apollon, le souverain nordique est solaire ; Dionysos, le trublion sensuel venu d’Asie est nocturne. Il inverse toutes les valeurs. Lawrence a mal digéré Nietzsche et cherche plutôt confusément à faire avec sa pensée des romans selon ses dadas : que le corps est esprit, que l’esprit va au-delà de l’amour pour chercher le fusionnel, en bref toutes ces sortes de choses obscures. Ce n’est pas vraiment réussi, même si cela plaît aux exégètes de l’auteur. Pour ma part, je trouve le thème et la psychologie tellement datés…
David Herbert Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley et autres romans, Gallimard Pléiade 2024, 1281 pages, €69,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans de D.H. Lawrence déjà chroniqués sur ce blog


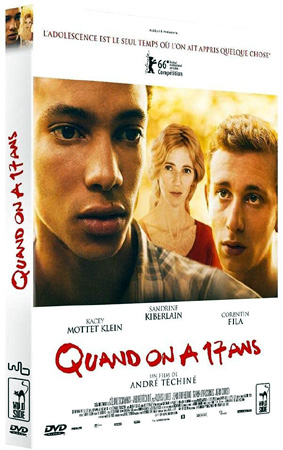




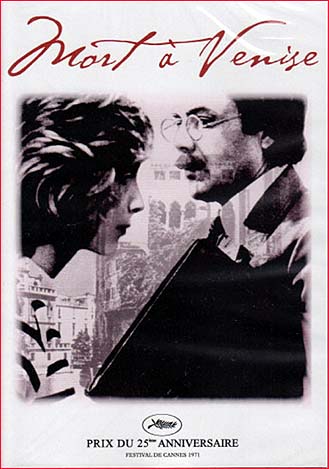



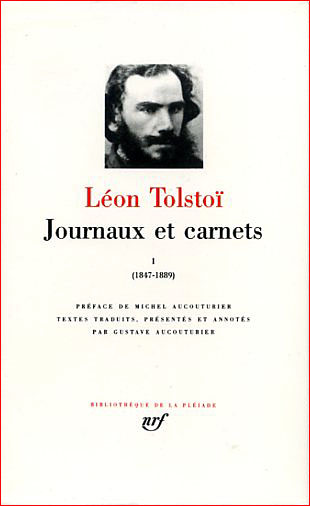


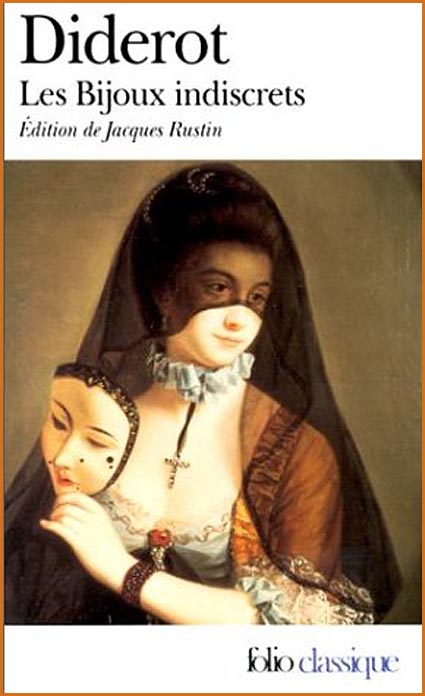

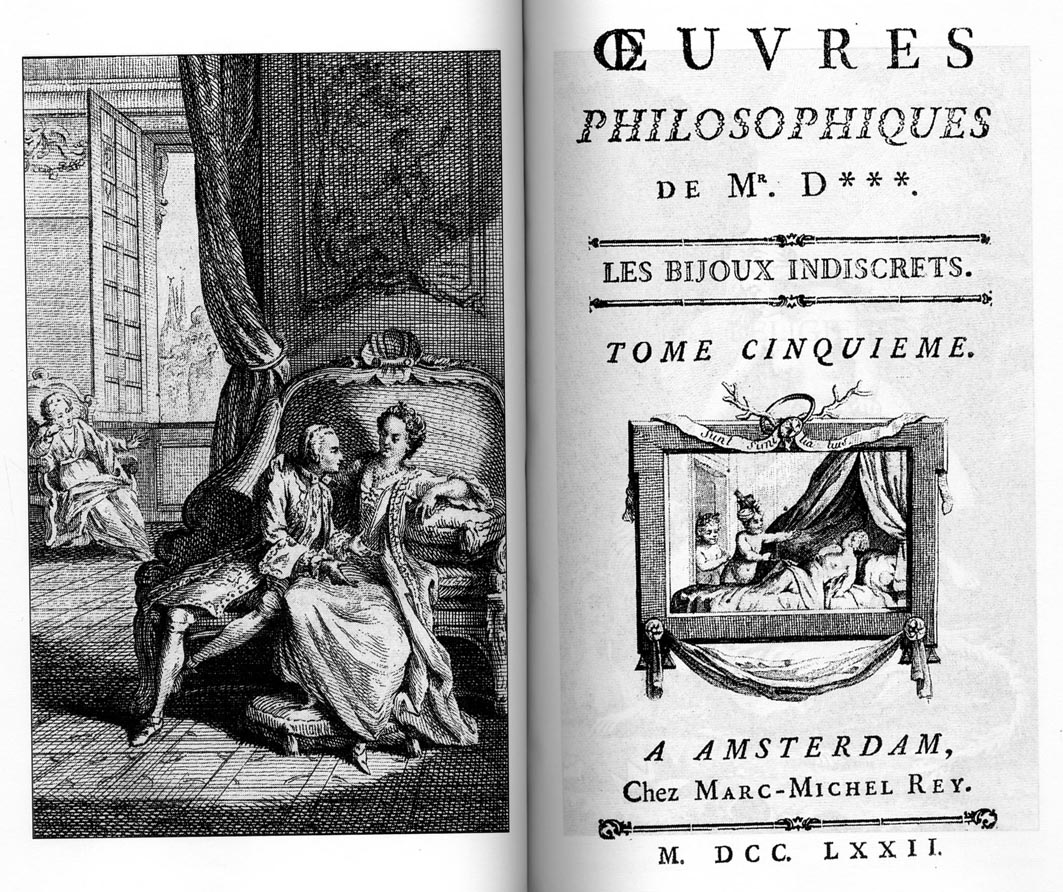


Commentaires récents