 Ce roman, paru il y a un demi-siècle, reste d’actualité en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes. Les mangeurs d’étoiles sont les hallucinés ; ils mâchent des feuilles, des herbes ou des champignons pour voir la vie en rose. Ils se gorgent d’idéologie, d’indigénité (appelée chez nous « identité nationale ») ou de religion. Ils se croient missionnés pour le Bien, faire le bonheur des gens malgré eux. Ce sont des dictateurs, des gourous, des « révolutionnaires ». Ou bien des colonialistes, exploiteurs ou donateurs à bonne conscience.
Ce roman, paru il y a un demi-siècle, reste d’actualité en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes. Les mangeurs d’étoiles sont les hallucinés ; ils mâchent des feuilles, des herbes ou des champignons pour voir la vie en rose. Ils se gorgent d’idéologie, d’indigénité (appelée chez nous « identité nationale ») ou de religion. Ils se croient missionnés pour le Bien, faire le bonheur des gens malgré eux. Ce sont des dictateurs, des gourous, des « révolutionnaires ». Ou bien des colonialistes, exploiteurs ou donateurs à bonne conscience.
Romain Gary, né en Russie et arrivé en France à 14 ans, s’est engagé en 1940 dans la France libre. Compagnon de la Libération, il devient consul de France notamment en Amérique latine. C’est dire s’il connait bien des contrées et leurs mœurs, dans ces années 1960 toutes acquises aux « révolutionnaires » agrariens : Che Guevara et Fidel Castro. Sauf que lui les côtoie de près ; qu’il n’est pas intello de Normale Sup ni des cafés enfumés de Saint-Germain des Prés où l’on refait le monde en théorie dans un fauteuil. Il a connu la famine sous Staline, la guerre contre les fascismes et le cynisme communiste. Il est donc immunisé.
Ce qui nous vaut ce roman picaresque, écrit d’une plume alerte, avec la verve d’une jeunesse bien vécue. Avant Guy Debord, son humanité saltimbanque vaut bien la société du spectacle. La politique est un théâtre, pas plus honorifique que les acteurs des cafés-concerts ou les numéros de cirque des clowns et des acrobates – ou même des télévangélistes ! La faute à qui, si l’être humain est devenu histrion ? A la religion d’abord, puis au marxisme devenu dogme qui lui a succédé. Toute Vérité révélée se veut totalitaire. Ce ne sont pas nos imams braillards d’aujourd’hui qui démentiront le portrait.
Ce pourquoi il faut relire Romain Gary qui décortique avec jubilation ce grand guignol fait d’artifices et de coups de gueule, dont Chavez est le dernier avatar.
José Almayo est un pauvre indien Cujon (invention de l’auteur qui peut se prononcer couronne ou couillon). Il a le visage impassible d’un dieu maya, mais avec du sang espagnol. Poussé aux études par les curés, devenu prostitué à 14 ans pour acquérir la gloire de toréer, il enrage d’être peu doué et de se faire moquer. « Quand on est né indien, si on veut s’en sortir, il faut le talent ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero » p.117. On dirait aujourd’hui chanteur, footeux ou terroriste – mais rien n’a changé. A 17 ans, il quitte son gras protecteur pour revenir au village consulter le prêtre qui l’a sorti de la glèbe. Il n’a pas réussi avec Dieu et le bien, il lui demande donc par contraste quels sont les plus grands péchés. Le vieux lui répond la sodomie, l’inceste et le meurtre d’un religieux.
Tout ce qu’on lui a appris est faux. « En fait, tout était mal, il n’y avait de bien que la résignation, la soumission, l’acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l’âme de leurs enfants, morts de sous-alimentation ou d’absence totale d’hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu’ils avaient envie de faire, les Indiens, forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable » p.133. Et aux Américains, puisque les bien-pensants de gauche les accusent d’être impérialistes – Almayo les trouve donc irrésistibles.
 L’éphèbe José décide donc de changer de protecteur. Exit Dieu, appel au Diable, El Señor en espagnol. Il tue le prêtre « respectueusement », puis copule avec sa sœur (déjà déflorée par son frère aîné) ; la sodomie, il a déjà donné. Mais il sait que le cul est sans importance pour devenir quelqu’un. Il entre dans la police, se crée des protections, en devient chef, puis renverse le dictateur en place avec un quarteron de généraux, avant de faire place nette pour lui tout seul. La protection majeure est celle des États-Unis et, dans ces années de guerre froide, s’afficher marxiste est le seul moyen de faire affluer l’aide américaine. L’idéologie, il s’en fout, comme tous les histrions, Mélenchon y compris ; ce qui compte est la gloire, qui garantit le pouvoir et l’argent. Le monde a-t-il changé ?
L’éphèbe José décide donc de changer de protecteur. Exit Dieu, appel au Diable, El Señor en espagnol. Il tue le prêtre « respectueusement », puis copule avec sa sœur (déjà déflorée par son frère aîné) ; la sodomie, il a déjà donné. Mais il sait que le cul est sans importance pour devenir quelqu’un. Il entre dans la police, se crée des protections, en devient chef, puis renverse le dictateur en place avec un quarteron de généraux, avant de faire place nette pour lui tout seul. La protection majeure est celle des États-Unis et, dans ces années de guerre froide, s’afficher marxiste est le seul moyen de faire affluer l’aide américaine. L’idéologie, il s’en fout, comme tous les histrions, Mélenchon y compris ; ce qui compte est la gloire, qui garantit le pouvoir et l’argent. Le monde a-t-il changé ?
Il cherche à rencontrer le diable et, pour cela, convoque les plus grands manipulateurs qu’il peut trouver. Staline est mort, comme Hitler, c’est dommage ; il se rabat sur le meilleur casting du temps. Le Dr Horwat le télévangéliste américain blond, Agge Olson le ventriloque danois, le jeune cubain supermâle aux dents aurifiées, Charlie Kuhn né Majid Kura à Alep le directeur d’une agence artistique, Monsieur Antoine le jongleur de Marseille, Manulesco le juif roumain violoniste, John Seldon l’avocat d’affaires du dictateur – et même la pute américaine, très jeune actrice nominée, qui lui sert de maitresse kleenex – sont des rôles composés. Tous se croient géniaux, utiles à l’humanité. Ils ne sont que des pantins mus par la vanité. Le pouvoir ou l’argent ne sont rien face à la gloire…
Le roman commence au moment ou le capitaine Garcia, aussi roublard et borné que le sergent de Zorro, reçoit l’ordre – donné par le dictateur lui-même – de fusiller tout ce petit monde, sa mère comprise. C’est que la révolution gronde à nouveau, un jeunot guévariste veut lui ravir la place. Quoi de mieux que de tuer des étrangers, d’en accuser le rebelle, et de recevoir des marines venus ramener l’ordre ? Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le Diable se rit des humains qui croient en lui. Dieu aussi, semble-t-il, puisque la conne américaine, devenue sa maitresse, se sent coupable d’être née nantie, socialement inutile. Elle veut « se réaliser » et « s’exprimer », scies de la jeunesse des années 60. En voulant faire le bien elle fait le mal, tant l’enfer est pavé de bonnes intentions. Le développement trop brutal pousse les masses à la révolte, les réalisations « culturelles » se font au détriment de la misère et du chômage (n’est-ce pas, Martine Aubry ?).
L’auteur se place en observateur de la comédie humaine, ces « révolutionnaires » en paroles pour faire l’acteur, mais avides de gloire égoïste qui donne le pouvoir et l’argent. Il crée le personnage de Radetzky, conseiller de José Almayo, qui se dit ex-parachutiste de Hitler comme Skorzeny, en réalité journaliste suédois né Leif Bergstrom et aventurier comme Romain Gary. Lui aussi joue un rôle, la différence est qu’il ne se prend pas au sérieux et met sa vie en jeu.
Leçon du livre : « Après tout, il n’y a pas d’autre authenticité accessible à l’homme que de mimer jusqu’au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu’à la mort à la comédie et au personnage qu’il avait choisis. C’est ainsi que les hommes faisaient l’Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume » p.386. Oui, mais l’histoire jugera – elle est impitoyable aux faiseurs.
Romain Gary, Les mangeurs d’étoiles, 1966, Folio 1981, 448 pages, €7.69
Romain Gary présente lui-même Les mangeurs d’étoiles en archives INA
Eva Bester parle en vidéo des Mangeurs d’étoiles sur Arte
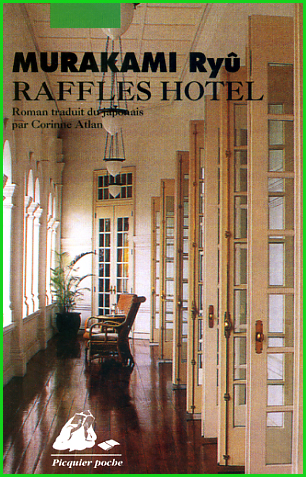 Moeko joue constamment un rôle, même dans ses rêves. Elle est l’incarnation parfaite de « l’actrice », la robotisation perfectionnée du rôle. Elle fait de la vie une jungle où elle est parfois sangsue, parfois plante carnivore. En tout cas vénéneuse, incapable de partager une quelconque émotion. Son obsession est de se faire prendre (seulement en photo) par un milliardaire ex-journaliste durant la guerre du Vietnam. Mais elle n’est jamais contente du résultat, l’appareil ne pouvant combler ni satisfaire ce trou noir à l’intérieur d’elle-même.
Moeko joue constamment un rôle, même dans ses rêves. Elle est l’incarnation parfaite de « l’actrice », la robotisation perfectionnée du rôle. Elle fait de la vie une jungle où elle est parfois sangsue, parfois plante carnivore. En tout cas vénéneuse, incapable de partager une quelconque émotion. Son obsession est de se faire prendre (seulement en photo) par un milliardaire ex-journaliste durant la guerre du Vietnam. Mais elle n’est jamais contente du résultat, l’appareil ne pouvant combler ni satisfaire ce trou noir à l’intérieur d’elle-même.
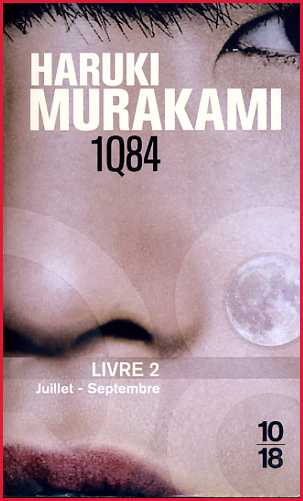













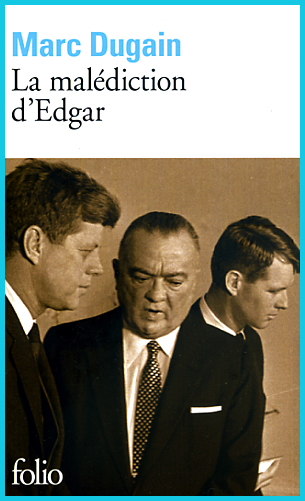


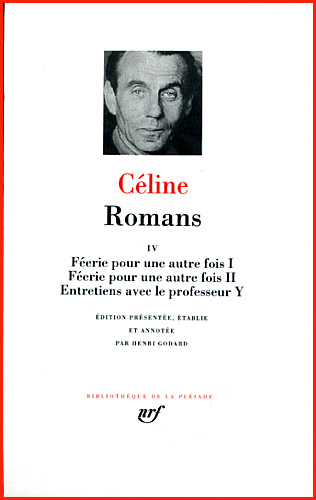
Commentaires récents