
Sheila s’est mariée en 1982 à Allen Van Houte, avec lequel elle a eu deux filles. L’homme s’est déjà marié deux fois. Treize ans plus tard, elle est assassinée sur la commandite de son mari, qui la poursuivit d’une haine sans faille. Non qu’il aimait les enfants qu’elle lui a pris lors de leur divorce en 1987, mais il ne supportait pas qu’on lui résiste ou qu’on lui dise non. C’est donc l’histoire vraie d’un féminicide à la fin des années 90 que nous conte l’auteur, journaliste spécialisée dans les enquêtes de justice qui passionnent l’Amérique.
Allen est un pervers narcissique. Pas un psychopathe, au sens clinique du terme, mais quelqu’un dont l’enfance a été si massacrée qu’il n’a plus aucune empathie pour les autres. Il ne sait pas qui est son père, ce pourquoi il se choisira un nouveau nom, ce qui était très facile en Amérique. Il a choisi celui du personnage de Shogun, le roman populaire sur un samouraï blanc au Japon ; au XVIIIe siècle : Blackthorne. C’est sous ce nom qu’il a lancé une nouvelle société d’appareils médicaux, après avoir fait faillite à Hawaï à pillé le stock pour se relancer. Devenu millionnaire, tout lui semble possible, y compris son emprise sur son ex-femme et sur les deux filles, Stevie et Daryl qu’il a eues avec elle. Préférant les garçons, il leur a donné des prénoms de garçons. Cela ne l’empêche pas d’abuser sexuellement l’aînée avant qu’elle n’ait 7 ans. Ce fait n’a pas été condamné, ni clairement dénoncé, car, dans les années 1980 à 2000, la parole des enfants était sujette à caution et tout ce qui touchait la sexualité minimisé.
Allen croit que, puisqu’il a résisté aux mauvais traitements de sa mère et qu’il a finalement réussi une entreprise au Texas, tout lui est dû. C’est le syndrome du millionnaire arrivé, dont Trump est le dernier représentant. Les lois et le droit, il s’en fout. Seul compte son égoïsme sacré.
Il se remarie avec Maureen, avec laquelle il a deux petits garçons. Il aurait dû être content d’avoir divorcé et de vivre son bonheur dans cette nouvelle vie. Au lieu de cela, il ne cesse de harceler Sheila, son ancienne compagne, juste pour la tourmenter et la punir de l’avoir quitté pour mauvais traitements. Il va l’accuser de ses propres turpitudes, c’est-à-dire de fouetter ses filles sur les jambes, de leur donner des gifles, leur cogner la tête contre le mur. Cela n’empêche pas Sheila de cumuler courageusement deux emplois pour élever ses filles. Car leur père biologique refuse absolument de leur verser une pension alimentaire.
Mais la haine va plus loin. Il va commanditer « une bonne raclée » à sa femme, « et tant pis si elle meurt », déclare-t-il. Pour cela, il a demandé à un compagnon de golf qui, lui-même, va demander à un ami, qui contacte son cousin, un jeune assez benêt pour exécuter l’ordre sans réfléchir. Sheila, qui est partie vivre en Floride avec son nouveau mari Jamie et leurs quadruplés de deux ans, est tuée à son domicile en plein jour, devant les petits. Leur sœur aînée Stevie les retrouve tout nu et tout couverts de sang, pleurant auprès de leur mère morte.
Le procès va durer un certain temps, Allen s’entourant d’une brochette d’avocats très chers. Mais les procureurs de l’État comme les procureurs du FBI, puisque le crime s’est passé dans un autre État, vont s’acharner à dénoncer les manipulations d’Allen, ses mensonges et son implication dans le crime.
Allen Blackthorne sera finalement condamné deux fois à la perpétuité, ce qui n’a pas grand sens pour nous, mais qui en a un aux États-Unis, au cas où un vice de procédure annulerait la première condamnation. Il sera tué en prison par un gang à 59 ans, en 2014 (ce qui n’est pas dans le livre).
Ce fait divers a passionné l’Amérique et la journaliste Ann Rule en a fait un livre, selon son habitude et son talent. Ce n’est pas un thriller puisque l’on connaît la fin, mais, sauf quelques passages un peu longs sur les premiers temps d’Allen puis sur les détails du procès. Car tout est minutieusement détaillé dans ce livre de journaliste, de façon maniaque pourrait-on dire, car les Américains sont très pointilleux sur le droit. Soucieux de leur liberté, ils veulent d’infinies précisions quant à la pertinence de l’application d’une loi à leur encontre. Ce juridisme n’est pas toujours facile à rendre agréable à la lecture, mais ce récit dans l’ensemble se lit très bien.
Ann Rule, Jusqu’à ton dernier souffle (Every Breath you Take), 2001, Michel Lafon Poche 2022 ou occasion Livre de poche 2005, 441 pages, €7,60, e-book Kindle €7,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les enquêtes d’Ann Rule déjà chroniquées sur ce blog




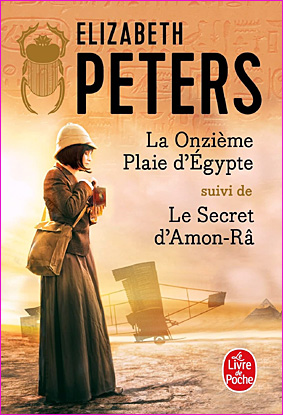


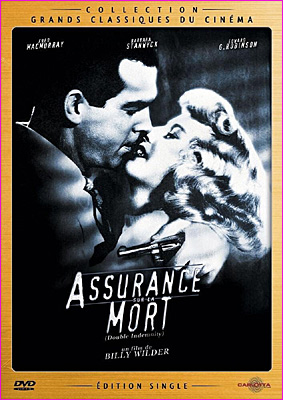
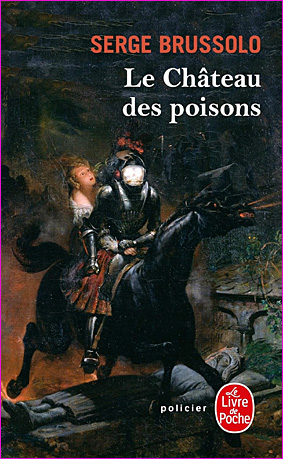



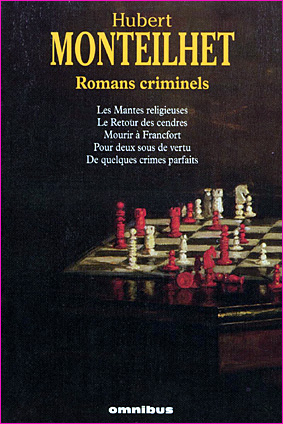
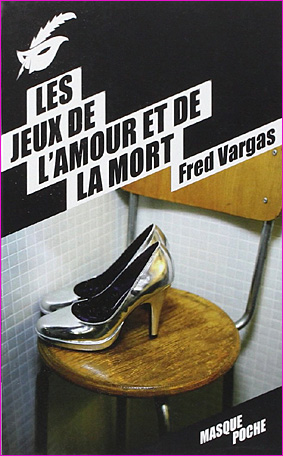
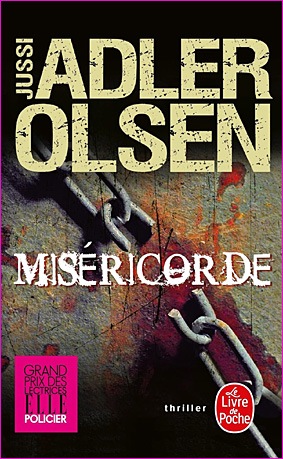
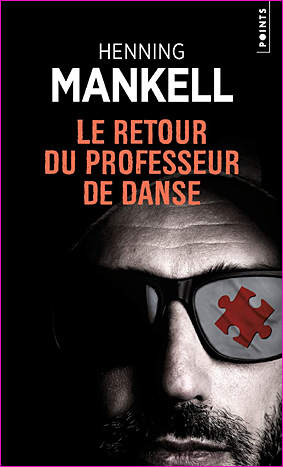

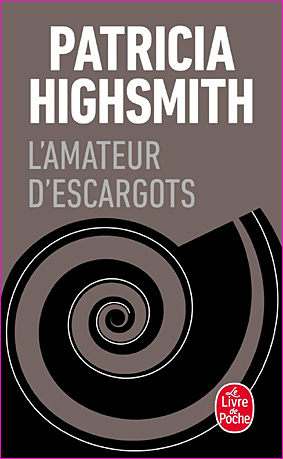
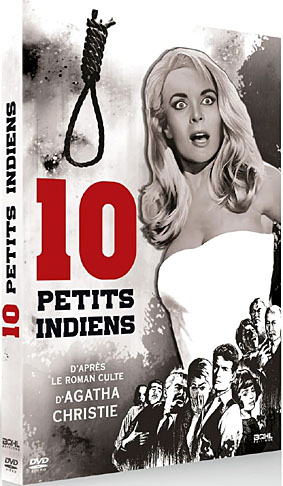








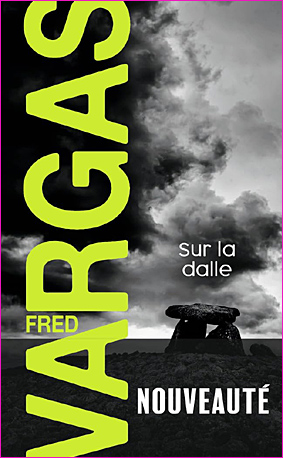


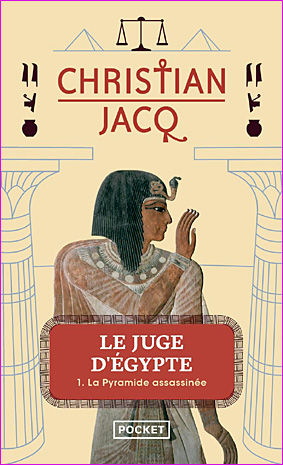
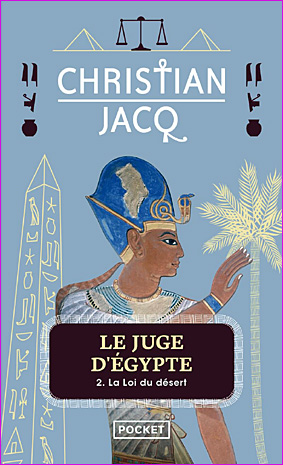
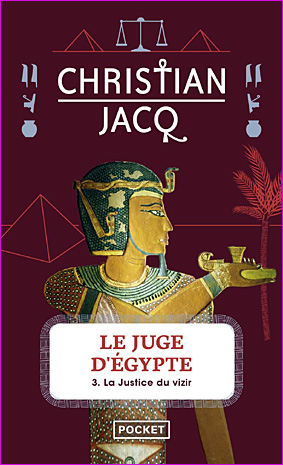
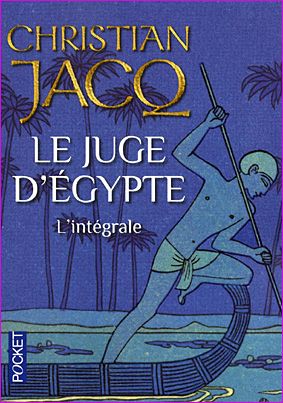
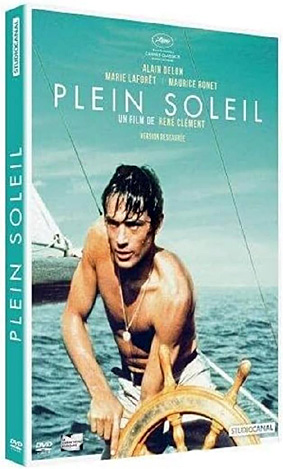















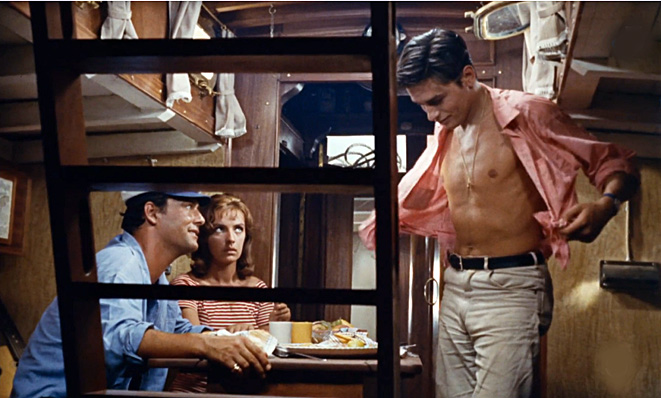


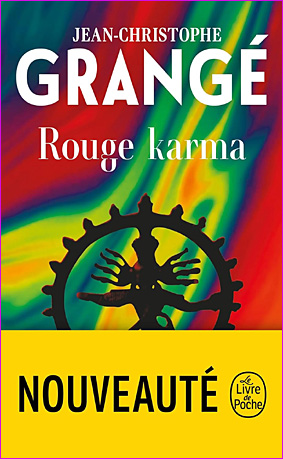
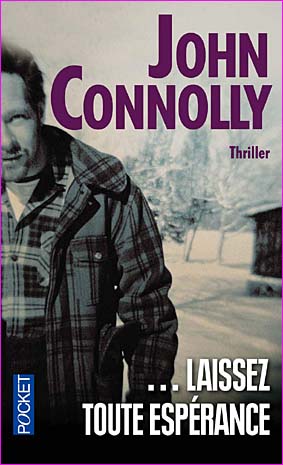
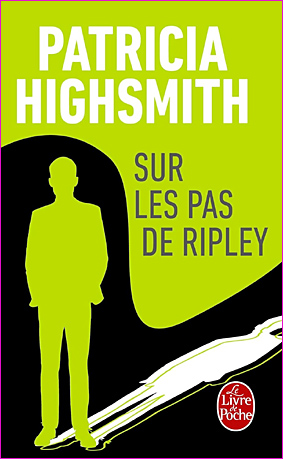


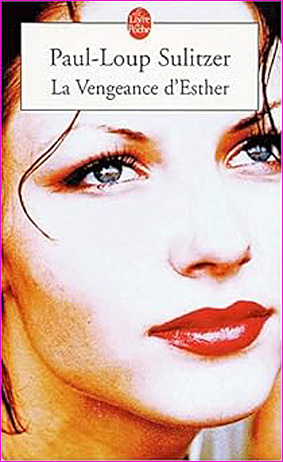
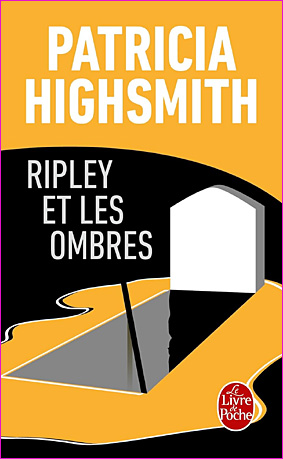
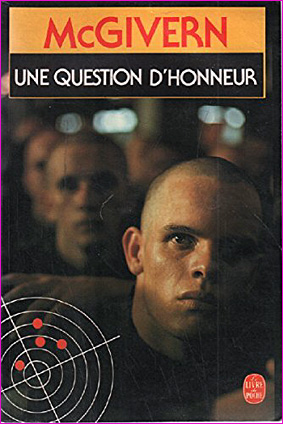
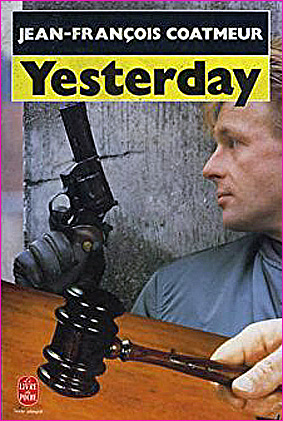
Commentaires récents