Le parallèle entre l’action d’Hitler et celle de Poutine me semble ressortir du mimétisme. Le kaguébiste empli de la grandeur de la sainte mère Russie, selon lui Troisième Rome de notre temps, est proche du messianisme délirant sur la « race » aryenne établie en grande Allemagne pour un règne de « mille ans ».
 Cela dès le départ :
Cela dès le départ :
- Tous deux sont possédés par « la patrie » au point d’en faire une terre de mission avec « espace vital » et glacis d’Etats tampons.
- Tous deux sont obsédés d’idéologie, pliant les faits à leur volonté, parfois audacieux mais souvent aveugles aux réalités des faits.
- Tous deux méprisent la démocratie, ce régime faible de parlotes où les médiocres prolifèrent.
- Tous deux vénèrent la force et agissent en cyniques, manipulant les masses et maniant le mensonge par tactique. Tout est bon pour réussir, même le pire.
- Poutine commence à 46 ans en faisant fomenter plusieurs attentats dans la banlieue de Moscou qui tuent trois cents civils en septembre 1999 ; Hitler est nommé chancelier à 44 ans et fait incendier dans la foulée le Reichstag tout en ouvrant le premier camp de concentration de Dachau.
- Poutine débute la guerre en Tchétchénie et l’asservit par une occupation suivie d’un régime à la botte. Cette violence crue de gamin des rues plaît aux Russes assez frustes ; la popularité de Poutine augmente, tout comme celle d’Hitler après chaque meeting aux affrontements sanglants des SA. Comme si la violence légitimait la foi, la rendait « de nature ».
- Une fois au pouvoir, Poutine comme Hitler mettent au pas les puissants qui croyaient avoir placé une marionnette aux fonctions suprêmes. C’est le cas des gros industriels pour Hitler, c’est le cas des oligarques pour Poutine. La plupart des grands médias passent aux mains amies, permettant à la propagande d’asséner l’idéologie.
- Les puissants politiciens ou industriels en opposition sont tués ou emprisonnés, lors de la Nuit des longs couteaux d’Hitler ou lors des empoisonnements, « suicides » ou balles dans la tête de Poutine.
Dès 2007 Poutine assume sa guerre contre le reste du monde. La Russie est une grande puissance affaiblie par les traités de 1991, les autres en profitent et notamment les Etats-Unis qui veulent dominer le monde. « L’Union soviétique à la fin des années 80 du siècle dernier s’est affaiblie, puis s’est complètement effondrée », déclare Poutine dans son discours du 24 février 2022 publié par l’agence officielle Tass. Hitler a fait de même : l’Allemagne, grande puissance affaiblie par le traité de Versailles, est asservie aux puissances alliées, les États-Unis en tête. Elle doit se réarmer et redresser la tête : ce que fait Hitler, ce que fait Poutine. Accuser les autres de ses propres travers est le b-a ba de la manipulation : la guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est l’esclavage ; l’ignorance, c’est la puissance. C’est Orwell 1984, c’est Hitler, c’est Staline, c’est Poutine. « Qui contrôle le passé contrôle le futur (…) qui contrôle le présent contrôle le passé ». D’où l’asservissement des médias et les « procès » contre ceux restés indépendants, l’interdiction de financements étrangers, la relecture des manuels scolaires et la réécriture de l’histoire dans le sens voulu. Poutine-Hitler, même combat.
Certes, les États-Unis ont exporté la guerre et Poutine le détaille dans son discours de revanche. En Afghanistan (mais il était le foyer du terroriste international Ben Laden, coupable des quelques 3000 morts des attentats du 11-Septembre), en Irak (mais Saddam Hussein avait tenté de faire assassiner le président des États-Unis), en Syrie (mais des armes chimiques, en violation des traités, avaient été utilisées par le régime et Bachar el-Hassad avait relâché exprès une myriade d’islamistes terroristes dangereux de ses prisons). Poutine ne dit rien de l’invasion soviétique (russe) de l’Afghanistan, ni de la mise au pas de la Hongrie en 1956, de la Tchécoslovaquie par les chars en 1968, de l’asservissement de la Pologne avec le général Jaruzelski en 1981, de la guerre en Géorgie en 2008. Il ne parle que de ce qui l’arrange. Son idée-force est vieille comme la Russie : la paranoïa de l’encerclement, la forteresse assiégée – tout comme l’Allemagne sous Hitler. « L’importance territoriale proprement dite d’un Etat est ainsi, à elle seule, un facteur du maintien de la liberté et de l’indépendance d’un peuple ; tandis que l’exiguïté territoriale provoque l’invasion », écrivait Hitler dans Mein Kampf. D’où la grande respiration exigée du Lebensraum, de l’espace vital nécessaire au peuple aryen-allemand pour se sentir en sécurité et avec les ressources naturelles nécessaires. Poutine recherche lui aussi un glacis contre « l’OTAN », comme si l’adhésion demandée par les ex-États du pacte de Varsovie était un machiavélisme américain et non pas une peur de la Russie par des États trop longtemps sous son joug. « Agrandir l’espace vital et assurer la subsistance du peuple russe », justifie-t-il – comme Hitler.
La Russie est fondamentalement européenne mais Poutine ne veut pas le savoir. Il se croit encore une puissance mondiale avec ses 142 millions d’habitants (moins que le Brésil aujourd’hui, autant que la Tanzanie ou les Philippines dans trente ans) alors qu’il n’est qu’un pays déclinant, au PIB proche de celui de l’Australie et du Brésil, face à une Chine conquérante, avançant – elle – à marche forcée vers le progrès et la puissance économique. Que sera la Sibérie (10 millions d’habitants seulement) dans quelques décennies, face à une Chine d’1,4 milliard d’habitants avides de matières premières et de territoires neufs ? Se rapprocher de l’Europe aurait du sens stratégique, pas de la Chine qui avalera sa proie sans sourciller – question de masse et de puissance. Il est étonnant qu’un adepte des rapports de forces comme Poutine ait ce genre de raisonnement de petit garçon vantard en cour de récré. Dans la théorie marxiste, le fascisme est la réaction des classes dirigeantes lorsqu’elles se sentent menacées ; un raidissement policier, moral et militaire pour faire front au changement. Poutine a été élevé par la théorie marxiste, il obéit à ce qu’il croit une loi de l’Histoire, son autoritarisme de réaction en témoigne.
Parce qu’il y a pour lui autre chose, de plus fondamental.
« En fait, jusqu’à récemment, les tentatives de nous utiliser dans leurs intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles et de nous imposer leurs pseudo-valeurs, qui nous rongeraient, nous, notre peuple, de l’intérieur, ces attitudes qu’ils imposent déjà agressivement dans leurs pays et qui mènent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car elles sont contraires à la nature humaine elle-même, n’ont pas cessé », déclare encore Poutine dans son discours du 24 février. Il accuse l’Occident de véhiculer des valeurs de dérision, de pornographie, de perversion des mœurs, de changements de sexe, d’avortements de convenance, de métissage racial – tout ce que dénoncent en France Zemmour, aux Etats-Unis Trump, en Hongrie Orban, et hier Hitler dans la République de Weimar comme dans l’empire austro-hongrois. La Russie de Poutine comme les réactionnaires occidentaux sont revenus à la mentalité catholique bourgeoise de 1857 du procès contre Madame Bovary, avant celui contre Les Fleurs du mal. Il était reproché « l’immoralité » d’exposer des faits réalistes sans personnage ni auteur pour les juger. En effet, la démocratie demande à chacun d’être juge, pas à l’Eglise ni à l’Etat : c’est cela, la liberté.
Mais ce qui est débat démocratique chez nous (environ un tiers des Français sont d’accord avec la droite extrême aujourd’hui) est blasphème chez lui : il ne discute pas, il interdit. Comme Hitler dans Mein Kampf : « Il ne s’offrira donc dans l’avenir que deux possibilités : ou bien le monde sera régi par les conceptions de notre démocratie moderne, et alors la balance penchera en faveur des races numériquement les plus fortes ; ou bien le monde sera régi suivant les lois naturelles : alors vaincront les peuples à volonté brutale, et non ceux qui auront pratiqué la limitation volontaire ». Poutine ne se sent pas « européen » dans ce sens-là des libertés. Il fait siens les propos d’Hitler dans son livre de combat : « plus le véritable chef se retirera d’une activité politique, qui, dans la plupart des cas, consistera moins en créations et en travail féconds qu’en marchandages divers pour gagner la faveur de la majorité, plus la nature même de cette activité politique conviendra aux esprits mesquins et par suite les captivera ». Il veut guider le peuple comme le chef charismatique qu’il se croit après 22 ans de pouvoir sans partage : un Führer, un Petit père des peuples, un Grand timonier, surtout pas lui laisser la liberté, ni la responsabilité qui va avec.
Lorsqu’il déclare « Au cœur de notre politique se trouve la liberté, la liberté de choix pour tous de décider de manière indépendante de leur avenir et de l’avenir de leurs enfants », ce n’est rien moins qu’Hitler réclamant la liberté pour « la race » de vivre selon sa force et de s’épanouir sans contraintes… sous le régime du Guide. Les opposants sont des malades mentaux, des inconscients, des pervertis, des « espions de l’étranger ». En bref : la liberté, c’est l’esclavage. N’expose-t-il pas, Poutine, que « le bien-être, l’existence même d’États et de peuples entiers, leur succès et leur vitalité trouvent toujours leur origine dans le puissant système racine de leur culture et de leurs valeurs, de l’expérience et des traditions de leurs ancêtres et, bien sûr, dépendent directement de la capacité de s’adapter rapidement à une vie en constante évolution, de la cohésion de la société, de sa volonté de se consolider, de rassembler toutes les forces pour aller de l’avant » ? Adolf Hitler dans Mein Kampf écrivait : « Qu’on élève le peuple allemand dès sa jeunesse à reconnaître exclusivement les droits de sa propre race; qu’on n’empoisonne point les cœurs des enfants par notre maudite « objectivité » dans les questions qui ont trait à la défense de notre personnalité ». Ein Volk ! Ein Reich ! Ein Führer ! En Allemagne hier comme en Russie aujourd’hui.
En ce sens, l’allusion à « une anti-Russie » dans le discours vise moins à la sécurité militaire qu’au mauvais exemple donné par les libertés à l’occidentale. La Russie de Poutine ne veut pas être contaminée par les contestations « démocratiques » – ce pourquoi on empoisonne, on emprisonne, on interdit l’ONG Memorial qui documentait les crimes soviétiques, on accuse de « pédophilie » ou de malversations financières tous les opposants aux pseudo « élections ». C’est que la démocratie autocratique n’a rien de la démocratie : le peuple ne décide pas, il se contente d’acquiescer et de faire comme on lui dit. Il s’agit clairement d’une tyrannie : selon Aristote, la tyrannie est lorsque « le pouvoir politique est entre les mains d’une seule personne cherchant son propre bien ou celui de sa famille ». Le chaos démocratique des opinions contradictoires qui se percutent et négocient un compromis majoritaire n’est pas dans l’ADN du Kremlin et, depuis la révolution orange de 2004 puis les manifestations de Maidan de 2014, l’Ukraine prenait la pente européenne des démocraties – un danger suprême pour le pouvoir de Poutine ! Le mauvais exemple d’un pays-frère qui pourrait faire tache d’huile à la Navalny (Ukrainien par son père).
Dès lors, le mécanisme à l’hitlérienne de l’invasion est planifié.
Comme dans les Sudètes où une présence allemande avait fait « appeler » la Grande Allemagne au secours pour réunifier le peuple germanophone de Tchécoslovaquie, « les républiques populaires du Donbass ont demandé l’aide de la Russie », dit Poutine dans son discours. Elles servent de base et de prétexte contre « des abus et à un génocide par le régime de Kiev ». Cela après l’annexion manu militari de la Crimée considérée comme historiquement russe (comme Hitler fit de la Sarre et de l’Autriche). C’est une politique internationale analogue à celle des SA dans la rue ; une politique que le très jeune Vladimir a pratiqué dans les rues de Leningrad avant d’être repris en main à 16 ans par un « bienfaiteur ». Les négociations « à Munich » rappellent celles d’Hitler (quelle bourde de la diplomatie allemande ou européenne que d’avoir fixé à Munich ces pseudo-négociations avec Poutine ! Les technocrates n’ont-ils aucune notion du symbole?). Négocier ne signifie d’ailleurs pas grand-chose pour les Hitler ou Poutine : « ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable », disait-on du temps de l’URSS. Staline l’avait appris d’Hitler et Poutine le reprend à son compte. Le protectorat hier de Bohème-Moravie veut se transformer aujourd’hui sous Poutine en protectorat d’Ukraine-Moldavie.
Pour cela, accuser les autres, les ennemis, de « génocide », de « nazisme ». Le président juif Zelenski de l’Ukraine ne fait pas un nazi crédible, il serait plus du côté des cabarets de la République de Weimar lorsqu’il joue du piano avec sa bite (pour les puritains religieux horrifiés, il s’agit d’une illusion comique – on ne voit aucun sexe). L’injure « hitléro-fasciste », comme le rappelle le trotskiste Alain Krivine récemment disparu, est l’anathème favori des staliniens – il ne recouvre rien d’autre que la haine absolue contre ce qui représente l’antiparti, la lutte à mort. Lorsque l’armée de Poutine rase sous les bombes la maternité de la ville (russophone) de Marioupol (comme à Grozny en Tchétchénie, comme à Alep en Syrie), est-ce pour éradiquer les bébés nazis ? A chaque fois les frappes russes visent intentionnellement les populations civiles, les hôpitaux et les secours – y compris les convois humanitaires ; c’est une tactique de terreur volontaire. Vous ne vivrez que si vous vous soumettez, sinon on empilera vos têtes comme le fit Gengis Khan.
Lorsque Poutine évoque dans son discours « les bandes punitives des nationalistes ukrainiens, collaborateurs d’Hitler pendant la Grande Guerre patriotique, [qui] ont tué des gens sans défense », on dirait qu’il parle de ses propres bandes armées lorsqu’elles envahissent l’Ukraine. Comme toujours, accuser les autres du mal qu’on fait est la base de la manipulation. Un mot sur les « nazis » ukrainiens : ils existent mais ont peu de chose à voir avec ceux d’Hitler. Une milice privée nationaliste analogue au groupe russe Wagner s’est créée en 2014 après le séparatisme du Donbass encouragée par la Russie ; elle a été financée par un oligarque ukrainien juif, Kolomoïsky, parce que le gouvernement ne se défendait que mollement. Elle ne comprenait que quelques centaines d’hommes. Versée en 2016 dans l’armée régulière sous le nom de régiment Azov, elle attire surtout les jeunes qui en veulent, y compris de nombreux juifs qui sont nationalistes mais pas nazis ! Même si quelques symboles du passé sont repris, c’est clairement contre les Russes, qui ont affamé l’Ukraine en 1932-33 et ont entraîné 5 millions de morts ; lorsque les vrais nazis sont arrivés, une division de grenadiers SS nommée Galicie a été constituée par les nationalistes ukrainiens opposants à l’Union soviétique. Il s’agit donc d’une réponse en défense d’une attaque, pas d’une idéologie née de rien, ni surtout « encouragée » par l’Occident (le Congrès américain en a interdit en 2015 le financement, avant que cela ne soit aboli par l’équipe Trump).
Mais à quoi bon tenter de réfuter des mensonges aussi bruts que ceux qui les profèrent ? Seule la force des mots compte, pas la réalité des faits. Il y a comme un suicide analogue à celui d’Hitler dans l’attitude jusqu’au-boutiste de Poutine qui préfère sacrifier sa race aryenne son peuple russophone à ses idées obtuses… Le bombardement des abords d’une centrale nucléaire ukrainienne est de cette eau, tout comme la répétition des menaces d’user de la Bombe au cas où « l’OTAN » franchirait une « ligne rouge ».
Oui, il y a bien des parallèles entre Poutine et Hitler !












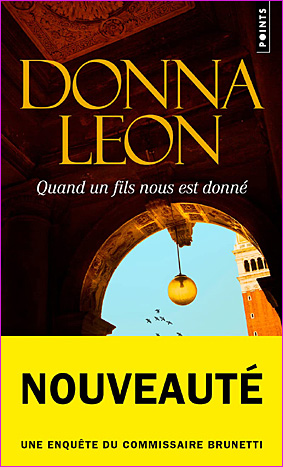


 Cela dès le départ :
Cela dès le départ :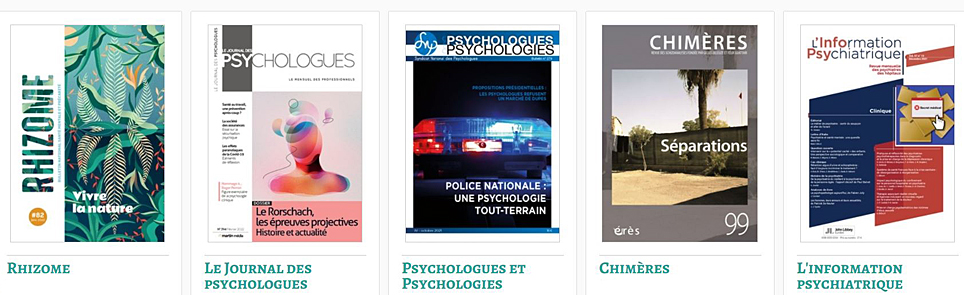
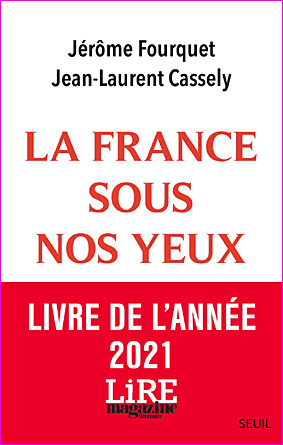



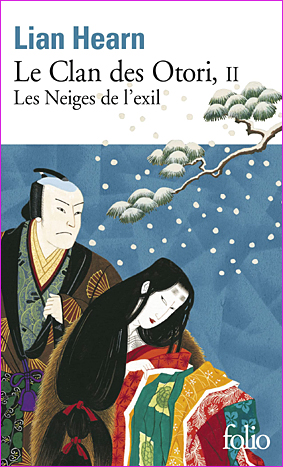


















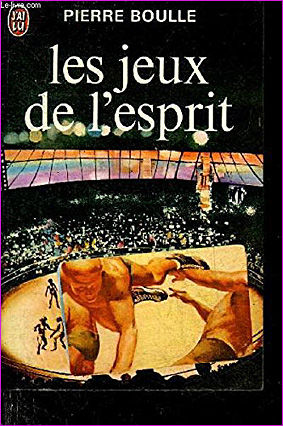
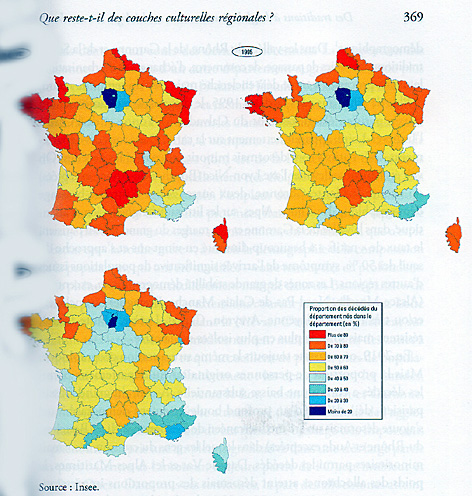
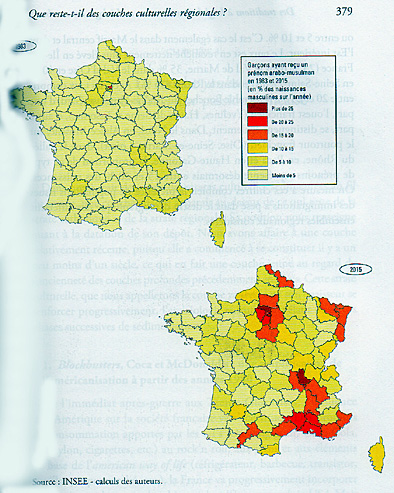

























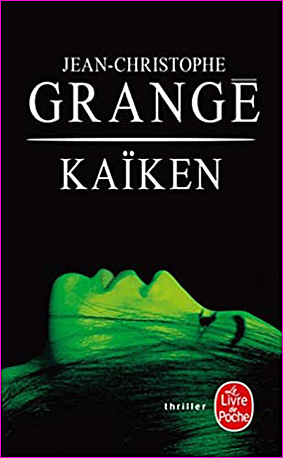
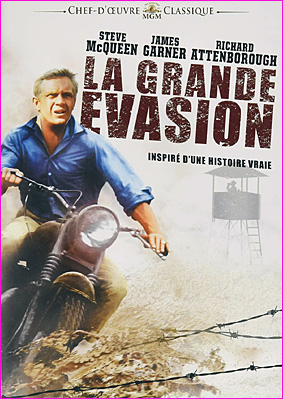











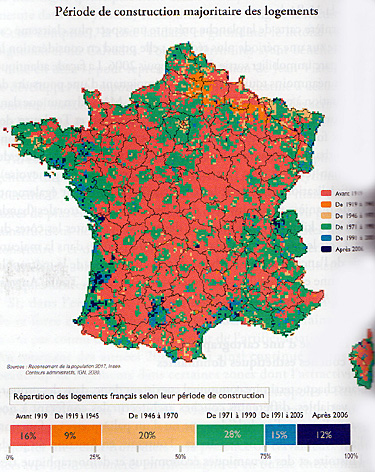
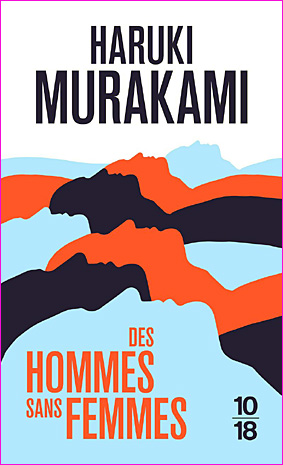
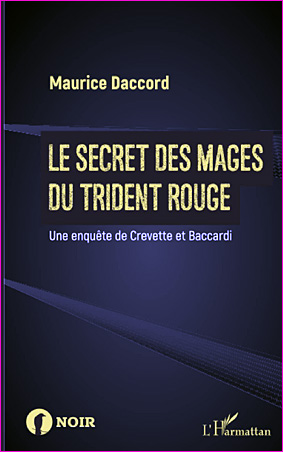
Commentaires récents