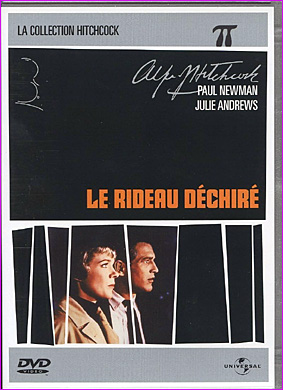
Méprisé par les critiques mais succès financier, ce long film sur la guerre froide n’a rien d’ennuyeux mais privilégie le suspense. Le professeur Armstrong (Paul Newman), chercheur en physique nucléaire, a échoué sur un projet de missile anti-missile et veut savoir comment son homologue à l’Est Gustav Lindt (Ludwig Donath) a réussi ses calculs. Quoi de mieux, pour le savoir, que de feindre une défection à l’Est, et à travailler avec Lindt pour lui soutirer ses secrets ? La curiosité, l’émulation, l’illusion que l’autre sait et pas soi, suffisent en général à livrer les informations que l’on désire. Au milieu des années 60, l’URSS et sa vitrine est-allemande, faisaient encore rêver d’un monde nouveau, sans classe et voué au progrès humain dans la paix. La Russie avait la première envoyé des satellites, menacé les États-Unis dans leur arrière-cour à Cuba, et engagé de grands travaux agricoles autour de la mer d’Aral pour y planter du coton.
Sur cette psychologie éprouvée, le scénario plaque une romance mièvre avec Sarah, l’assistante d’Armstrong (Julie Andrews), qu’il a le mauvais goût de faire sa « fiancée » tout en reculant toute perspective de mariage. Il n’empêche même pas cette collante qui veut tout faire avec son futur et toujours « être d’accord » avec lui, de l’accompagner à Copenhague, surveiller ses activités, le suivre lorsqu’il prend le même avion pour Berlin-Est via une compagnie roumaine (alors qu’il lui avait menti en disant qu’il allait à Stockholm). Cette sangsue sans personnalité, bourgeoise conformiste, complètement inadaptée au monde communiste comme à la psychologie de l’espionnage, sera à la fois le trublion de l’histoire et le ressort du suspense.



A Berlin-Est, accueilli par le vice-président de la RDA et les journalistes de la presse internationale, il annonce sa défection et se retrouve flanqué d’un garde de la Stasi, Gromek (Wolfgang Kieling), vêtu d’un manteau de cuir comme un vulgaire nazi et mâchant un éternel chewing-gum comme un vulgaire titi de New York. Il dit y avoir vécu quatre ans et « teste » Armstrong pour voir s’il ne ment pas sur sa connaissance de la ville. Dans l’Hôtel de Berlin, Armstrong finit par persuader Sarah de rester dans sa chambre pour « réfléchir » tandis qu’il prend un bus pour aller au musée, semer Gromek, et se rendre en taxi dans une ferme de la grande banlieue, où son contact de l’organisation de résistance Pi (la lettre grecque) lui donnera sa filière d’évasion.
Mais Gromek réussit à le suivre et le confronte à la lettre Pi, signe de l’organisation qu’il connaît. Armstrong est obligé de le tuer en l’étranglant, avec l’aide de la fermière qui d’abord le poignarde (mais le couteau casse, comme tout mauvais outil socialiste) puis ouvre le gaz et réussi lourdement à le traîner dans le four. Elle l’enterrera, avec sa moto. Hélas, le chauffeur de taxi a vu Gromek et, lorsque sa tête paraît dans les journaux en signalant sa disparition, court à la police pour l’informer (en bon soviétique ex-nazi discipliné). Armstrong, moins chercheur éthéré qu’il ne paraît, doit fuir au plus vite avec sa moitié en éternels hauts talons collée à lui.


Il a été emmené à Leipzig, dans l’université moderne Karl Marx où cherche et enseigne Lindt. Il est interrogé dans un amphi par un aréopage de chercheurs sur ses connaissances utiles à la RDA, notamment ce projet Gamma 5 dont ils ne savent pas qu’il a échoué. Mais la sécurité vient susurrer à l’oreille du chef la disparition de Gromek et les doutes sur Armstrong. Interrogé, le professeur confirme qu’il a bien été voir « une parente » dans une ferme, mais qu’il n’a pas vu Gromek. Il aurait dû dire qu’il l’avait vu, et ce mensonge aura des conséquences – il faut toujours rester très près de la vérité pour semer le doute. Le professeur Lindt est agacé : toujours ces sécuritaires qui inhibent toute initiative au nom de leur paranoïa. Puisque Sarah est son assistante, elle peut peut-être parler des expériences Gamma. Elle refuse, montrant qu’elle ne veut pas « trahir » son pays, mais son fiancé, en une conversation, la retourne en lui avouant qu’il « est d’accord » avec elle et qu’il est en mission. Retrouvant son fusionnel, la fille accepte immédiatement ce qu’elle vient juste de refuser. Cela ne surprend personne, souvent femme varie.
Le docteur Koska (Gisela Fischer), femme médecin de l’université, fait un croche-pied à Armstrong dans l’escalier, afin de le soigner à l’abri des regards et des écoutes. Elle appartient à l’organisation Pi et lui souffle son prochain contact pour l’évasion, prévue dès le lendemain. Il ne faut pas traîner, la sécurité va les arrêter pour les interroger sur la disparition de Gromek, qu’Armstrong a forcément vu, puisque le chauffeur de taxi les a vus ensemble entrer dans la maison. In extremis le lendemain, alors que le délai pour l’évasion est déjà dépassé, Armstrong pousse Lindt à dévoiler ses calculs sur tableau noir. Piqué par ce qu’il considère comme des erreurs de formules mathématiques de l’Américain, il lui livre la bonne équation, qu’Armstrong s’empresse de mémoriser, avant de la noter sur papier tandis que Lindt, qui vient de découvrir effaré qu’il ne sait rien, prévient la sécurité.


Armstrong et sa Sarah prennent un faux bus « supplémentaire » de la ligne Leipzig-Berlin-est qui appartient à la résistance. Mais diverses péripéties (le retard initial, les mauvaises routes qui empêchent de foncer, une attaque de « déserteurs », une escorte ensuite de motards de la police, l’obligation désormais de prendre des passagers dont une vieille dame maladroite encombrée de valises et paquets) le font rattraper par le bus régulier et tous les passagers doivent s’égayer brusquement dans les rues, malgré les balles de la police. Leur prochain contact est à chercher au bureau de poste de la Friedrichstraße, mais comment le trouver sans parler allemand ? Le couple rencontre la comtesse polonaise décatie Kuczynska (Lila Kedrova), qui les aide en contrepartie d’être ses « répondants » aux États-Unis pour un visa d’immigration. La Stasi est prévenue par le gardien de sécurité de la poste (ils sont partout) et le couple doit fuir dans les rues. Les deux sont rejoints sur le trottoir par l’ex-agriculteur de la ferme qui leur donne deux billets pour un spectacle de ballets. Ils doivent à l’entracte, passer dans les coulisses, où un complice les fourrera dans deux malles en osier à costumes, en route dès le soir même pour la Suède, où le ballet doit se produire.
La ballerine étoile (Tamara Toumanova) reconnaît parmi les spectateur Armstrong, qui lui avait volé la vedette des photographes à sa descente d’avion à Berlin-Est, et le signale aux gardiens de sécurité, qui préviennent la Stasi. Les gardes armés qui bloquent les issues provoquent chez Armstrong le cri « au feu » en allemand, donc à la panique, à la faveur de laquelle ils parviennent à joindre les coulisses et à être cachés. Nouveau suspense au débarquement en Suède, les panières en osier sont prêtes d’être débarquées quand la ballerine a un doute ; elle prévient les gardes de sécurité du bateau, qui tirent dessus à la mitraillette. Hélas pour eux, il n’y a que des costumes déchiquetés. Les vraies panières sont ouvertes un peu plus loin, car le résistant en charge avait observé les regards de la ballerine, et les passagers clandestins envolés par plongeon dans l’eau froide de la Baltique, désormais en territoire « libre ».

Si l’intrigue reste soutenue, malgré les invraisemblances, la magie entre les acteurs n’opère pas. Julie Andrews se demande ce qu’elle fait avec Paul Newman et reste sur un registre mémère conventionnelle ; Paul Newman n’apparaît ni comme chercheur convaincant, ni comme espion crédible, ses actes décisifs étant plus dictés par le scénario que sortis de lui-même. Ce sont les acteurs secondaires qui donnent sa vie au film, Gromek, Lindt, la fermière, la ballerine. Le titre, énigmatique, ne donne pas envie, même s’il fait référence au « rideau » de fer. La musique a été changée, John Addison remplaçant Bernard Herrmann (le DVD donne les deux versions, celle d’Herrmann exclusivement en vo). Malgré tout cela, on ne s’ennuie pas car l’action est soutenue par des rebondissements inattendus et le paysage soviétique bien rendu dans sa pauvreté mentale, la tristesse de ses immeubles et de ses habitants, et la sécurité bureaucratique omniprésente à tous niveaux (de quoi créer des emplois, non-productifs et brimant toute initiative). Un avenir qui nous attend avec la conjonction idéologique Trumpoutine ?
DVD Le rideau déchiré (Torn Curtain), Alfred Hitchcock, 1966, avec Hansjörg Felmy, Julie Andrews, Lila Kedrova, Paul Newman, Tamara Toumanova, Universal Pictures Home Entertainment 2001, Doublé : Anglais, Espagnol, Français, Italien, 2h03, €11,80, Blu-ray €36,00 Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)


























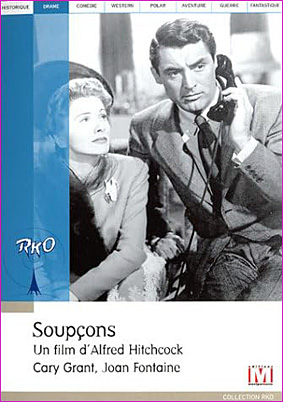














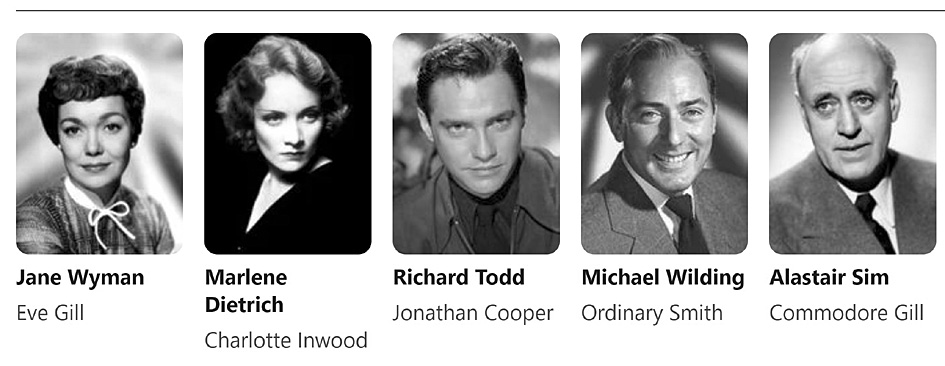
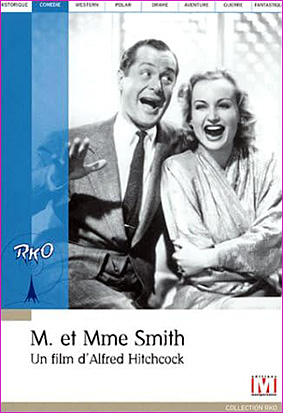









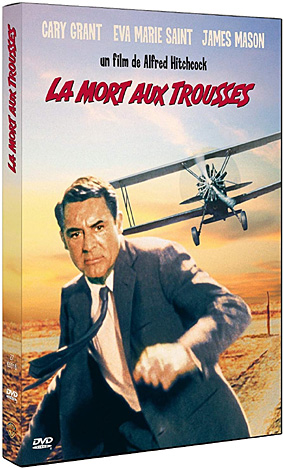









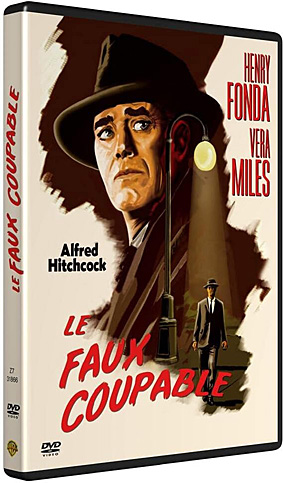




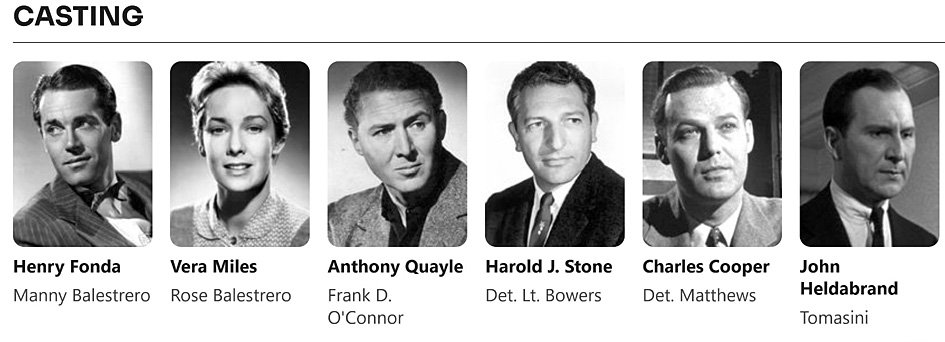
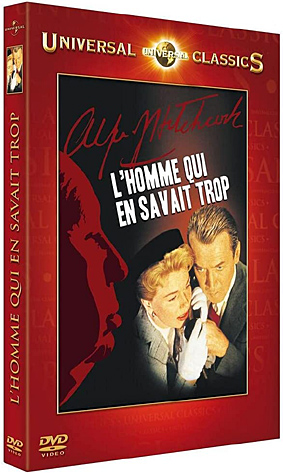













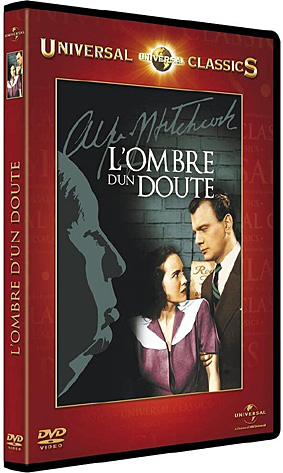








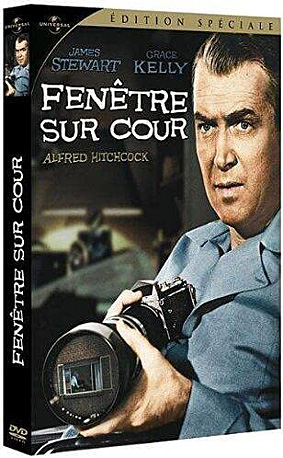



















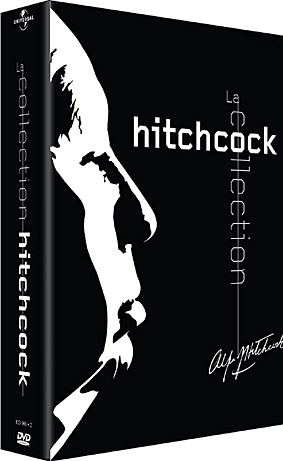


















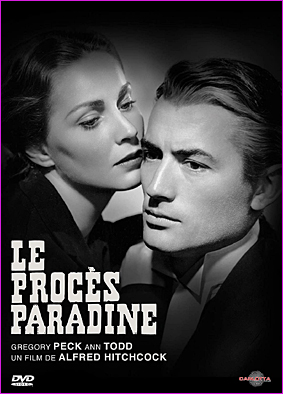








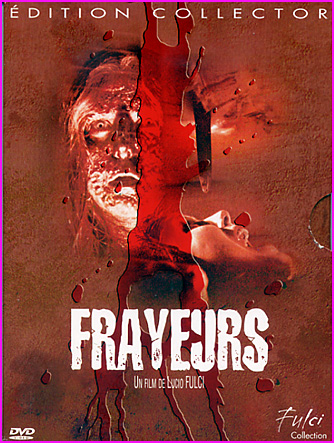










Commentaires récents