
Mariée à Ishun (Eitarō Shindō), Grand imprimeur à privilèges de la Cour impériale japonaise en 1684 – mais de trente ans plus âgé qu’elle – San (Kyōko Kagawa) n’est pas heureuse. [Le O’San n’est qu’un préfixe de respect et n’a rien à faire dans une traduction moderne : hier on disait l’honorable San, aujourd’hui simplement San.] Son frère Doki (Haruo Tanaka) ou sa mère viennent sans cesse la solliciter pour quémander de l’argent. Le frère, désormais chef de maison, se croit artiste de chant et se la coule douce. Mais, cette fois, s’il s’agit d’une petite somme, « un demi-kan d’or » (soit, 1875 kg, au prix actuel de l’or environ 92 000 €). Elle est destinée à payer l’hypothèque de la maison familiale qui, autrement, sera saisie, la famille ruinée, le déshonneur sur elle. San promet de demander à son mari. Mais celui-ci, trop sollicité, refuse tout net. Il n’est pas la vache à lait des familles ; lui travaille, ils n’ont qu’à travailler.

S’il est radin pour sa famille, il est prodigue pour ses plaisirs égoïstes, en bourgeois individualiste dans une société féodale collectiviste – ce qui le perdra. Il profite des privilèges que lui vaut son négoce auprès des nobles de la Cour, à qui il prête de l’argent qui ne lui sera jamais remboursé, et des privilèges du maître dans sa propre maison : il sollicite la jeune servante Tama (Yōko Minamida) pour qu’elle couche avec lui. Il va jusqu’à lui promettre de lui acheter une maison afin que leurs ébats soient discrets ; s’il ne peut être aimé pour lui-même, il peut acheter du sexe. Mais Tama n’a que faire d’un vieux libidineux ou de l’argent ; elle est amoureuse de l’intendant en second, Mohei (Kazuo Hasegawa), beau jeune homme de son âge encore en apprentissage. Lequel voue un amour secret à San, sa maitresse de Maison.

La tragédie qui se noue vient de ce que chacun désire autre chose que ce qu’il peut avoir dans une société hypocrite qui ne fonctionne que par le rang et l’honneur. Le pouvoir n’est rien sans l’argent, mais l’argent n’est rien sans le pouvoir et Ishun, grand bourgeois qui singe les samouraïs, n’est pas noble, donc à la merci des fonctionnaires de la Cour qui donnent les distinctions.
San demande à Mohei la faveur de lui prêter ce demi-kan d’or. Mohei n’a pas la somme et se prépare à user du sceau du Maître sur une feuille vierge pour faire un faux. Sukeimon (Eitarō Ozawa), le premier intendant, le surprend et lui demande de rajouter la même somme à son profit pour prix de son silence. Ce n’est pas la première fois qu’il détourne de l’argent et Mohei le sait. Mais lui, Mohei, n’a jamais trempé dans ces faux et il se rend compte de l’engrenage qui le guette. S’il honore San en lui donnant la somme par un faux en écriture en volant son mari, il avilira son amour pour elle. Même s’il envisage de rembourser son patron dans le futur, son penchant en restera entaché. Il renonce donc et va se dénoncer au Maître, qui le prend fort mal. Pourtant, cet élan d’honnêteté aurait dû le conduire à pardonner et à mieux considérer cet employé. Mais son pouvoir sur les autres l’aveugle et il s’obstine à demander à Mohei à quoi ou à qui était destiné cette somme, ce que le garçon refuse par honneur de dire.
Malgré les objurgations de San, qui est responsable, et de Tama qui l’aime, Mohei sera donc enfermé dans un entrepôt gardé par deux jeunes garçons et livré à la police le lendemain. Connaissant le Maître, le jeune homme sait qu’il ne reviendra pas sur sa décision et il prend le parti de s’évader, ce qui n’est guère compliqué quand les adolescents dans le foin sont endormis.

San avoue à Tama que la demande vient d’elle et qu’elle ne sait trop que faire devant l’obstination de son mari. Tama lui apprend alors avec réticence et honte les avances que lui fait le Maître pour qu’elle le laisse abuser d’elle. San décide alors de prendre sa place dans la chambre, sous le futon, et de confondre son mari, ce qui lui donnera un moyen de pression en faveur de Mohei. Mais ce dernier, qui vient faire ses adieux à Tama, découvre San et lui dit son intention de quitter la maison. Celle-ci, qui a si peu de personnel en qui avoir confiance, ne veut pas qu’il parte, persuadée qu’elle peut faire revenir Ishun sur sa décision avec ce qu’elle sait de ses avances à Tama. Au lieu d’être ferme sur ce qu’il veut et mâle dans sa décision, Mohei reste hésitant et tergiverse. Le temps passe, son évasion est découverte, les serviteurs le cherchent dans la maison. Le mari étant parti aux putes pour se réconforter, le premier intendant cherche la maitresse de maison. Il découvre Tama dans sa chambre et, se précipitant dans celle de Tama, San et Mohei tombés l’un sur l’autre. Il ne s’est rien passé, qu’un mouvement de panique pour retenir Mohei, mais le mal est fait : la réputation de San est compromise.
Mohei s’enfuit, San affronte son mari sans les armes qu’elle avait affûtées. Il ne croit pas ses explications, bien content de sauver son plaisir personnel par la faute sociale de sa femme. San est une fois de plus traitée en objet de parure insignifiant et pas en être humain ni en épouse. Le machisme de la société japonaise du XVIIe siècle est patent. Elle quitte donc la maison, ne voulant plus vivre auprès de ce vieux porc égoïste.
Le drame est qu’elle rencontre Mohei par les rues de Kyoto. Il lui conseille raisonnablement d’aller chez sa mère mais San n’a rien de raisonnable. Epouse bafouée, femme déshonorée, fille en dette envers sa famille qu’elle n’a pas su renflouer, il ne lui reste que le suicide. Mohei, qui l’aime sans lui avouer, en est effaré. Il ne l’abandonnera pas. Se déroule alors implacablement la tragédie de l’amour impossible – jusqu’à la mort. Tragédie parce que tout est écrit d’avance et que les pauvres papillons aveuglés par la lumière de leur passion connaissent déjà le sort qui leur sera réservé : celui des amants convaincus d’adultère que l’on va crucifier en procession devant la foule assemblée, tels que ceux qu’ils ont vu passer la veille devant l’imprimerie.

Le mari, prévenu de la fuite des deux est persuadé qu’ils sont amants et envoie son personnel les rechercher. Devant la Cour il veut éviter le scandale et exige que San soit ramenée seule et que Mohei soit livré à la police. Ou, s’ils se sont suicidés, seule façon de réparer le déshonneur dans une société d’ordres fondée sur la réputation, que leurs corps soient séparés avant d’en aviser les autorités. Mais des invités nobles entendent une partie de conversation qu’Ishun a avec son intendant et supputent tout le profit qu’ils pourraient en tirer. Ils verraient bien sa ruine, ce qui épongerait d’un coup leurs dettes envers lui et rabaisserait sa prétention. Les cloisons des maisons traditionnelles japonaises sont en papier et les apparences ne peuvent se sauver entièrement. Le premier intendant est suborné par le second imprimeur de la Cour, Isan (Tatsuya Ishiguro), chargé des Parchemins, qui lui laisse miroiter son poste dès qu’Ishun sera tombé et qu’il aura pris le sien. Dès lors, argent, pouvoir, honneur, tout concourt à la perte des amants, ce n’est qu’une question de temps.

Ils fuient, s’échappent habilement lorsqu’ils sont reconnus, mais ne vont pas très loin. Marcher à pied avec une femme plus habituée à la litière n’est ni de tout repos, ni vraiment efficace. Ils sont reconnus par un colporteur à deux jours de Kyoto. Il leur faudrait se séparer et Mohei le propose raisonnablement : le mari reprendrait son épouse pour éviter le scandale et lui pourrait peut-être échapper aux poursuites en se réfugiant dans une grande ville anonyme comme Osaka. Mais San ne veut plus quitter Mohei. Juste avant qu’elle se suicide par noyade dans le lad Biwa, il lui a en effet avoué son amour secret pour elle et cela change tout. Elle l’aime en retour parce qu’il est tout ce que son mari n’est pas : jeune, dévoué, protecteur, généreux. Et qu’elle ne veut plus subir le carcan social, la loi des autres, de sa mère, de son frère, de son mari, qui ne lui ont apporté que des déboires. Sa passion personnelle jusqu’alors contenue par les conventions sociales devient effrénée, donnant une impulsion aux engrenages de la tragédie. Il essaye de l’abandonner aux mains d’une vieille femme, elle le rattrape ; retrouvés par les hommes d’Ishun, San ramenée de force à Kyoto chez sa mère, Mohei s’évade avec l’aide de son père et va… la rejoindre à Kyoto. Lui non plus ne peut plus la quitter.


La mère de San est effarée : c’est la ruine assurée de tout le monde, du couple et de leurs deux familles, celle du mari Grand imprimeur et la sienne, le déshonneur complet. Mais rien n’y fait, la raison n’atteint plus ni San, ni Mohei. Ils sont dénoncés par Doki, pris, jugés, et crucifiés. Ce supplice chrétien est considéré comme vil depuis que le christianisme a été interdit en 1613 par le shogun et les convertis massacrés à Nagasaki. Mais ils sont heureux car amoureux, au-delà des classes car humains, rayonnants sur le cheval qui les conduit ligotés au sacrifice ; ils sont égarés, loin des lois sociales, par des lois supérieures. Mohei est innocent, mais c’est aussi sa faiblesse : pas coupable mais demeuré enfant. Il n’aurait pas dû rester pur en refusant de voler individuellement pour le bien social de sa maitresse, donc de la réputation des familles. Celle de San n’aurait pas dû vendre sa personne à un vieux riche laid pour se sauver socialement de la ruine. Mais les purs sont condamnés d’avance car ils ne transigent sur rien alors que les hypocrites s’en sortent toujours car ils changent d’avis et retournent leur veste. Les individus sont écrasés par le collectif social s’ils ne s’y soumettent pas.

A la fin, la société et ses conventions, malgré son code d’honneur féodal, n’a pas été plus forte que la passion qui, elle, est vraiment chevaleresque. Le Maître Ishun, qui n’a pas dénoncé les amants, est exilé, ses biens saisis ; le premier intendant est convaincu d’avoir piqué dans la caisse et banni ; le frère flemmard, par qui tout est arrivé, est forcé de se prendre en mains tout seul. Il a compté sur le mariage arrangé de sa sœur pour continuer à vivre sans travailler et faire des dettes, épongées régulièrement par son beau-frère trop riche… jusqu’au refus définitif, qui va tout précipiter.
Tiré de La légende du grand parcheminier de Monzaemon Chikamatsu (1653-1724), Mizoguchi réalise en vingt-neuf jour un film rare qui montre la face sombre de la société japonaise, trop rigide, enserrée dans des règles d’honneur où l’hypocrisie ne peut que prospérer puisque seules comptes les apparences. Toute velléité individuelle est irrémédiablement condamnée par la loi collective qui ne tolère, comme dans toutes les sociétés rigides, aucune déviance. Le réalisme poétique des décors reconstitués, des costumes, des façons de porter une litière ou de courir, les paysages de sentiers de montagne et de forêts de bambous, participent à l’atmosphère en noir et blanc.
DVD Les amants crucifiés, Kenji Mizoguchi, 1954, avec Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa, Yôko Minamida, Films sans frontières 2008 (japonais sous-titré français), 1h38, €20.00 blu-ray €24.29
Disponible sur Arte.tv jusqu’au 14 janvier 2022 en replay
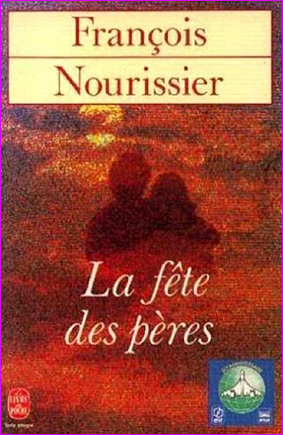




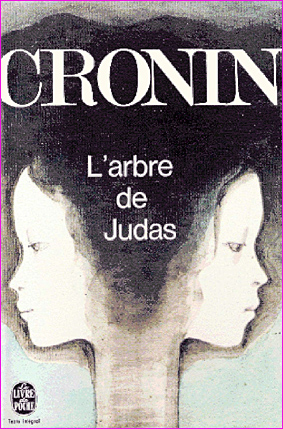









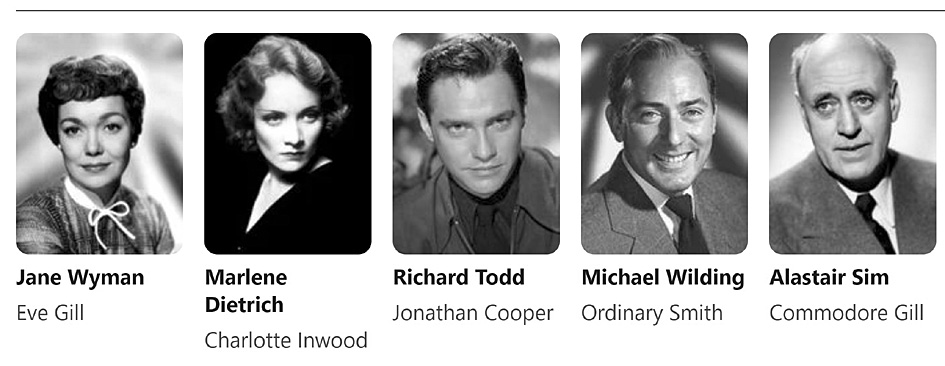

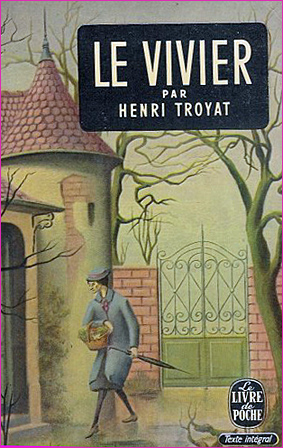



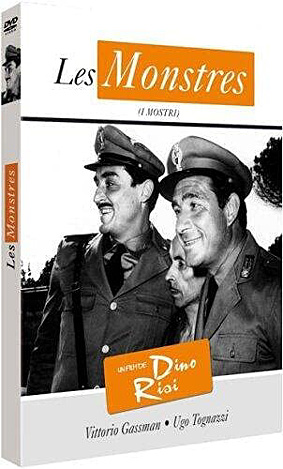






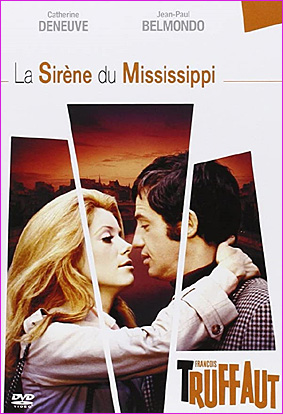





















Commentaires récents