Le chapitre II du Livre III des Essais a pour titre « Du repentir ». C’est pour mieux le combattre : Montaigne ne se repens de rien. Il n’est pas plus vertueux en sa vieillesse qu’il ne l’était en sa jeunesse et ne vante pas la chasteté parce qu’il ne peut plus faire autrement. « Il faut que notre conscience s’amende d’elle-même par renforcement de notre raison, non par l’affaiblissement de nos appétits. La volupté n’en est en soi ni pâle ni décolorée, pour être aperçue par des yeux chassieux et troubles. On doit aimer la tempérance par elle-même et pour le respect de Dieu, qui nous l’a ordonnée, et la chasteté ; celle que les catarrhes nous prêtent et que je dois au bénéfice de ma colique, ce n’est ni chasteté, ni tempérance ». L’homme marche entier, dit-il.
Si Montaigne change en ses écrits, il se diversifie mais reste lui-même. C’est bien lui qui parle et non un autre. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne, toute chose y branle sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant, d’une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il est, en l’instant que je m’amuse à lui. Je ne peins pas à l’être. Je peins le passage. » Comme les futurs libéraux des Lumières, Montaigne observe qu’il n’est point de fixisme, ni de Bible : la terre tournoie dans l’espace, bouge en elle-même, les croyances évoluent, le savoir se complète et se contredit, s’amende. La sagesse, qui est philosophie pratique de la vie bonne, concerne aussi bien « la vie populaire et privée » que la « vie d’une plus riche étoffe ». Ce pourquoi Montaigne écrit. Non pour la gloire mais pour se montrer tel qu’en lui-même, exemplaire de l’humaine condition, exemple pour tous, sans gloire pour lui.
Pas de repentir. « Est-ce pas faire une muraille sans pierre, ou chose semblable, que de bâtir des livres sans science et sans art ? » interroge Montaigne. Il répond non. Son propre exemple parle pour lui car il est vérité en soi. « Jamais homme ne traita sujet qu’il entendît ni connût mieux que je fais celui que j’ai entrepris, et qu’en celui-là je suis le plus savant homme qui vive ; secondement, que jamais aucun ne pénétra en sa matière plus avant, ni en éplucha plus particulièrement les membres et suites ; et n’arriva plus exactement et pleinement à la fin qu’il s’était proposée à sa besogne. » Je dis vrai, dit Montaigne, « ma conscience se contente de soi ». Pas de théorie ni de leçons, « je n’enseigne point, je raconte. » Voilà qui est sagesse humaine, et non pas discours de grenouille qui se prend pour un bœuf, ou clerc méprisable qui se croit assez orgueilleux pour interpréter la volonté de Dieu, de l’Histoire ou de Gaïa. Avis aux prophètes autoproclamés, aux intellos « engagés » qui croient faire l’Histoire et aux arrogants qui savent tout mieux que personne – surtout ce qui est bien pour les autres sans leur demander leur avis.

« De fonder la récompense des actions vertueuses sur l’approbation d’autrui, c’est prendre un trop incertain et trouble fondement. Notamment en un siècle corrompu et ignorant comme celui-ci, la bonne estime du peuple est injurieuse ; à qui vous fiez-vous de voir ce qui est louable ? » Nous pouvons le dire aussi de notre siècle, et peut-être même de tous. Ce n’est pas la commune opinion qui est morale, c’est la vertu ; si l’opinion est versatile, la vertu reste au-dessus. Elle ne change que lentement avec les siècles, comme un vin se bonifie avec le temps. La piquette de saison ne saurait tenir lieu de guide de conduite. Tout au contraire, « À nous autres principalement, qui vivons une vie privée qui n’est en montre qu’à nous, devons avoir établi un patron au-dedans, auquel rapprocher nos actions et, selon celui-ci, nous caresser tantôt, tantôt nous châtier. »
Dès lors, la faute ou le « péché » ne sont que des déviations de la voie droite qui est intérieure, pas une injonction de la société. « Le repentir n’est qu’un désaveu de notre volonté et opposition de nos fantaisies qui nous promènent à tout sens. Il fait désavouer à celui-là sa vertu passée et sa continence. » Se repentir officiellement n’est qu’apparence, ce qui compte est le regret que nous avons au-dedans de nous d’avoir dévié de notre voie. Et la vertu se pratique autant en privé qu’en public, sous peine de n’être point vertu mais masque et affectation. « Le prix de l’âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément. Sa grandeur ne s’exerce pas en la grandeur, c’est en la médiocrité. » Un Mélenchon est-il démocrate en sa maison et avec les siens ? Celles et ceux qui font profession de vertu, aimant à critiquer les autres, sont-ils plus nets en leur particulier ? « Comme les âmes vicieuses sont incitées souvent à bien faire par quelque impulsion étrangère, aussi sont les vertueuses à faire mal. Il les faut donc juger par leur état rassis, quand elles sont chez elles, si quelquefois elles y sont. »
Soyons nous-même, dit Montaigne, entiers et sincères, même dans la faute. Car qui n’a jamais péché ? L’important n’est pas la repentance mais ce que l’on fait pour compenser. Ainsi du paysan devenu larron par indigence, que conte Montaigne. Une fois rassasié, il distribuait le surplus aux plus pauvres que lui et établit un testament pour dédommager les héritiers. La repentance « coloniale » ou « dominatrice », tellement à la mode chez les vertueux de fraîche date qui se sont contentés de naître en un siècle plus humain, serait plus justement traitée à l’aune de Montaigne. Se laisser dominer en retour, par une colonisation « à l’envers », comme disent certains autres qui se contentent de réagir au lieu d’agir, serait une faute morale.
« Je fais coutumièrement entier ce que je fais et marche tout d’une pièce, » dit Montaigne. « Mon jugement en a la coulpe ou la louange entière ; et la coulpe qu’il a une fois, il l’a toujours, car quasi dès sa naissance il est un : même inclination, même route, même force. » Ce que nous fîmes avec de bonnes intentions dans les siècles passés, poursuivons aujourd’hui les bonnes intentions en modifiant leurs manières. « Mais en ces autres péchés à tant de fois repris, délibérés et consultés, ou péchés de complexion, voire péchés de profession et de vacation, je ne puis pas concevoir qu’ils soient plantés si longtemps en un même courage sans que la raison et la conscience de celui qui les possède le veuille constamment et l’entende ainsi ; et le repentir qu’il se vante lui en venir à certain instant prescrit, m’est un peu dur à imaginer et former. »
Rien ne sert de se vouloir autre que la nature (ou Dieu) nous a faits, dit Montaigne. « Mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis et à ma condition. Je ne puis faire mieux. Et le repentir ne touche pas proprement les choses qui ne sont pas en notre force, oui bien le regretter. » Ne pas plaindre le passé, ni craindre l’avenir, mais faire avec, du meilleur de notre vertu d’aujourd’hui – telle est la leçon de Montaigne.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog










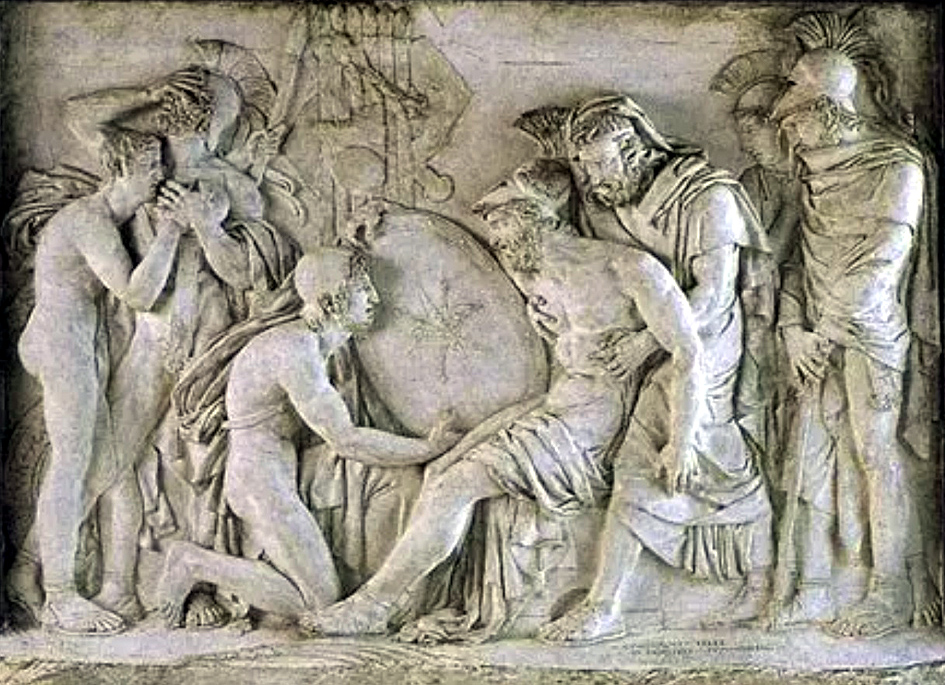
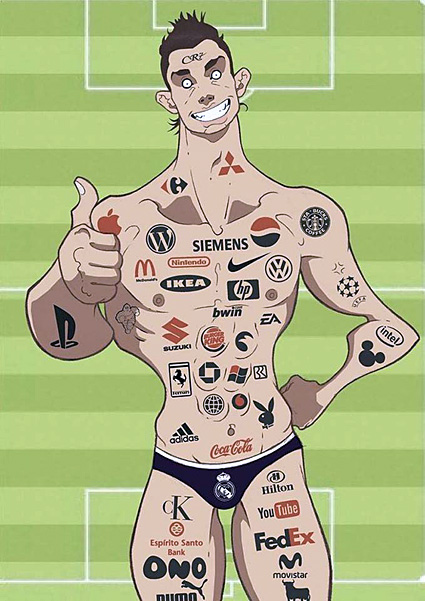


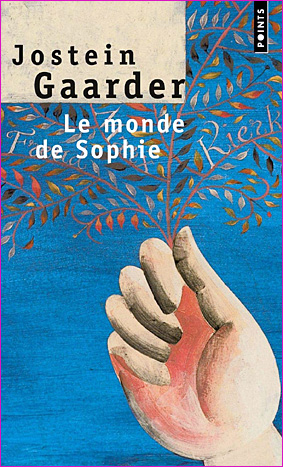
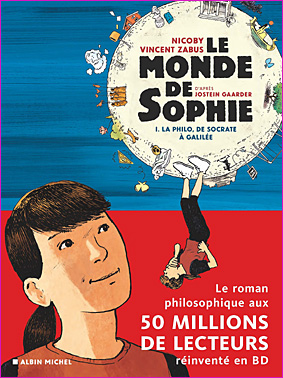


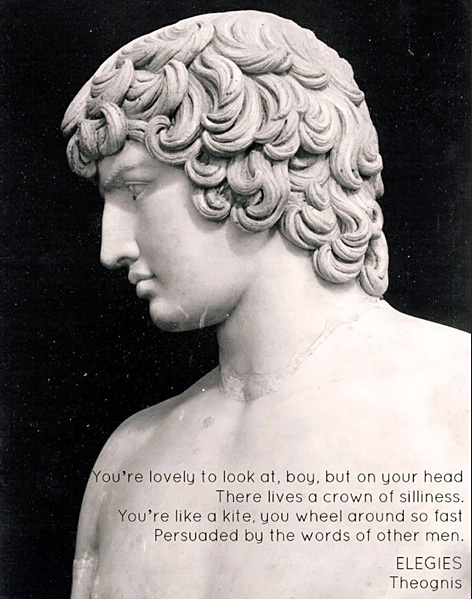










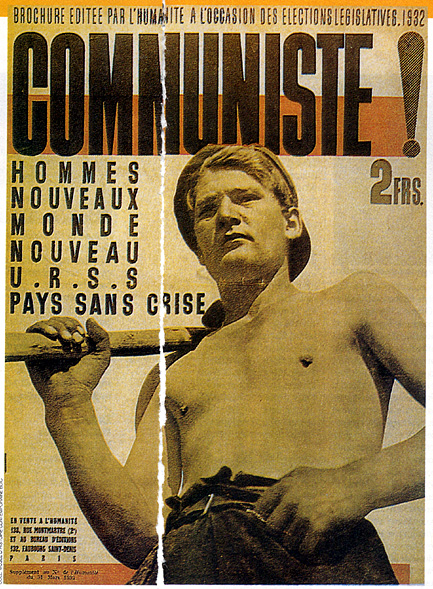


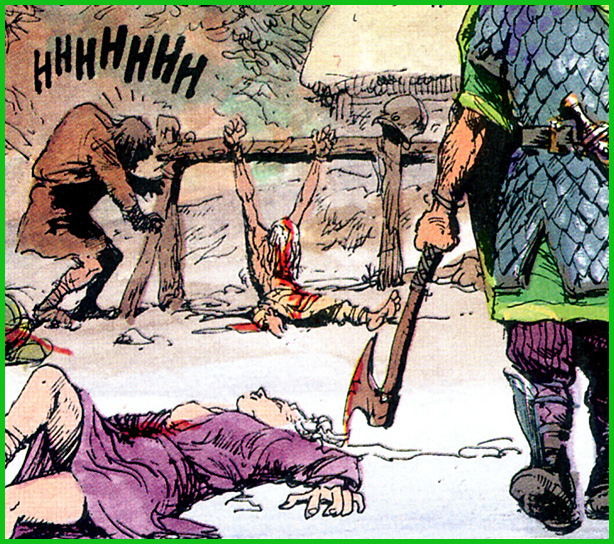
Commentaires récents