
La « jolie » dont il est question dans le titre est la femme de l’ancien préfet de police de New York, retrouvée égorgée dans Central Park dix-sept ans auparavant. Le coupable est peut-être un mafieux qui a mis un contrat sur elle au mépris de toutes les règles en usage. Nicky Sepetti a été mis en prison pour d’autres faits et il vient d’être libéré, au grand dam de Myles Kearny le préfet en retraite, qui craint désormais pour sa fille Neeve.
Celle-ci a réussi dans la mode, montant une boutique avec les fonds d’un ami qu’elle appelle « oncle », Anthony delle Salva dit le vieux Sal qui a percé dans la haute couture avec l’idée de transposer les couleurs du Pacifique aux vêtements trop austères portés en son temps. Neeve (prénom irlandais qui s’écrit Niamh) a choisi plutôt le métier de conseillère en mode, choisissant les teintes, les tissus et les formes en fonction de la personnalité et de la silhouette de ses clientes, leur vendant au surplus des accessoires assortis tels que foulards, chaussures, sacs, bijoux. C’est là qu’elle fait sa fortune, avec le goût sûr de ceux qui sont nés dans la haute société et qui connaissent les codes.
Justement, une journaliste fantasque de la mode, Ethel Lambston, a disparu. Des vêtements d’hiver ne se trouvent plus dans sa penderie, mais elle n’a pas pris de manteau d’hiver. Les intempéries sont pourtant fortes en cette saison. Le lecteur sait dès le premier chapitre ce qu’il est advenu d’Ethel l’insupportable, mais il ne sait pas qui a fait le coup.
Les potentiels coupables sont nombreux, à commencer par son ex-mari Seamus qui, après un divorce une vingtaine d’année auparavant après six mois de vie commune, lui doit une pension alimentaire de mille dollars par mois alors qu’elle est devenue riche et que lui supporte le déclin de son bar au loyer qui augmente et à la clientèle qui diminue, tandis que ses trois filles à l’université coûtent. Un autre coupable possible est Steuber, ce producteur de vêtements chics qui fait travailler des immigrés illégaux parfois trop jeunes et importe de Corée la plupart de ses modèles tout en les vendant aussi chers que les autres ; Ethel devait dénoncer ces pratiques dans un livre explosif à paraître. Un coupable éventuel pourrait être le neveu d’Ethel, le jeune Douglas musclé à belle gueule qui plaît aux filles, mais qui est assez veule au fond, voleur même à l’occasion. Neeve, qui doit livrer les derniers vêtements commandés par Ethel, le trouve installé dans l’appartement de sa tante, la chemise à moitié déboutonnée et l’air revêche. Il n’a pas répondu au téléphone et est bien en peine de fournir une explication plausible. Et pourquoi pas un contrat de la mafia puisque les chargements venus d’Asie transportent parfois de la drogue ?
Bien sûr, le lecteur sera entraîné à choisir son coupable et à en être pratiquement certain, mais c’est trop facile. Il y aura coup de théâtre inattendu à la fin, ce qui fait le sel du genre. D’autant que le lecteur suit à la trace un tueur à gage qui doit se faire Neeve par contrat.
Neeve est une jeune femme décidée qui attend le mari idéal, ce qu’elle finit par trouver. Son père est pressenti pour diriger un service anti-drogue malgré ses 68 ans et sa récente crise cardiaque, ce qui lui laissera le champ libre. Il connait du monde, à commencer par la police mais aussi dans les milieux politiques et parmi ses anciens copains d’école primaire dans le Bronx. Seule sa femme lui manque, celle qui l’avait choisi à 10 ans lorsqu’elle l’avait retrouvé blessé par un tir allemand dans les ruines de la ville italienne de Pontici durant la Seconde guerre mondiale. Six ans plus tard il est revenu et elle l’a reconnu ; ils se sont mariés et ont vécu heureux jusqu’au drame de Central Park. Mais est-ce bien ce boss de la Mafia qui a commandité l’acte ? Il vient d’être libéré, il a une crise cardiaque, et il jure à son épouse que ce n’est pas le cas, mais que vaut la parole d’un mafieux ? Et sinon, qui ?
Nous sommes toujours dans le même univers des lectrices de Mary Higgings Clark, celui de la bonne société de la côte est qui fait rêver avec des mâles décidés et protecteurs et des femelles décidées et pleine d’initiatives. De l’entreprise, de l’argent, du bénévolat, des enfants – tout ce qu’aime ceux qui lisent, principalement des femmes à l’américaine. Mais ça marche, à petite dose j’y prends du plaisir.
Mary Higgings Clark, Dors ma jolie (Why my Pretty One Sleeps), 1989, Livre de poche 1991, 288 pages, €7.60 e-book Kindle €6.99
Les romans policiers de Mary Higgings Clark déjà chroniqués sur ce blog

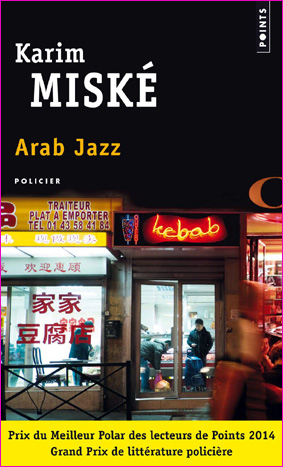
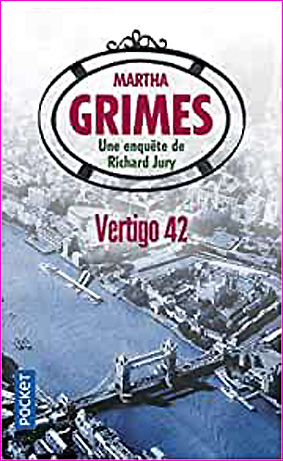
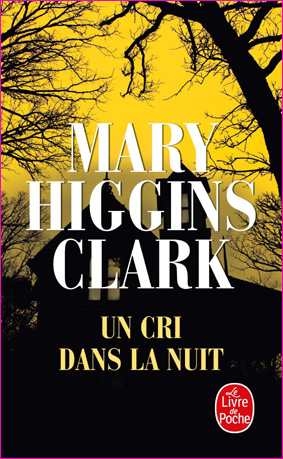



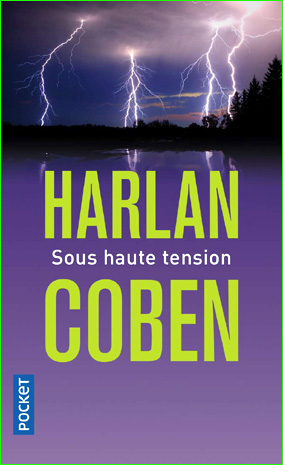




















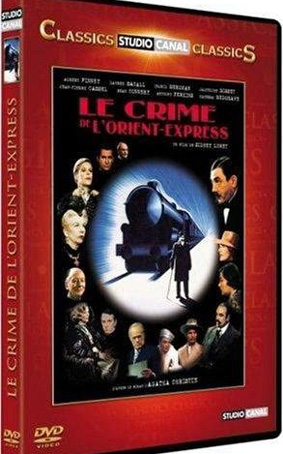









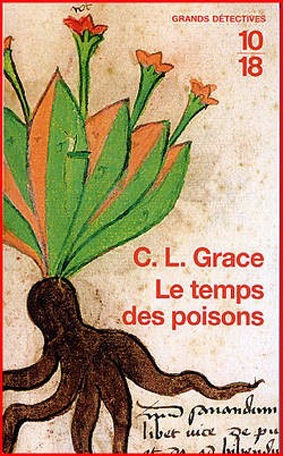


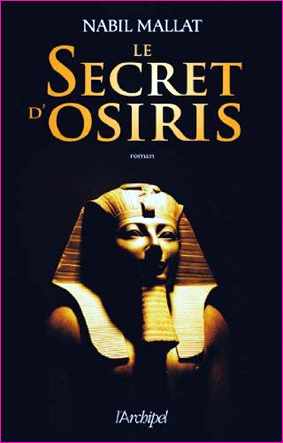
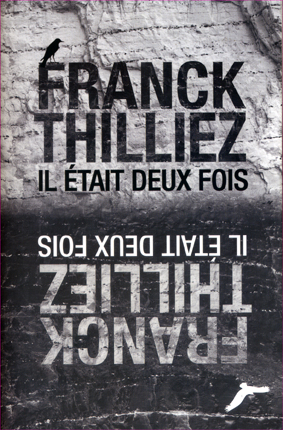
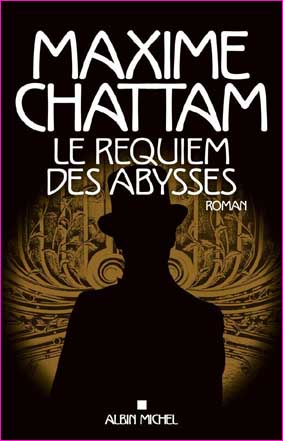
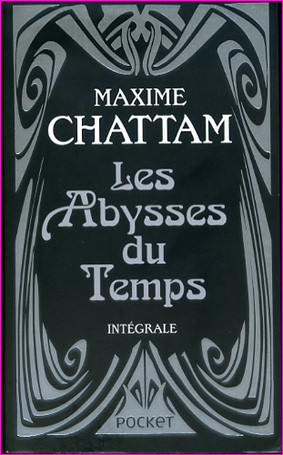


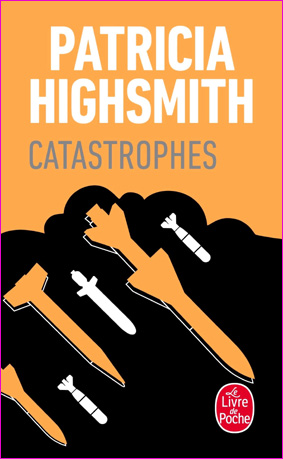

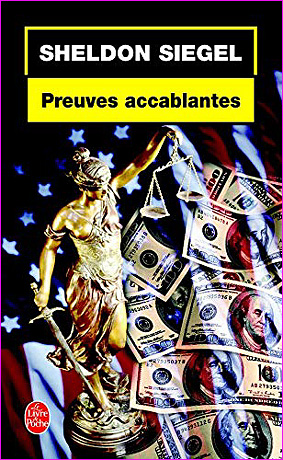

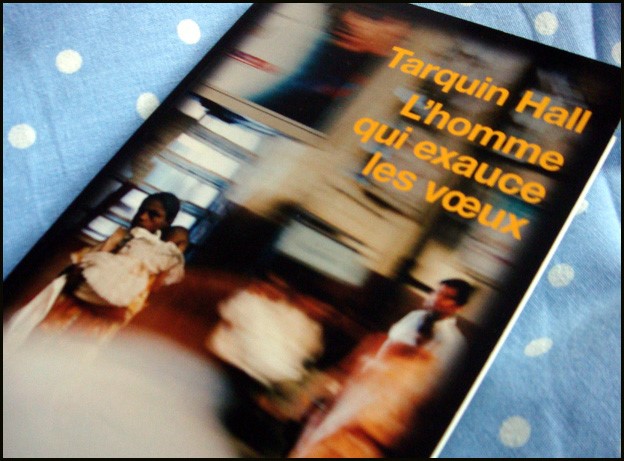
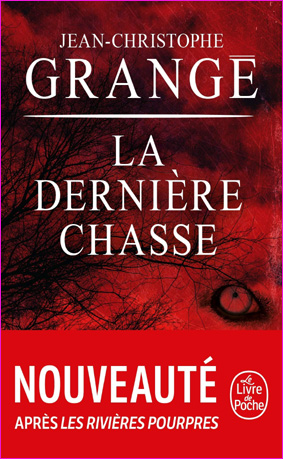
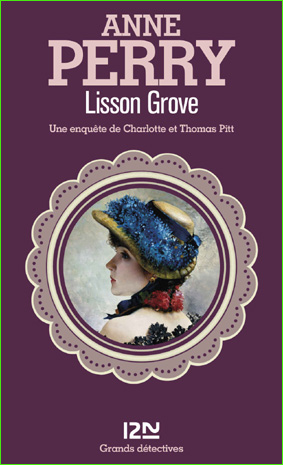
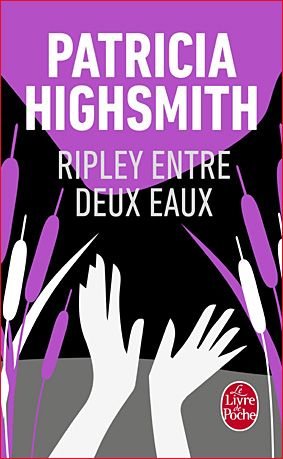
Commentaires récents