 Il y a 360 ans mourait René Descartes, philosophe. Françoise Hildesheimer, Conservateur général du Patrimoine, a signé là une excellente biographie. Tous les Français connaissent Descartes étudié au lycée (pour l’instant), et chacun se croit « cartésien ». Retracer l’histoire de l’homme dans son temps, retrouver le contexte de la modernité émergente, montre que Descartes n’était pas cartésien, pas plus que Marx n’était marxiste ni Jésus chrétien. Ces mythes a posteriori servent plus à justifier le théâtre médiatique ou à consolider une position sociale académique qu’à la vérité. C’est ainsi, par slogans et bons mots, que le glucksmanniaque Descartes, c’est la France sévit dans les têtes contemporaines.
Il y a 360 ans mourait René Descartes, philosophe. Françoise Hildesheimer, Conservateur général du Patrimoine, a signé là une excellente biographie. Tous les Français connaissent Descartes étudié au lycée (pour l’instant), et chacun se croit « cartésien ». Retracer l’histoire de l’homme dans son temps, retrouver le contexte de la modernité émergente, montre que Descartes n’était pas cartésien, pas plus que Marx n’était marxiste ni Jésus chrétien. Ces mythes a posteriori servent plus à justifier le théâtre médiatique ou à consolider une position sociale académique qu’à la vérité. C’est ainsi, par slogans et bons mots, que le glucksmanniaque Descartes, c’est la France sévit dans les têtes contemporaines.
Descartes est bien plus que cela : le point charnière de la conscience moderne, celle que nous sommes probablement en train de quitter pour autre chose. « Éprouver soi-même ce qu’on doit croire et ne plus se fier à l’argument d’autorité constitue la révolution cartésienne, le cadre ontologique de la modernité, qui met le soi individuel au centre du jeu » (p.432). Doute, cogito et raison sont les trois piliers par lesquels l’individu quitte la superstition et la croyance imposée pour devenir souverain. Il y a 864 fois les mots ‘je’, ‘moi’ et ‘me’ dans le Discours de la méthode, contre 119 ‘nous’, relève l’auteur… La raison devient audace critique. L’absolutisme louis-quatorzien d’un territoire, une foi, un roi, se trouve sapée sous son règne en Hollande par le cogito de Monsieur Descartes, seigneur du Perron.
Si ses exposés scientifiques ont bien vieilli, la philosophie des sciences de Descartes demeure : toute croyance a priori est rejetée au profit de l’observation, de l’expérience et du calcul. Une branche a conduit au mécanisme qui veut tout démonter pour se rendre maître et possesseur de la nature. Une autre branche est sa démarche globale de la philosophie naturelle, qui conduit à Einstein en réduisant le réel au géométrique. « Recherche sur la lumière et exigence de clarté ne pourraient-elles pas faire de notre Descartes essentiellement le philosophe de l’aspiration à la lumière de la connaissance ? » (p.424). Descartes se situerait ainsi sur les traces de Grecs.
 René Descartes est né en 1596 entre Limousin et Touraine d’un Conseiller au Parlement de Bretagne et d’une mère qui meurt lorsqu’il a un an. Mère absente, père indifférent, vont marquer le gamin qui sera mis en pension après la nourrice au collège jésuite de La Flèche fondé par Henri IV. Il étudie ensuite le droit à Poitiers mais ne veut se fixer. Il part pour la guerre en Hollande à 23 ans, où la France contre les Habsbourg en soutenant la révolte de sept Provinces unies. Mais il n’est pas militaire, plutôt curieux des ingénieurs, de la géométrie des fortifications et des lunettes d’optique. Il visite la Bohême, l’Italie, dont il n’aime ni le climat trop chaud ni les habitants trop théâtraux. C’est le 10 novembre 1619, à 23 ans, qu’il a « dans le poêle » ses trois rêves qui vont fonder sa philosophie. Un poêle est une pièce chauffé d’un grand poêle en fonte et céramique, comme il en existe en Europe centrale pour faire cocon l’hiver venu. Descartes, angoissé d’abandon, s’y sent bien. Notons que le rationnel est né dans l’imaginaire, la raison de l’inconscient : le coup d’état intellectuel cartésien vient des profondeurs de la psyché : du songe.
René Descartes est né en 1596 entre Limousin et Touraine d’un Conseiller au Parlement de Bretagne et d’une mère qui meurt lorsqu’il a un an. Mère absente, père indifférent, vont marquer le gamin qui sera mis en pension après la nourrice au collège jésuite de La Flèche fondé par Henri IV. Il étudie ensuite le droit à Poitiers mais ne veut se fixer. Il part pour la guerre en Hollande à 23 ans, où la France contre les Habsbourg en soutenant la révolte de sept Provinces unies. Mais il n’est pas militaire, plutôt curieux des ingénieurs, de la géométrie des fortifications et des lunettes d’optique. Il visite la Bohême, l’Italie, dont il n’aime ni le climat trop chaud ni les habitants trop théâtraux. C’est le 10 novembre 1619, à 23 ans, qu’il a « dans le poêle » ses trois rêves qui vont fonder sa philosophie. Un poêle est une pièce chauffé d’un grand poêle en fonte et céramique, comme il en existe en Europe centrale pour faire cocon l’hiver venu. Descartes, angoissé d’abandon, s’y sent bien. Notons que le rationnel est né dans l’imaginaire, la raison de l’inconscient : le coup d’état intellectuel cartésien vient des profondeurs de la psyché : du songe.
On l’a dit espion des jésuites, frère Rose-Croix et occultiste. Selon sa biographe, aucune preuve réelle ne vient étayer ces rumeurs. L’époque est au décentrement de l’héliocentrisme et du fixisme d’Aristote établi en dogme par l’Église. Copernic et Galilée sont condamnés, Kepler en suspicion, Paracelse mêle science et occultisme. Descartes cherche la pierre philosophale mais elle est purement cérébrale : quel est le principe de connaissance unique qui enchaîne entre elles toutes les connaissances scientifiques. Il ne veut pas s’établir en se mariant ou achetant un office ; il vit de ses rentes qui lui viennent de l’héritage maternel. Lors de séjours à Paris, il rencontre les libertins, intellectuels critiques à l’égard de la religion et hédonistes. Ces hommes d’esprit réagissent à la réaction catholique de la Contre-réforme et à la dévotion bigote de Louis XIII. En 1623, Théophile de Viau sera condamné à mort et brûlé en effigie à Paris. Prudent, sociable, Descartes apprend à dissimuler. Il ne veut pas se fâcher avec sa seule mère, l’Église, ni avec ses seuls pères, les Jésuites. Il va donc passer par la science pratique pour faire avancer ses idées philosophiques. Il est ami de Guez de Balzac, du père Mersenne, il attire l’attention du cardinal de Bérulle en société en démontant la force d’opinion de la vraisemblance, qui n’est pas le vrai mais un artifice sophiste. Il échangera des lettres avec quatre-vingt correspondants. Car, pour être libre, il retourne en Hollande où il vivra vingt ans, changeant plusieurs fois de résidences, l’auteur en a dénombré trente deux. Il fait sienne cette maxime d’Ovide : « pour vivre heureux, vivons caché ». Il aura cependant une fille, Francine, avec une servante à Amsterdam. Il établira la mère et l’enfant près de lui mais la gamine mourra de scarlatine à l’âge de cinq ans.
Il ne veut pas s’établir en se mariant ou achetant un office ; il vit de ses rentes qui lui viennent de l’héritage maternel. Lors de séjours à Paris, il rencontre les libertins, intellectuels critiques à l’égard de la religion et hédonistes. Ces hommes d’esprit réagissent à la réaction catholique de la Contre-réforme et à la dévotion bigote de Louis XIII. En 1623, Théophile de Viau sera condamné à mort et brûlé en effigie à Paris. Prudent, sociable, Descartes apprend à dissimuler. Il ne veut pas se fâcher avec sa seule mère, l’Église, ni avec ses seuls pères, les Jésuites. Il va donc passer par la science pratique pour faire avancer ses idées philosophiques. Il est ami de Guez de Balzac, du père Mersenne, il attire l’attention du cardinal de Bérulle en société en démontant la force d’opinion de la vraisemblance, qui n’est pas le vrai mais un artifice sophiste. Il échangera des lettres avec quatre-vingt correspondants. Car, pour être libre, il retourne en Hollande où il vivra vingt ans, changeant plusieurs fois de résidences, l’auteur en a dénombré trente deux. Il fait sienne cette maxime d’Ovide : « pour vivre heureux, vivons caché ». Il aura cependant une fille, Francine, avec une servante à Amsterdam. Il établira la mère et l’enfant près de lui mais la gamine mourra de scarlatine à l’âge de cinq ans.
Ce n’est qu’en 1637 (la même année que Le Cid) qu’il publie sur privilège du roi le Discours de la méthode, préface d’une œuvre scientifique mais qui expose sa philosophie de la nature. « C’est tout à la fois une autobiographie intellectuelle anonyme et un traité de philosophie et de science écrit en français, avec des mots simples et visant à l’universalité du bon sens et de la raison » (p.187). Il se compose de six parties comme les six jours de création du monde et se dote de quatre préceptes : reconnaître pour vraie l’évidence, diviser pour analyser, aller du simple au complexe pour mettre en ordre, et ne rien omettre. Il use pour cela d’une morale « provisoire » pour dissimuler le doute méthodique sous l’allégeance à l’existence de Dieu. La morale sociale est d’obéir aux lois et coutumes, tenir avec fermeté ses opinions et actions, s’appliquer à se vaincre soi-même plutôt que d’accuser le sort, enfin cultiver sa raison. Seuls les dévots accusent le Destin, le monde, le système, les autres, en bref tout ce qui est voulu par Dieu. Les humains de bon sens usent au contraire de leurs capacités et raison pour changer le sort en action. Se changer soi plutôt que changer le monde, voilà qui est révolutionnaire !
 Ce n’est qu’en 1641 qu’il publie les Méditations métaphysiques, cette fois en latin pour ne toucher que les lettrés, évitant ainsi toutes ces polémiques indigentes et les injures naïves du tout-venant, que quiconque tient un blog connaît sans peine. Il les dédicace aux théologiens de Sorbonne pour contrer les jésuites qui critiquent sa Dioptrique et soupçonnent sa philosophie d’être en contradiction avec le dogme catholique de la transsubstantiation. Il y a toujours six Méditations, comme les six jours de Dieu. Sauf que la méditation est devenue moyen de connaissance et n’est plus un exercice spirituel d’adoration…
Ce n’est qu’en 1641 qu’il publie les Méditations métaphysiques, cette fois en latin pour ne toucher que les lettrés, évitant ainsi toutes ces polémiques indigentes et les injures naïves du tout-venant, que quiconque tient un blog connaît sans peine. Il les dédicace aux théologiens de Sorbonne pour contrer les jésuites qui critiquent sa Dioptrique et soupçonnent sa philosophie d’être en contradiction avec le dogme catholique de la transsubstantiation. Il y a toujours six Méditations, comme les six jours de Dieu. Sauf que la méditation est devenue moyen de connaissance et n’est plus un exercice spirituel d’adoration…
Les Principes de la philosophie, publiés en 1644, exposent la métaphysique et la physique en un tout complet, où la mécanique apparaît au cœur du système. Fidéiste mais adepte du doute, Descartes a « une indifférence totale au salut chrétien » (p.294). Il rencontre Pascal mais se montre cassant, ne supportant pas la critique métaphysique. Il entretient une correspondance suivie avec la princesse Élisabeth, âgée de 24 ans alors que lui en a 45. Elle est cousine de la reine Christine de Suède, avec qui il correspond aussi sur l’invite de l’ambassadeur de France en Suède, dès 1647. Il écrira pour elle un Traité des Passions de l’âme où le corps vivant est conçu comme une machine, que l’âme – pur esprit – investit durant l’existence. Elle aurait son siège dans la glande pinéale. Ce qui est intéressant est que Descartes croit que le conditionnement du corps peut influencer l’âme, ce qui explique la méthode Coué comme l’homéopathie et les miracles de Lourdes, par exemple.

Par touches successives, l’auteure brosse en érudite et d’une langue fluide le portrait d’un cérébral, indifférent aux biens matériels comme à la pensée des autres, qui demande à être compris avant de se livrer. L’abandon parental l’a rendu angoissé, dépressif, et il masque tous ses mouvements affectifs sous l’abstraction théorique. Sa mission sur cette terre est son œuvre, composer une philosophie naturelle totale pour remplacer Aristote. Il est bien montré le caractère imaginatif de ce héraut de la rationalité, dont le système a pris naissance dans le rêve de 1619. La froide analyse s’efface toujours devant l’intuition pour connaître la vérité. Les exemples concrets sont légion pour faire saisir l’essence de la pensée (morceau de cire chaude, malin génie, etc.), tandis que Descartes passe volontiers par la fiction pour se faire admettre par l’Église.
Ce penseur sérieux et pratique ne peut qu’être déçu par la France, pays de cour où le théâtre social compte plus que la profondeur de pensée. Il part en Suède en 1649 à l’invitation de la reine Christine et y mourra à 53 ans, le 11 février 1650, d’une pneumonie officiellement, mais peut-être empoisonné. L’auteure fait l’inventaire des symptômes et des hypothèses et, sans trancher, elle pointe l’étiologie d’un empoisonnement à l’arsenic, peut-être administré par des hosties du père Viogué, aumônier catholique de l’ambassade. Ce serait pour Raison d’Église : la conversion envisagée de la reine au catholicisme (qui aura d’ailleurs lieu quatre ans plus tard).
Ses restes seront rapatriés à Paris en 1667, dans l’église Sainte-Geneviève du Mont, avant d’être envisagés pour le Panthéon par décret d’octobre 1793 mais non suivi d’effet. Le philosophe sera inhumé à l’église Saint-Germain des Prés. L’adhésion à sa philosophie nouvelle est le fait de petits cercles libéraux, tandis que les Jésuites l’interdisent par deux fois en 1682 et 1696, et que Rome le met à l’Index – comme tout ce qu’elle ne comprend pas. L’abbé Baillet compose en 1691 une biographie pieuse tandis que Descartes rencontre enfin son temps avec La crise de la conscience européenne décelée par Paul Hazard entre 1680 et 1715. La raison se substitue aux dogmes et nous entrons dans un nouveau monde ; bientôt l’Ancien régime sera balayé et la technique prendra son essor. Victor Cousin fera de Descartes, en 1824, le génie national français. Husserl, Heidegger et Sartre y feront depuis référence.
Voilà un beau livre éclairant !
Françoise Hildesheimer, Monsieur Descartes – la fable de la raison, Flammarion, septembre 2010, €25.40, 511 pages avec carte, liste des résidences et des correspondants, chronologie, sources et bibliographie, index des noms et Préface de 1647 par Descartes de ses Principes de la philosophie.



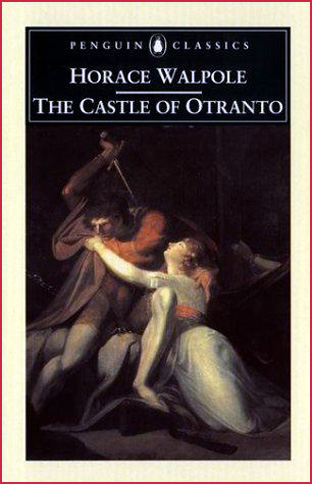
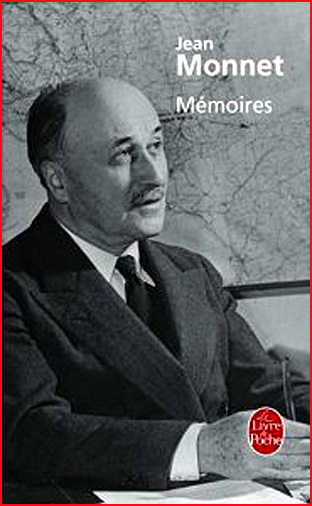





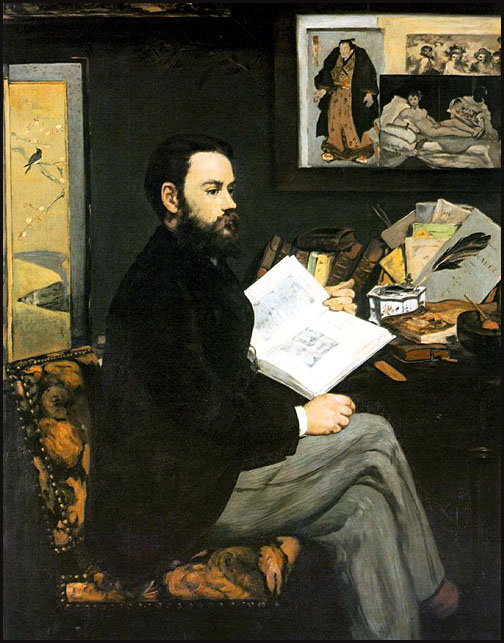





Tuer le rire ?
L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.
Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.
La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »
Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.
Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?
Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?
Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.
Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.
Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?
C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.
Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…
L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.
Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?
Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.