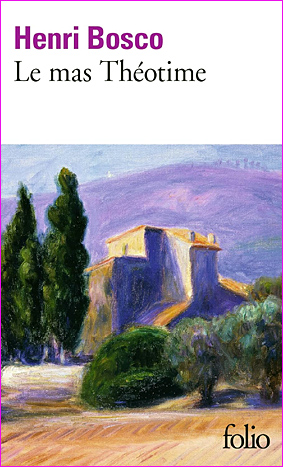
Henri Bosco, mort en 1976, chantait la terre et la Provence, ce Lourmarin qu’il a habité à la fin de sa vie et où il est enterré. Lui qui a voyagé comme interprète et prof durant des années en Grèce, en Italie, en Serbie, au Maroc, il se sent de sa terre. Le Mas Théotime en est un hommage. La piété de l’errant à l’enraciné.
Pascal était un jeune garçon sauvage, fils unique comme l’auteur (ses quatre frères aînés étaient morts en bas âge). Il était de Sancergues, pays où cohabitaient les deux familles de sa mère et de son père, les Dérivat et les Métidieu. Il avait comme voisine Geneviève, une fillette à peu près de son âge, avec laquelle il jouait en ayant percé un trou dans la haie mitoyenne. Et puis, à 8 ans, lui avait pris un ton de sauvagerie qui l’avait fait s’éloigner. Il craignait d’aimer d’amour Geneviève, qui faisait la coquette et l’aimait bien aussi. Pourquoi ce refus d’aimer ? Cette rébellion de l’âme et du corps ? C’est un peu une énigme.
Pascal ne voulait pas être attaché à la vie médiocre de la reproduction familiale, se marier avec sa cousine, exploiter en commun sa terre, rester au ras du sol. Lui aspirait à la culture, à la connaissance des plantes, à quitter le giron familial et le village ancestral. « Théotime, que j’aime, s‘est attaché à moi, qui l’ai relevé de son sommeil. En dix ans de coexistence nous nous sommes mêlés tellement l’un à l’autre que quelquefois je me demande si j’ai vraiment une maison et une terre ou si, plus vraisemblablement, tout cela n’est pas le pays et le toit familier de ma vie secrète. Ainsi en moi c’est naturellement Théotime qui pense, qui aime, qui veut ; et je n’entreprends rien sans que ses lois imposent, peu ou prou, à ma volonté, leurs raisons, qui sont fortes et nobles, j’en conviens, mais dont s’accommode parfois difficilement la violence de mes désirs » p.234. Il a hérité le mas et les terres près de Puyloubier (à 20 km d’Aix-en-Provence) d’un grand-oncle qui portait ce nom.
Geneviève n’a pas cette placidité de tempérament. Elle a toujours été vivace, dansante à donner le tournis. Elle a donc fait la folle. Il l’a giflée à un mariage, à 12 ans ; l’a revue par hasard au pensionnat, à 15 ans. Elle s’est mariée, a divorcé, s’est remise avec un homme marié et père de famille, l’a épousé sur ses instances, puis l’a quitté, lassée. Brusquement, elle débarque au Mas Théotime, la terre qu’occupe Pascal tout seul, avec les Alibert ses métayers logés à quatre cents mètres. Elle vient se cacher de son ex, se ressourcer, elle est toujours amoureuse de son cousin Pascal. Qui l’est aussi mais résiste. Comme s’il ne pouvait accepter d’aimer à la fois une femme et la terre. Or il aime la terre, celle dont il a hérité, celle sur laquelle il vit, celle qu’il cultive et amende. « J’aime Théotime ; mais Théotime tiens déjà à la montagne, par les racines, par les eaux, par la pierre dont on a bâti ses murailles. Théotime est un poste avancé des collines, et le lieu de rencontre où s’équilibre à leur sauvagerie l’aménité des premiers jardins et la forme des premiers blés. Son génie est aussi pastoral que l’agricole » p.415.
Il a de tout, Pascal, en véritable seigneur paysan, autarcique : des moutons pour la laine et le fromage, quelques vaches pour le lait et le beurre, un poulailler ; il cultive le blé et le maïs, fait pousser la vigne pour faire son vin, des oliviers pour l’huile pure, un verger pour les fruits, un potager… Ne manquent que les cochons – mais il y a les sangliers sauvages qu’il suffit de chasser. « Nous sommes les gens de ce lieu, les possesseurs héréditaires du quartier. Il est à moi, je suis à lui ; le sol et l’homme ne font qu’un, et le sang et la sève (…) Ils savaient simplement, de père en fils, que ces grands actes agricoles sont réglés par le passage des saisons ; et que les saisons relèvent de Dieu. En respectant leur majesté, ils se sont accordés à la pensée du monde, et ainsi ils ont été justes, religieux » p.423. Un rêve d’écolo, sans intrants, sans machines, avec seulement la force des bras et de la volonté, quelques chiens pour les bêtes et chevaux pour les labours et le foin. Sa philosophie n’est pas métaphysique mais terrienne : « Je tiens à ces variations du ciel, des eaux et de la terre par des liens mystérieux. Les mouvements qui les transforment me transforment aussi. Au ralentissement de mon sang alourdi par les fatigues de l’été, qui active ses fièvres, je pense que déjà s’accorde une langueur dans la sève des bois encore chauds. Ainsi tout se tient en ce petit monde des campagnes ; et c’est avec mon cœur que bat le cœur de la terre, suivant les hauts et les bas de l’année, le point saisonnier du soleil quand il se lève sur les crêtes, et la position des astres nocturnes » p.400.
Seule la médisance de la campagne peut lui faire de l’ombre. En particulier un lointain cousin Clodius, vieux solitaire qui occupe les terres voisines et voudrait le chasser. Une paix armée règne entre eux, faite de petits incidents ; ils s’observent.
Jusqu’à ce que déboule Geneviève, comme une folle dans un jeu de quilles. Elle est curieuse de tout, soucieuse d’aller là où l’on ne veut pas qu’elle aille. Pascal l’a avertie, mais elle y va quand même. Et Clodius l’attrape sur ses terres, l’emmène chez lui, et la menace. Pascal intervient et la délivre mais, dès lors, la paix précaire est rompue. Clodius croyait pouvoir user de Geneviève pour faire déguerpir Pascal, il en est pour ses frais. Le jeune homme (la trentaine) préfère la terre à la femme. D’autant que Geneviève est liée par le mariage.
D’ailleurs son mari second, qu’elle a quitté alors que lui a tout quitté pour elle, la cherche. Il survient lui aussi au Mas Théotime une nuit d’orage où il fait noir comme dans un four. Clodius qui se méfie de tous, lui tire dessus au fusil et le blesse ; comme l’homme est armé, il riposte au pistolet. Une seule balle, en plein cœur. Clodius est mort. Pascal, sans le savoir, l’accueille comme un colporteur égaré et le loge pour un jour ou deux au grenier. Il ignore tout de l’homme.
Les gendarmes enquêtent, le juge expédie les interrogatoires, le notaire ouvre le testament de Clodius : il donne tout à Pascal parce qu’il lui reconnaît le même amour de la terre que lui. Peu à peu, Pascal découvre la vérité, fait partir l’homme et laisse le choix à Geneviève, qui le suit. Il sera arrêté un peu plus tard mais s’évadera et partira outremer. Quant à Geneviève, elle se réfugie dans la religion, comme la tante Madeleine chez les Trinitaires de Marseille, avant de partir en Orient.
Pascal redevient solitaire sur sa terre. Mais Jean, le fils du métayer, se marie ; sa sœur Françoise se marierait bien aussi, elle aime Pascal. Pourquoi pas ?
Un roman paysan qui met en rapport l’homme avec la terre, à une époque où ils étaient encore proches – avant l’industrie. Nostalgiques ou précurseurs peuvent se retrouver dans ce roman ancien d’un humaniste du sud.
Prix Renaudot 1945
Henri Bosco, Le mas Théotime, 1945, Folio 1972, 448 pages, €9,90, e-book Kindle €9,49
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)




























































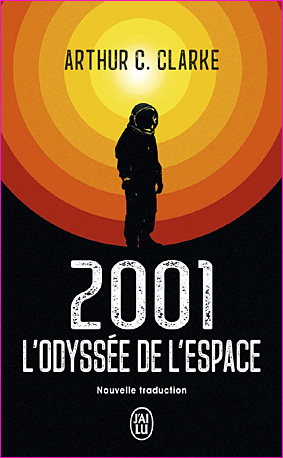
















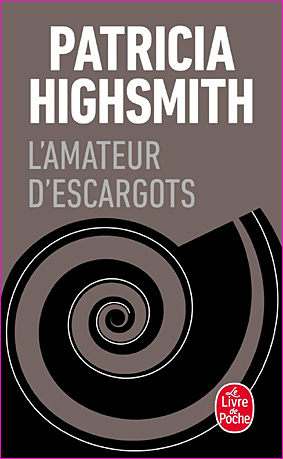



















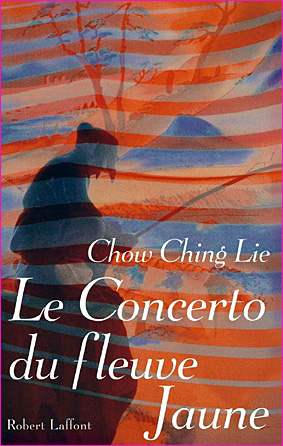


















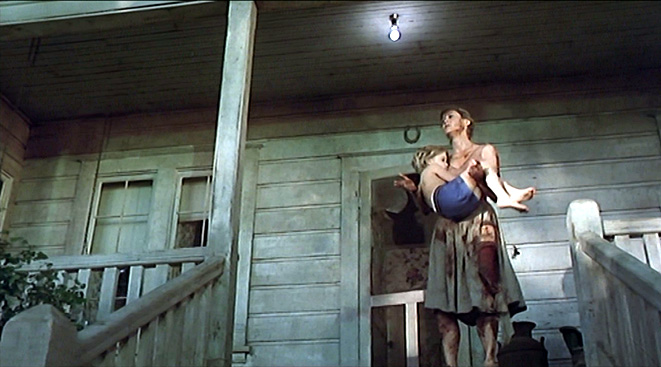
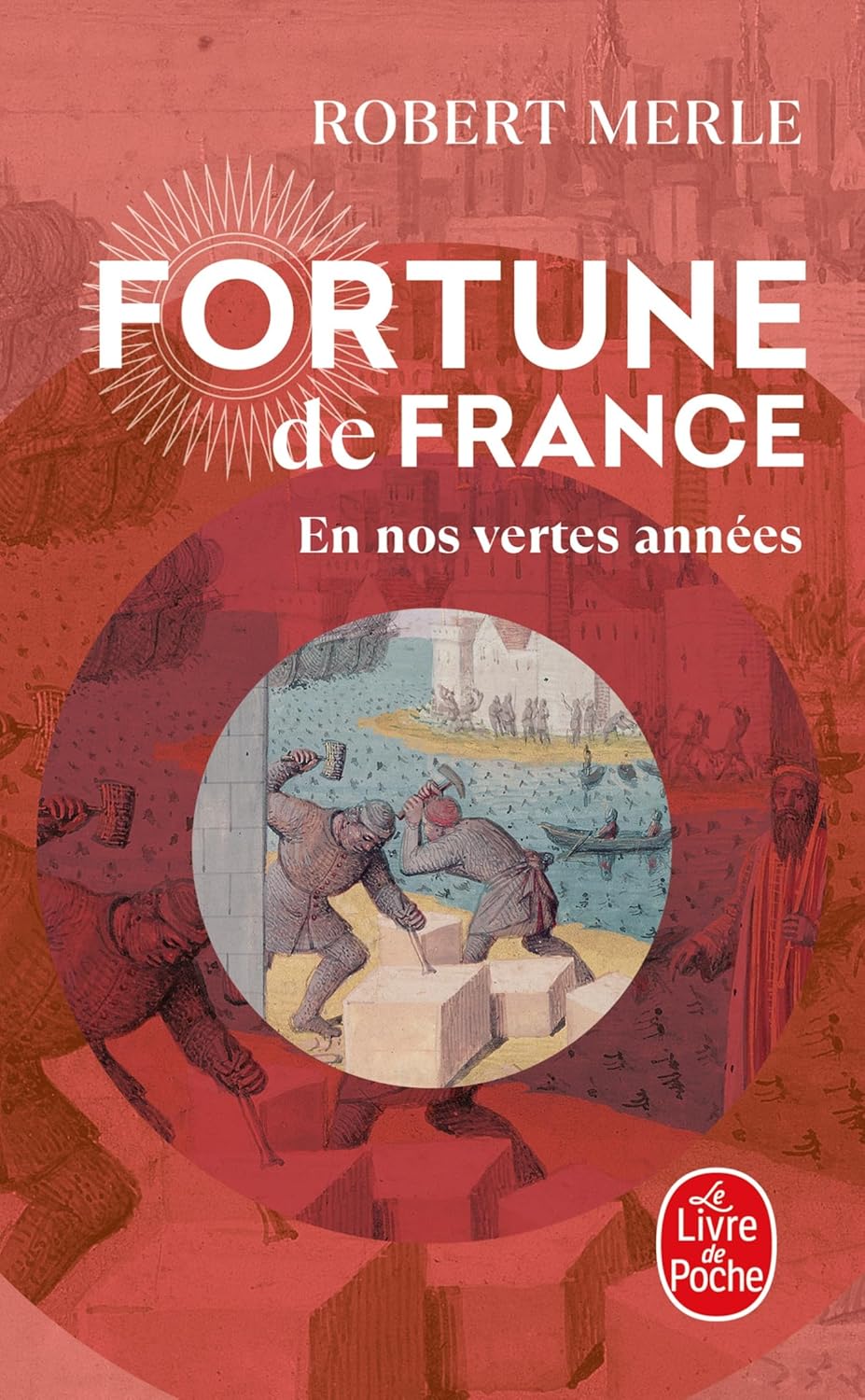













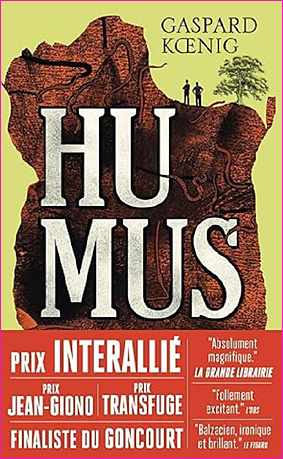














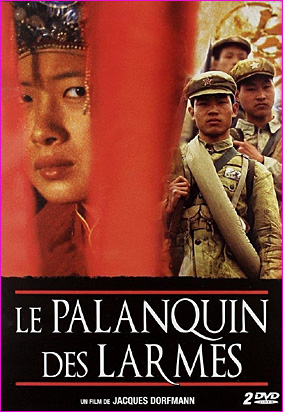










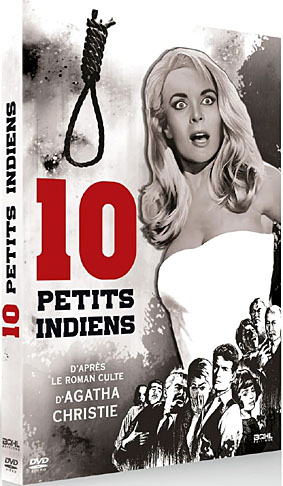


















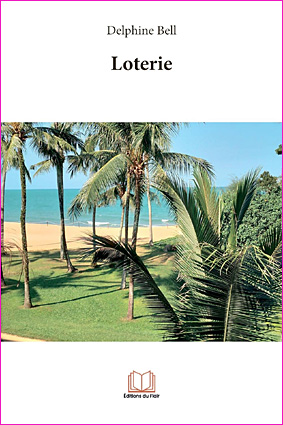











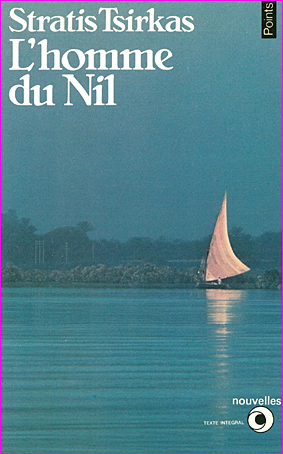











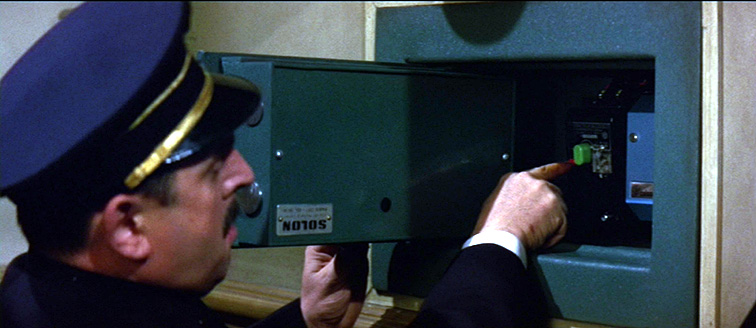


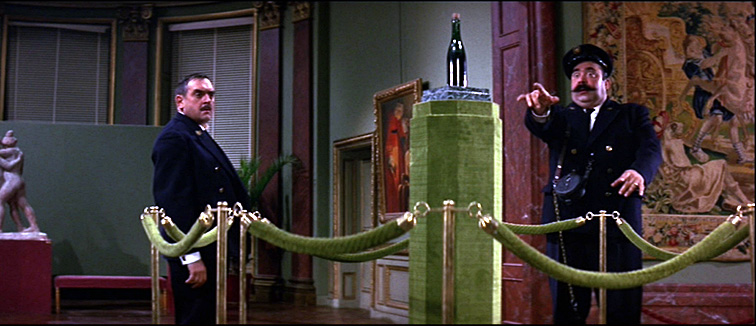




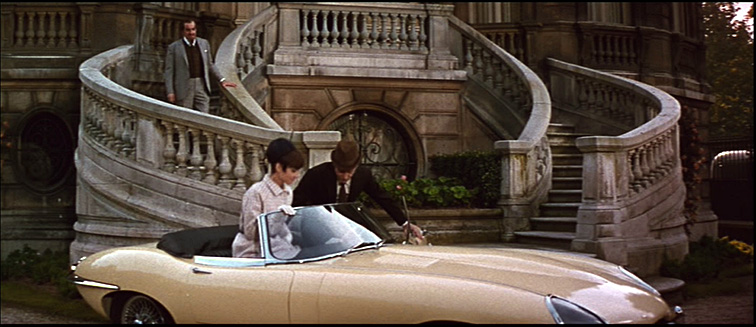

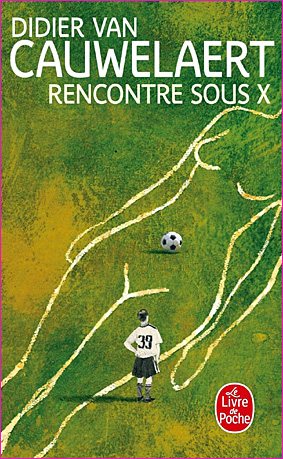
Commentaires récents