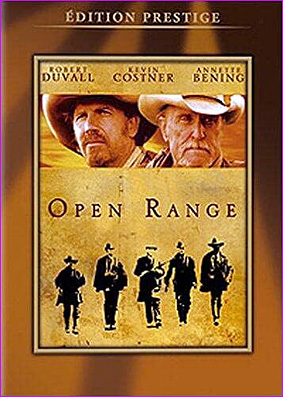
L’amour, la mort ; la violence, la liberté ; les grands espaces, se fixer. Tels sont les grands thèmes de ce film exigeant, qui a eu du succès même chez les Yankees, en général assez bas du plafond. Mais il y a les mythes qui agissent toujours : le Pionnier, le Justicier, la Rédemption, la Virilité. Car il y a évidemment une grosse bagarre, des centaines de balles dans un duel à la fin entre les bons et les méchants. Et devinez qui va gagner ?
Le scénario s’inspire du roman de Lauran Paine, The Open Range Men, paru en 1990. Open range, non traduit en français par flemme, signifie prairies ouvertes, autrement dit le droit de passage et de pacage pour tous les troupeaux dans cet immense espace qu’est le nord-ouest américain. La privatisation par un baron du bétail local est donc une tentative de s’approprier ce qui appartient à tous, une dérive de la loi au nom du plus fort. Elle s’oppose au droit et aux libertés – ce dont les machos brutaux et cyniques (ici un « Irlandais » immigré ») se moquent en imposant leur règle. Trompe ne fait pas autre chose, ce qui provoque ces deux mythes américains. D’où l’actualité de cet anti-western où le Pionnier peut dériver vers l’orgueil et se croire Dieu sur sa terre, alors qu’elle a été créée pour tous.



Un éleveur « Boss » Spearman (Robert Duvall) et ses trois cow-boys, Charley (Kevin Costner), le gros Mose (Abraham Benrubi) et l’adolescent de 16 ans John « Button » (Diego Luna, 24 ans) conduisent un troupeau de bovins vers l’ouest en traversant en l’an 1882 les terres du gros fermier qui a absorbé ses voisins par la menace, Denton Baxter (Michael Gambon). Tout irait bien s’ils n’avaient oublié « le café ». Il faudrait en acheter à la ville qu’on vient de passer, avant de poursuivre la route. Button se propose, mais il est trop tendre pour son Boss, d’où son surnom de fleur encore à éclore. Spearman l’a ramassé dans une ville du Texas « il y a quelques années » alors qu’il fouillait les poubelles pour manger. Il en a fait son employé et veille sur lui comme sur un fils adoptif. On apprendra en effet qu’il a perdu sa femme et son fils de 7 ans du typhus, des années auparavant. Il envoie donc plutôt Mose, un ours plutôt gentil avec les gens et qui s’occupe de l’intendance.
Sauf que Mose ne revient pas. Boss soupçonne un incident et part à la ville avec Charley, fidèle et efficace second. Ils laissent le gamin garder le chariot et surveiller les bêtes. Mose a été fourré en prison après avoir été tabassé pour avoir, selon la version officielle, déclenché une bagarre dans l’épicerie avec les hommes de Baxter. Il les a bien assaisonnés, cassant même le bras droit du tueur psychopathe de Baxter. Le Marshall Poole (James Russo) réclame par provocation 50 $ pour chaque infraction, s’ils veulent le libérer, ce qui ne plaît pas à Boss. Mais il négocie au lieu de tenter de régler la chose par la force. Baxter veut montrer qui est le patron en ville et y consent, mais à ses conditions : qu’ils quittent le pays avec leur troupeau avant la nuit. Sinon, il lâchera ses chiens et leur troupeau sera dispersé. Mais Mose a été salement amoché, et les deux hommes doivent le conduire chez le docteur Barlow (Dean McDermott) qui vit avec une femme dans leur petite maison bien entretenue. Charley croit que c’est sa femme ; il apprendra plus tard que c’est sa sœur. Il en tombe amoureux et se déclarera avant la grosse bagarre, croyant ne pas en revenir.
Ils retournent au chariot avec Mose, soigné mais faible sur son cheval, mais ne peuvent quitter le camp à la nuit. Ils sont donc menacés par les sbires de Baxter, qui avancent masqués comme des malfrats du Ku Klux Klan, s’abritant derrière cet anonymat pour perpétuer leurs forfaits. Boss, qui connaît bien ce genre de gang, les surprend à la nuit avec Charley, les désarme et en tabasse un ou deux de ceux qui ont blessé Mose. Pendant ce temps, d’autres sbires ont attaqué le chariot, tué Mose d’une balle dans la tête et blessé sérieusement l’adolescent Button d‘une balle dans la poitrine avant de le frapper violemment sur le crâne. Ils ont tué même le chien, Tig, au nom de grand-mère Costner. C’est le tueur au bras cassé qui s’en est chargé, il « a eu du plaisir », dira-t-il.



Pas question donc de lever le camp, il faut attendre le matin et, si Button survit, le porter avec le chariot chez le docteur, et régler cette affaire de meurtre avec Baxter. Charley est un ancien soldat de l’Union qui a servi dans un commando spécial derrières les lignes, pendant la guerre de Sécession, et il est devenu en quelques mois un tueur sans scrupules. Il s’en repend, surtout en observant son Boss et ami qui négocie avant de tirer et qui est bienveillant avec les gens, dont le jeune Button. Mais il faut parfois tuer pour défendre ses droits, et affronter l’ennemi pour gagner sa liberté. Boss en est d’accord : ni Mose, ni Button n’avaient rien fait qui justifie leur massacre sous le nombre, alors qu’ils ne pouvaient même pas se défendre.
Ils confient Button à la maison du médecin, qui est parti soigner les sbires de Baxter amochés par eux hier soir. Ce sera Sue Barlow (Annette Bening) qui s’en occupera, comme une infirmière et une mère. Elle voit bien comment Boss se comporte avec le gamin et l’en apprécie pour cela. Aidés par Percy (Michael Jeter), un vieux gardien des chevaux, ils surprennent les hommes de main du Marshall et les chloroforment, à l’aide d’une bouteille prise dans la vitrine du docteur, avant de les enchaîner en cellule. Boss ne veut pas les tuer. Mais Baxter les délivre et décide d’affronter les deux hommes pour les descendre, montrant qui est le patron sur cette terre. Il ne sait pas que c’est Dieu, mais va très vite s’en rendre compte. Le Seigneur, ce « salopard qui n’a rien fait pour défendre Button », grommelle Boss, change de camp et donne l’avantage à Charley. Il descend dès les premiers coups le tueur psychopathe d’une balle dans la tête, et les deux plus dangereux sbires d’une autre balle chacun dans le buffet. S’ensuit une mêlée générale, avec plus de coups que n’en contiennent les revolvers de l’époque, malgré les rechargements incessant à l’abri d’un mur de planches.



En bref, tout le monde est tué, surtout Baxter qui n’a rien voulu savoir, menaçant une fillette avant de prendre en otage Button qui s’est levé pour participer à la justice et Sue qui l’a suivi. Charley finit par le descendre. Mais, lorsqu’il veut achever un sbire blessé qui rampe dans la boue, afin « qu’il ne lui tire pas dans le dos », Boss s’interpose. Tuer pour la justice, ça va, en faire trop, ça ne va plus. Charley se maîtrise.
Il en a marre de tuer, sans cesse les méchants resurgissent. Il désire, en fin de trentaine, se fixer et Sue serait une épouse idéale. Il s’est déclaré, elle l’a accepté. Mais il se pose des questions : cette violence en lui, ne va-t-elle pas lui faire peur ? Au contraire, dit-elle, et elle suggère à mots couverts que cette virilité lui plaît ; elle réussira à la dompter. Boss et lui vont donc achever leur mission de conduire le troupeau à bon port, avant de revenir et de s’installer dans la ville. Le bar n’a plus de gérant, tué dans la bagarre, et Boss se voit bien le racheter ; quant à Charley, il se voit bien marié avec Sue et, peut-être, faire l’éleveur, ou le Marshall non vendu aux puissants.
C’est un film assez fort, où les femmes ne sont pas oubliées comme souvent dans les westerns. Sue a une vraie personnalité, qui tempère le machisme lorsqu’il entre en ébullition. La femme de l’aubergiste aussi, qui entraîne les citadins apeurés à sa suite pour traquer les derniers tueurs. Mais il remue surtout les grands mythes américains, ce pays de pionniers né dans la violence, et où chacun veut s’affirmer. Non, la puissance ne vas pas uniquement avec la richesse, elle est plutôt intérieure : dans les convictions morales et la volonté virile.
DVD Open Range, Kevin Kostner, 2003, avec Annette Bening, Kevin Costner, Robert Duvall, Diego Luna, Michael Gambon, Michael Jeter, Fox Pathé Europa 2005anglais, français, 2h19, €29,00, Blu-ray €23,08
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

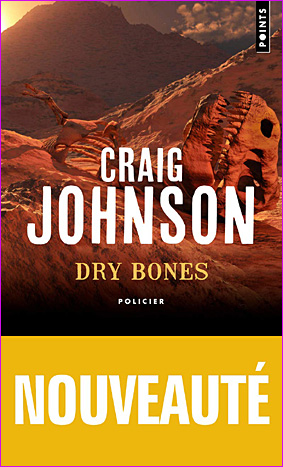

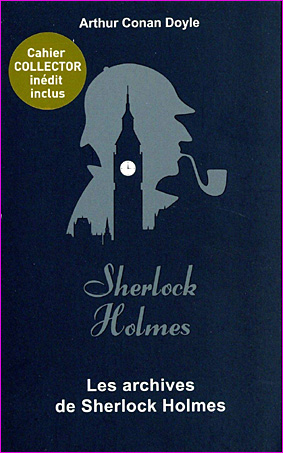































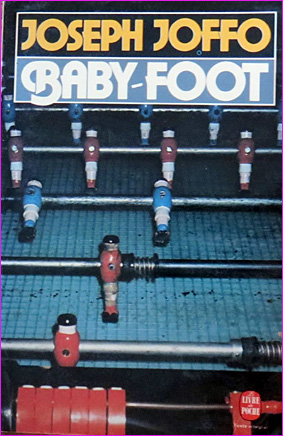
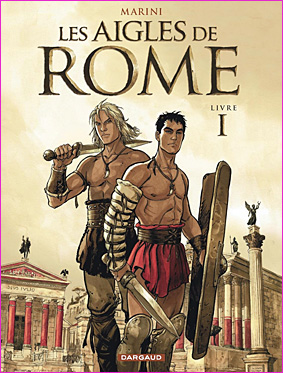

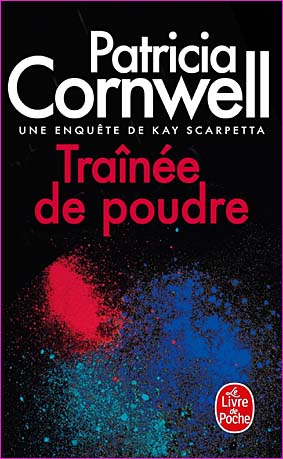

















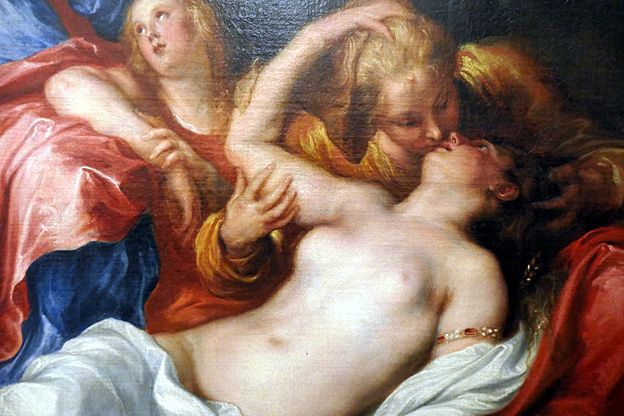















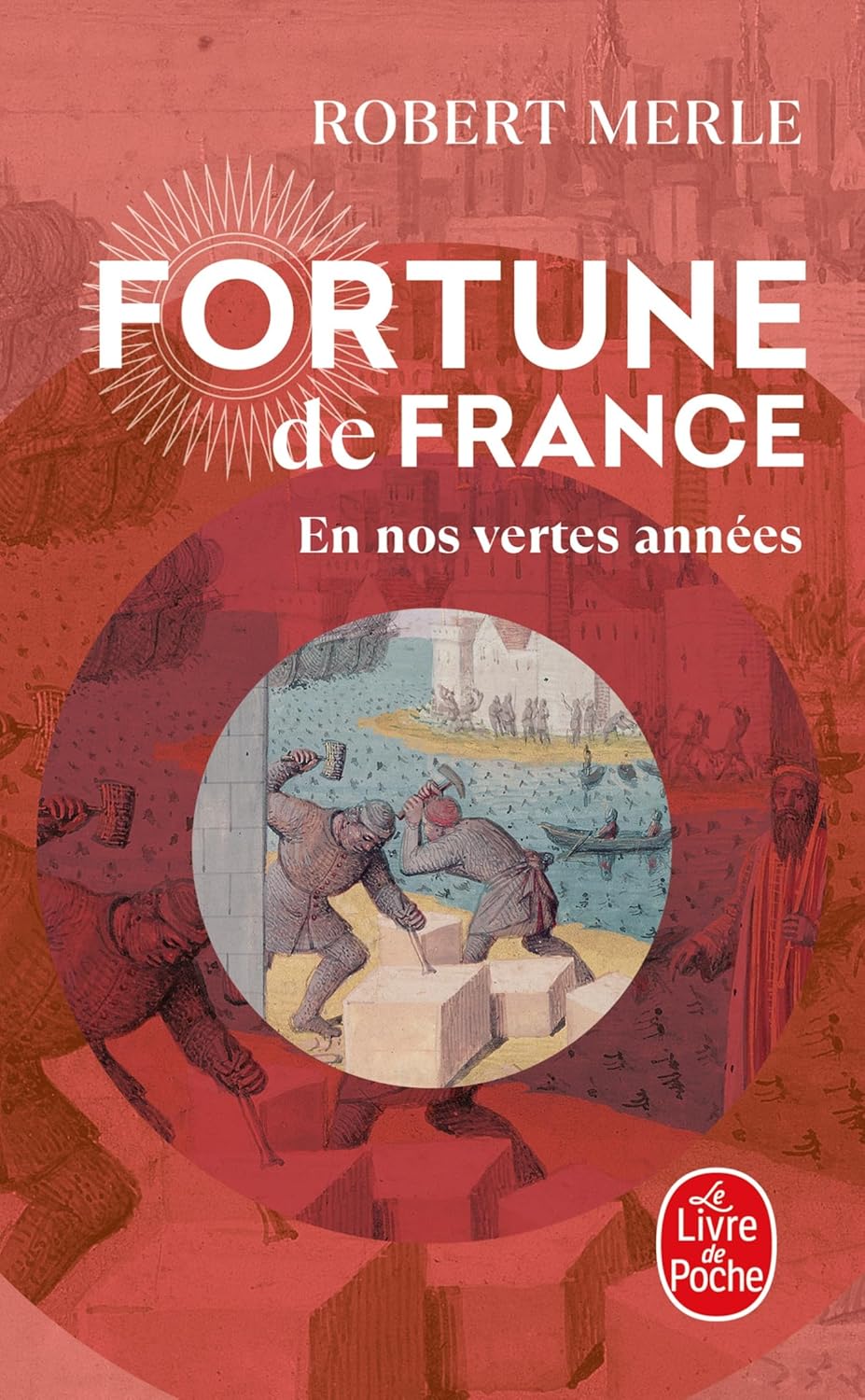
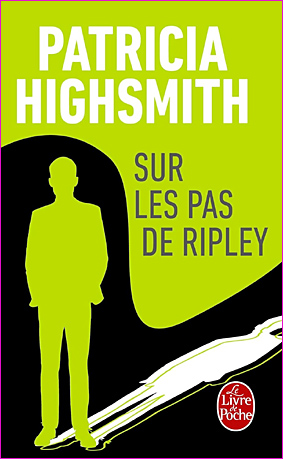

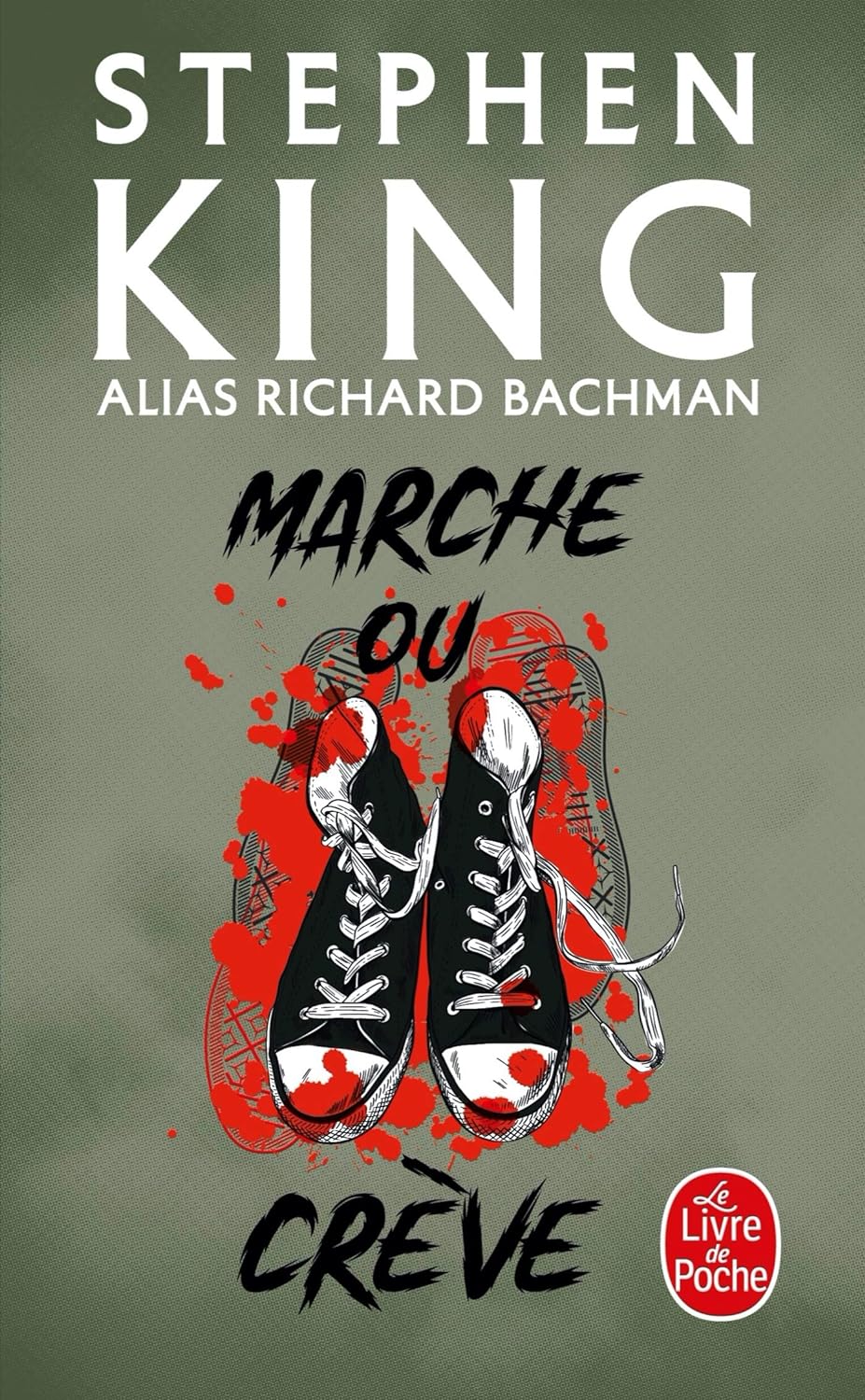














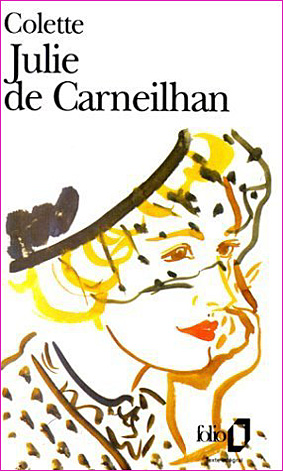
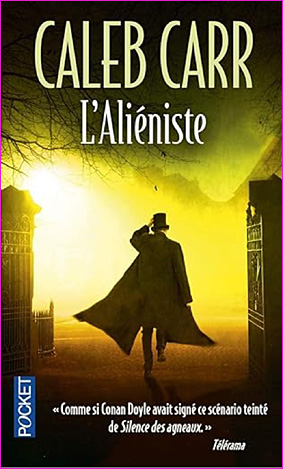

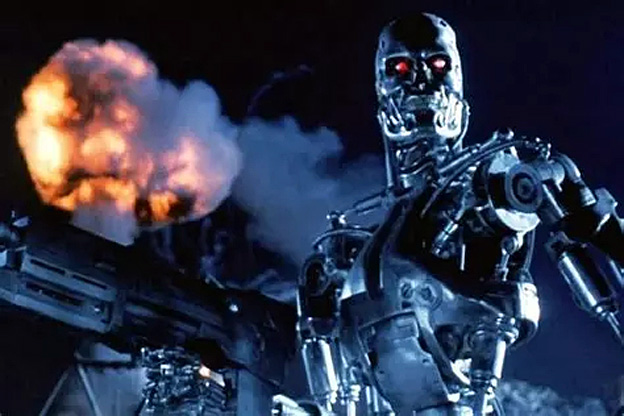






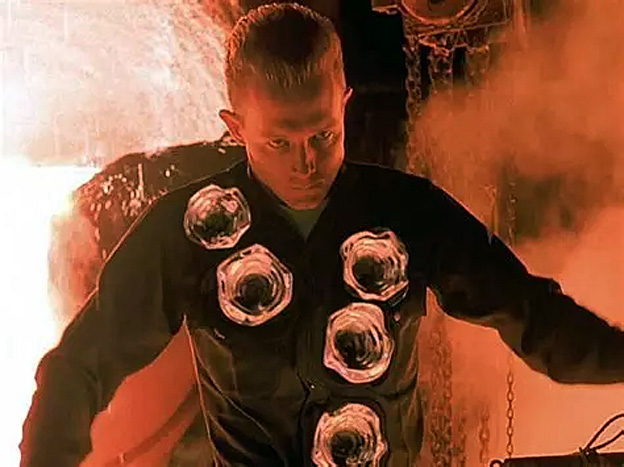




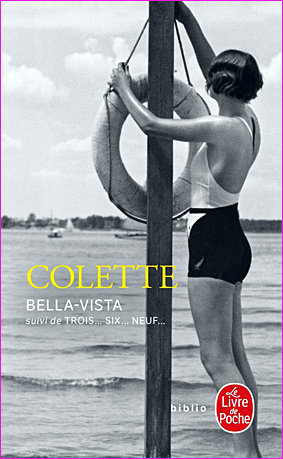
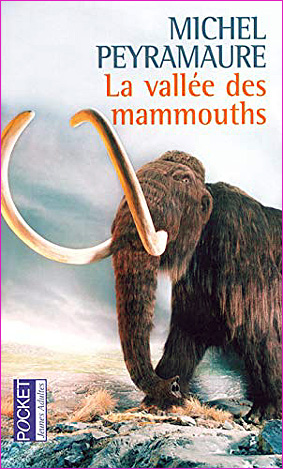
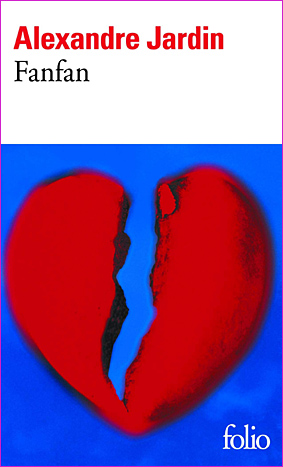
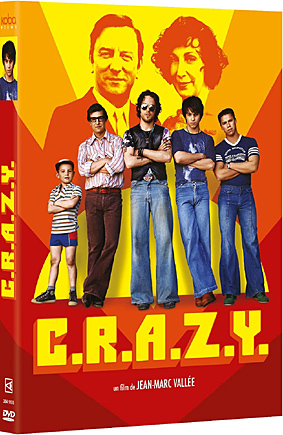

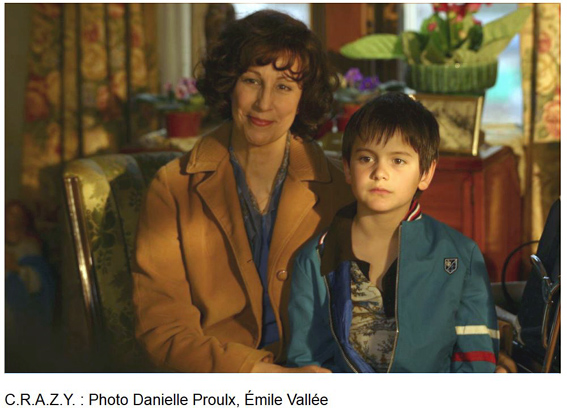












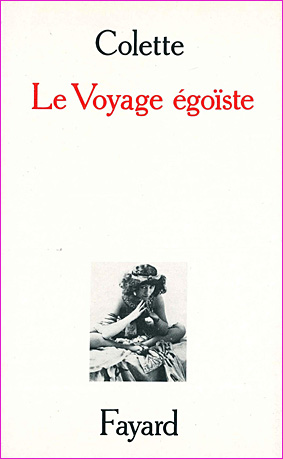
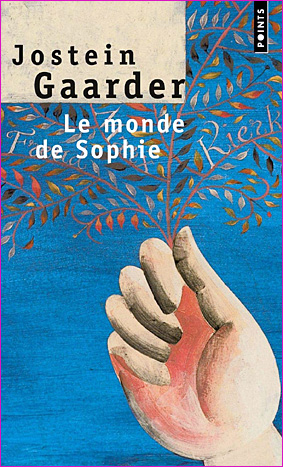
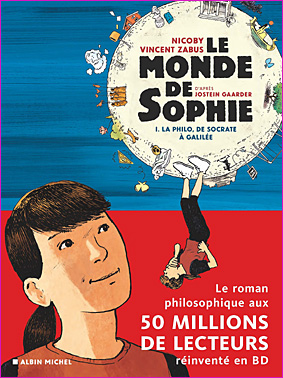
Commentaires récents