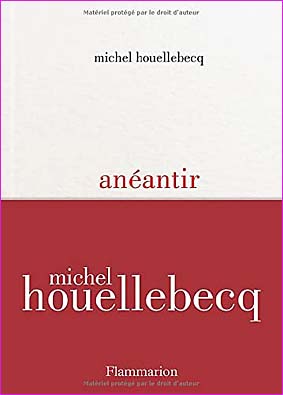
Le nouveau roman de Houellebecq est sur la fin du monde, un siècle après l’absurde guerre de 14 qui l’a déclenchée. L’Occident se suicide, malgré le rebond des boomers après la Seconde guerre mondiale qui était, selon l’auteur, la lutte implacable du Bien contre le Mal, engendrant des engendrements d’optimisme sur l’avenir une fois la Bête vaincue : le baby-boom dès 1942. Les couples se défont, la famille part à vau l’eau, le pays divorce entre le populo angoissé et contraint et les élites mondialisées individualistes hors sol. L’individu devient une monade urbaine défini uniquement par le croisement de ce qu’il est et de là où il est. La psychologie est réduite à la sociologie chez Houellebecq.
Son originalité est de parler de notre présent en le décalant de quelques années vers le futur, façon de quitter les basses polémiques imbéciles pour traquer les grandes tendances qu’il perçoit. Nous sommes en 2027 pour la prochaine élection présidentielle, alors que la nôtre 2022 n’a pas encore eu lieu. Mais Houellebecq pense que le président actuel en reprendra pour cinq ans, malgré le Rassemblement national mais à cause de Marine Le Pen. Trois fois candidate et toujours aussi nulle, elle ne peut faire la différence, d’autant que son vieux père (encore vivant à 99 ans pronostique l’auteur avec malice) hérisse toujours autant les vieux Juifs « avec ses blagues sur les fours ». Elle partie, un jeune à sa place (tiens ! Pourquoi pas une femme ? Sa nièce par exemple ? Houellebecq est-il trop misogyne ?), le parti talonnera le candidat dominant – mais sans parvenir à le battre une fois de plus, grâce à la communicante Solène Signal mais surtout la faute à un attentat contre des migrants Noirs coulés au large des Canaries : 500 morts et « les humanistes mous » qui « s’effraient ».
Paul Raison, le personnage principal, est énarque (mais ça n’existe plus depuis 2021), haut fonctionnaire du ministère de l’Economie, conseiller spécial du ministre Bruno Juge (un Le Maire moins littéraire), X Mines ayant dirigé les trois principales entreprises d’État et reconduit dans ses fonctions pour son succès à assurer la croissance en « s’asseyant sur les directives européennes » lorsqu’elles étaient contraires à l’intérêt national. La France est « too big to fail » selon Houellebecq pour que l’UE la sanctionne vraiment alors que la Chine et les Etats-Unis sont en guerre économique et entraînent le monde entier. Aucun « allié », chacun pour soi, autant le reconnaître et faire avec. Paul est marié avec Prudence, haute fonctionnairesse énarque elle aussi, mais à la Direction du Trésor où elle s’occupe de politique fiscale.
L’anéantissement du titre concerne tout le monde.
Un groupe de terroristes verts, « anarcho-primitivistes » (p.376) veut ramener l’humain au paléolithique pour sauver la planète et s’attaque militairement aux porte-conteneurs du commerce mondial et aux entreprises de haute technologie. La magie noire et la sorcellerie, revivifiées par les courants New Age, s’attaquent aux esprits pour les amener à vénérer la Nature et la Terre – mystique de l’écologisme qui grandit. Prudence le subit, tête bien pleine mais pas trop bien faite, évidemment convertie vegan. Est diffusée en outre sur Internet l’image du Baphomet, démon musulman qui est Mahomet vu par les chrétiens médiévaux.
La maladie ou l’accident s’attaquent aux vieux boomers de la génération précédente qui ont bien joui et bien vécu mais sombrent dans l’extrême dépendance : le père de Paul est paralysé et ne communique plus que par les yeux, le père de Prudence est en fauteuil roulant après un accident de voiture où son épouse est morte. L’amertume de l’existence génère stérilité, suicide ou cancer parmi les descendants adultes qui ne voient plus l’intérêt de vivre pour consommer et travailler sans but ni avenir : Paul et Prudence n’ont pas d’enfant, Aurélien le petit frère tard venu et mal aimé de Paul n’a qu’un enfant inséminé et conçu par GPA par son égoïste de femme, journaliste aigrie et féministe dominatrice, qui a poussé la perversité jusqu’à choisir un inséminateur autre que son mari et Noir de surcroît ! L’objet-enfant, d’ailleurs plongé sans cesse dans ses jeux vidéo et largement asocial, est pour elle un faire-valoir « de gauche » : du genre voyez comme je suis tendance, progressiste, tournée vers l’avenir ! Aurélien s’en suicide, ayant raté sa vie, son couple et son amour tardif pour une aide-soignante venue du Bénin. Quant à Paul, il se découvre un cancer de la mâchoire qui le tuera à brève échéance, une fois les élections passées et remportées par son ministre flanqué d’un histrion président de com’ en faire-valoir, en attendant le retour du président actuel puisque l’ineffable Hollande a fait modifier la Constitution pour qu’un président « normal » ne puisse accomplir plus de deux mandats consécutifs. Poutine a montré comment contourner cette niaiserie si « le peuple » le désire. Raffinement, le prochain gouvernement va proposer d’abolir carrément la fonction de Premier ministre en modifiant la Constitution.
C’est déprimant mais allègrement écrit, même si Houellebecq abuse des « par contre » qui est une incorrection selon Voltaire et rejeté dans le langage commercial selon l’Académie (mais Houellebecq n’écrit pas un bon français). Les comptes rendus de rêves à répétition faits par Paul alourdissent l’histoire sans rien apporter d’original ni que l’on en trouve une justification. Il confond aussi chez les vieillards l’arthrite (qui est une inflammation) et l’arthrose (qui est une usure). Une incohérence surgit même dans l’âge du père de Paul, ancien de la DGSI donc gardien de la sécurité qui a failli (il n’a pas vu venir les attentats écolo terroristes) : il est dit p.109 qu’il est né en 1952 puis p.64 qu’il a 77 ans – alors que l’histoire est située p.227 en 2027 alors qu’il devrait s’agir de 2029. Il y a encore d’autres erreurs factuelles comme le whisky Jack Daniel’s (qui s’écrit avec apostrophe), ou l’itinéraire alambiqué en métro pour aller d’Austerlitz à Gare du Nord (Houellebecq ne doit pas prendre souvent le métro et a la flemme de consulter un plan), mais passons.
Ses personnages sans qualités, soumis aux circonstances, sont ballottés par leur destin ; ils n’ont aucune prise sur leur existence, enserrés dans leurs déterminations sociales. En ce sens, ils ne sont pas des héros, individus remarquables pouvant devenir légendaires, mais plutôt des créatures emblèmes d’un univers sans but. Les corps ne jouissent pas jusqu’à l’esprit, ils n’ont que le plaisir de la gymnastique queutarde ou vulvaire, même lorsque la bite éjacule et que la vulve mouille il ne s’agit que de plaisir solitaire. Houellebecq aime transgresser par le cru du propos, sans offrir la moindre perspective. Ce pourquoi il écrit plat comme un marmonnement de monomaniaque.
Ainsi évoque-t-il Aurélien à 10 ans harcelé par ses copains (thème tendance), dont un grand Noir de son âge qui le fait attraper et tenir par ses sbires blancs avant de lui pisser à la gueule (pire après la puberté ?), ou encore le même à 13 ans qui va branler le vieil homo du dessus par faiblesse, soumission. Le garçon, dernier né de la fratrie loin derrière Paul l’aîné et de Cécile l’intermédiaire, catho mystique votant Le Pen dont le mari, Hervé, est « notaire au chômage » : tout fout le camp vous dis-je. Aurélien au beau prénom romain n’a jamais été aimé, ni par sa mère réfugiée dans ses sculptures qui ne valent pas grand-chose, ni par son père qui ne l’a pas voulu et préfère ses jeux d’espion. Trahie, une fois de plus, par la mégère qu’il a prise pour femme (on ne sait vraiment pas pourquoi), il se pend. Lorsque Paul prend une pute pour la soirée afin de tester si sa cinquantaine reste toujours vivace alors que sa femme tend à revenir au sexe avec lui, il s’aperçoit qu’il s’agit de sa nièce qui finance ainsi ses études (autre thème tendance).
Le sexe, l’idole des boomers, étalé partout après 1968 comme un nirvana à la portée des caniches, est un leurre, un instrument de domination des mâles sur les femelles, des mâles sur les mâles ou des femelles sur les mâles. C’est une illusion réservée à quelques happy fews ; pour le commun, c’est une gêne ou une corvée et pour Houellebecq, de plus en plus d’urbains se prostituent ou deviennent asexuels de gré ou de force. Solitaires, esseulés, isolés. « A quoi bon installer la 5G si l’on n’arrivait simplement plus à rentrer en contact, et à accomplir les gestes essentiels, ceux qui permettent à l’espèce humaine de se reproduire, ceux qui permettent aussi, parfois, d’être heureux ? » p.366. D’ailleurs, pour l’auteur, les enfants sont des tyrans égoïstes, touchants bébés, mignons encore à 8 ans mais dissolvant le couple des parents à l’adolescence (en les empêchant de baiser) puis détruisant chacun de ses parents. Où a-t-il vu jouer ça ? Le lecteur se demande parfois dans quel monde dépressif imaginaire vit l’écrivain…
Les individus, le couple, la famille, la cité, le système-monde : tout y passe dans l’obscure volonté « d’anéantir », une pulsion de mort occidentale qui rappelle que toute civilisation est mortelle. Mais le public aime ça (pas les intellos qui font la fine bouche malgré les pipes) et les Allemands aussi : c’est dépressif, donc dans leur tempérament contemporain, récent pour les Français qui se voient leur pays dégringoler des puissances du monde, plus ancien pour les Teutons après les excès du nazisme. Ainsi les deux peuples se rejoignent-ils dans l’après-pandémie, le courant No future depuis Maurras, Mauriac, Jouhandeau, Céline, Drieux, Vian, Genet, Cioran, Blondin, Raspail, Kundera, Desproges, Ernaux, Muray, Modiano, Guibert, Houellebecq, Carrère, Dantec, Tesson (et j’en oublie) – pas vraiment « de gauche » ni du moins tournés vers l’avenir et la vie – expliquant le lent suicide démographique et mental du cœur européen et la « réaction » politique évidente vers la droite radicale, le repli dans les frontières et le local « écologiste », le « mur » polonais, le rejet de l’immigration (il est vrai excessive et trop rapide pour une assimilation traditionnelle). Houellebecq est-il zemmourien ? Il s’en fout probablement, il raconte une ambiance. Les querelles de bac à sable sur qui a la plus grosse ne l’intéressent plus ; seul l’intéresse à mon avis le plaisir du voyeur, de l’acteur de jeu vidéo dont le métavers est la société française contemporaine.
Quant au livre objet, il est somptueusement édité, participant du plaisir de lecture. Couverture cartonnée, blanche, le titre en rouge sobre, sans aucunes majuscules dans cet aplatissement général qui donne le ton, un signet rouge pour marquer sa page.
Michel Houellebecq, Anéantir, 2021, Flammarion, 734 pages, €26.00 e-book Kindle €17.99


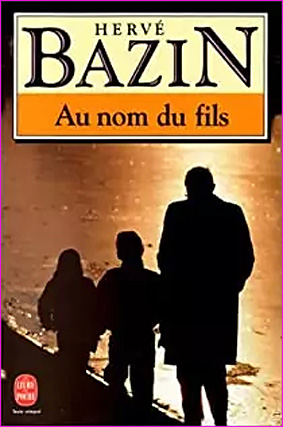
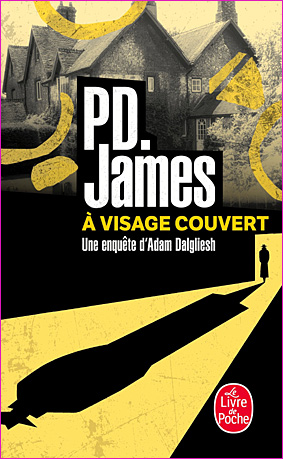
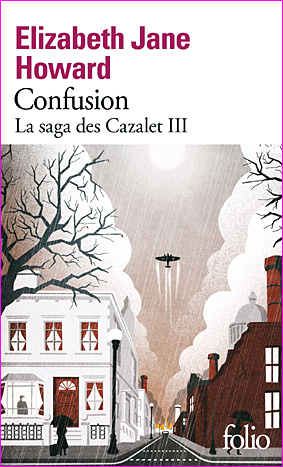
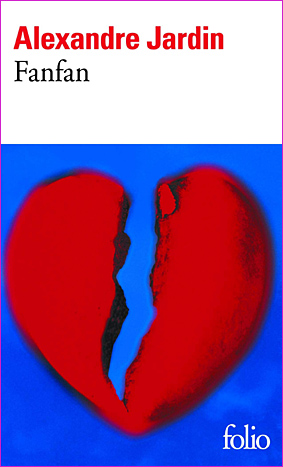
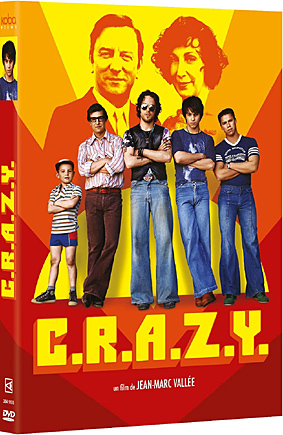

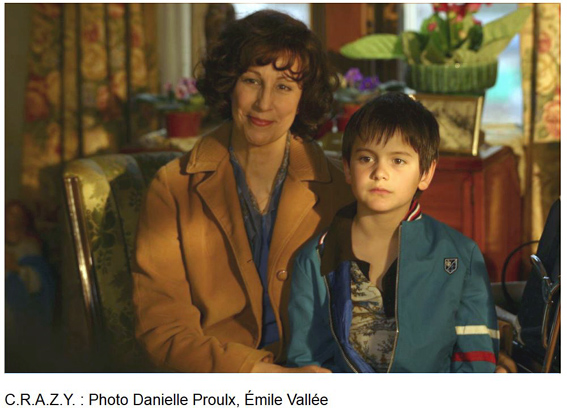



















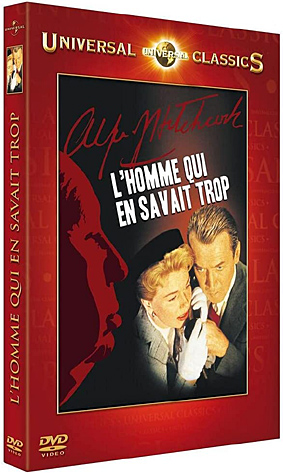













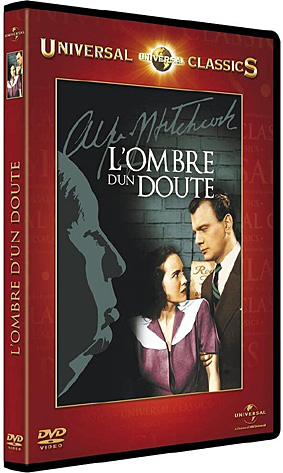








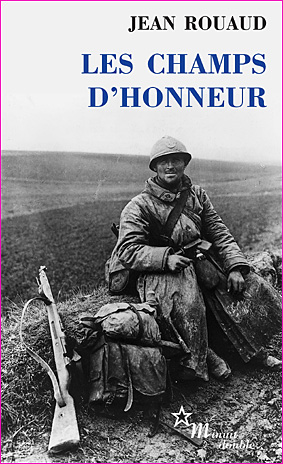


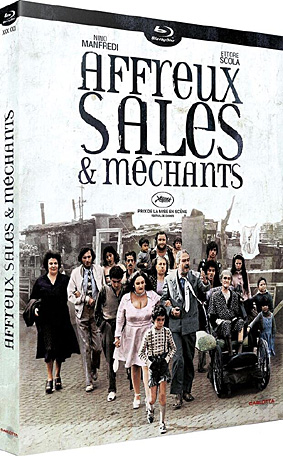














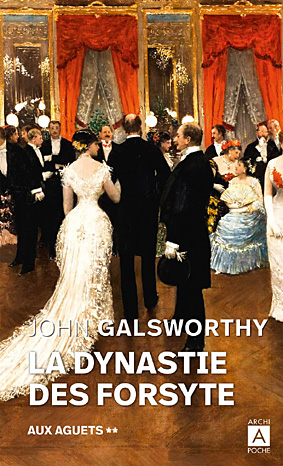
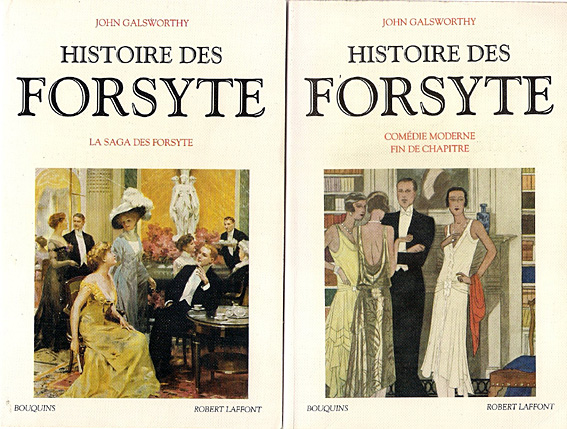











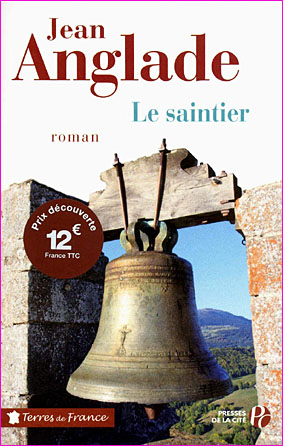
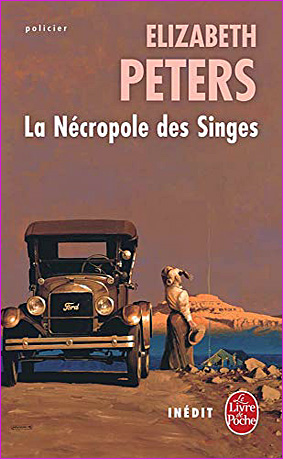
























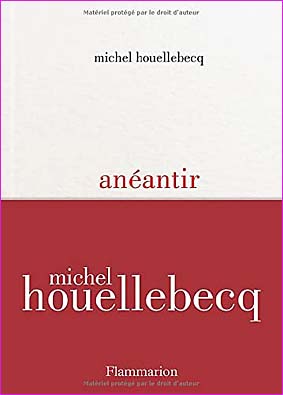








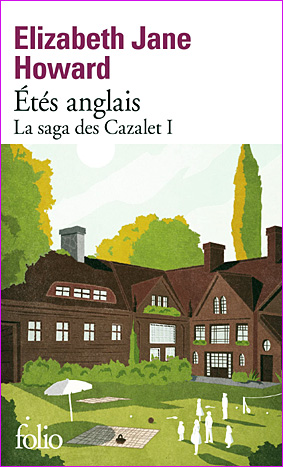





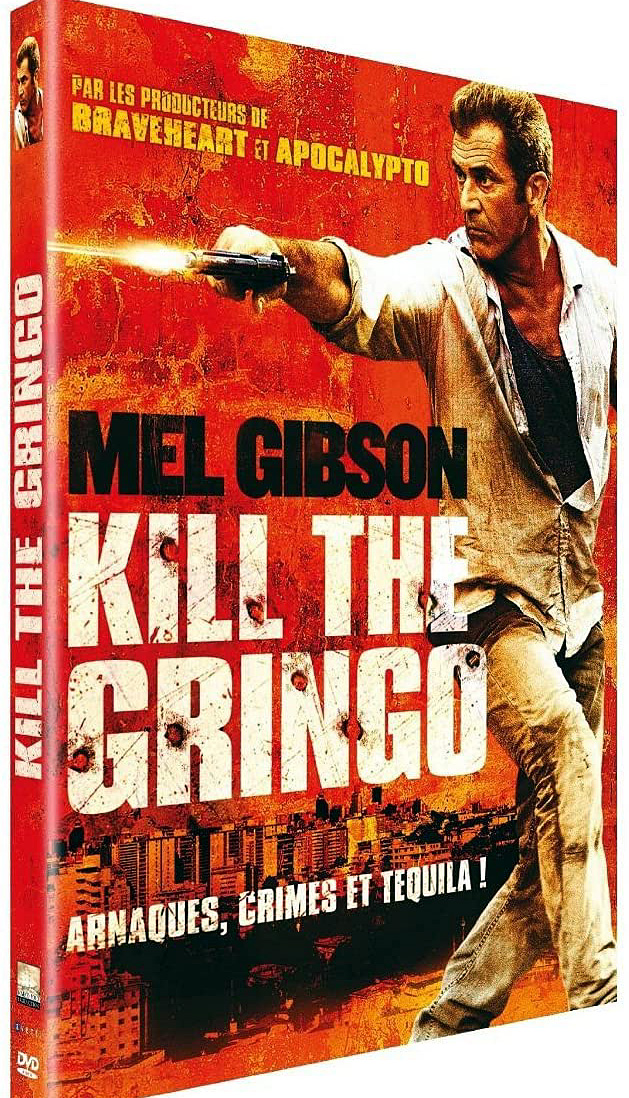



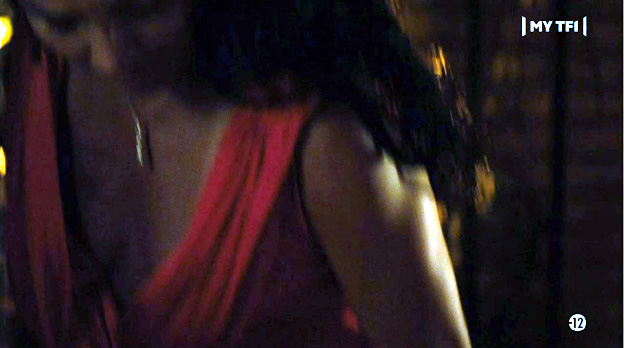





Commentaires récents