
Comment vit une entreprise multinationale ? Comme un être vivant, elle est soumise aux affres de la création, au vieillissement, au renouvellement pour grandir et garder sa santé, à une concurrence féroce, mais aussi aux aléas de l’existence. Le groupe hôtelier bâti par le fondateur a bien réussi. Le vieux, après 80 ans, a passé la main à son fils Jean, qui est moins entrepreneur que gestionnaire – il faut un tempérament pour cela (la dureté, l’égoïsme, la volonté). Le fondateur garde 80 % des actions à son bon vouloir, 20 % étant données à son ex-maîtresse Ingrid, et refuse toute entrée en Bourse comme toute arrivée d’un autre investisseur dans l’univers familial. Mais les circonstances vont changer.
D’abord par un caprice de vieillard : la donation faite à Marie, sa gouvernante de la cinquantaine qu’il aime bien. Il lui donne aussi 20 % des parts de l’entreprise, ce qui dilue automatiquement le capital. Lorsque le Fondateur va décéder, l’entreprise sera fragilisée par la multitude des héritiers qui se connaissent mal, issus d’unions différentes. Le Fondateur a eu Édith et Jean de son mariage, le couple a deux enfants, Jeanne et Carole ; Jean gère les affaires désormais et Jeanne s’investit dans le groupe. Puis il a eu pour maîtresse Ingrid, laquelle a eu deux fils londoniens, Yann et Timothée. Enfin Marie, laquelle est mariée mais n’a pas d’enfant. Seuls les héritiers directs sont actionnaires, leurs enfants n’ont pas de parts, ils hériteront au décès de leurs parents. Mais l’avenir exige qu’ils soient peu à peu associés à l’entreprise, sous la forme d’un pacte d’actionnaires des parents qui les engage pour dix ans, afin d’éviter tout délitement du capital et prise de pouvoir intempestive.
Il y a aussi les pièces rapportées : les conjoints des mariés comme André, mari d’Édith, Helmut, petit ami de Carole, Georges, mari de Marie. Puis les avocats et banquiers conseils, le directeur général du Groupe qui travaille bien. Ils ne sont pas au capital ; peut-être faudrait-il les intéresser pour qu’ils restent dans le cercle ?
Tout cela cogite, s’agite, bouillonne. Rien n’est fait mais il faut prévoir l’avenir – toujours incertain. Le Fondateur a déjà eu plusieurs alertes cardiaques, il n’est pas éternel. Des investisseurs du Golfe se sont montrés intéressés à prendre des parts, prouvant l’intérêt du marché pour le Groupe. Des opportunités naissent pour investir dans des emplacements de luxe au centre de Paris et de Milan et, pourquoi pas, sur l’île des milliardaires, Saint-Barthélémy. Il faut étudier soigneusement le marché, les coûts, le financement, les tendances à venir. L’entreprise est une jungle (« jungle corporate », dit volontiers l’auteur dans la langue du capitalisme). Les petits sont croqués par les gros, les prédateurs sont rois, le sentiment n’a pas sa place. L’efficacité, au contraire, doit régner à tous les bouts de la chaîne. Les erreurs doivent être comprises, réparées, des leçons tirées.
Justement, un cyclone violent arase l’île de Saint-Barth, rendant imprévisible et coûteux tout projet d’investissement de luxe à long terme. Des maisons d’hôte suffisent, mais ce n’est pas le créneau de l’entreprise. Pire, un virus chinois inconnu commence à opérer ses ravages un peu partout dans le monde ; l’Italie est très touchée et le projet à Milan n’est plus d’actualité. Il faut tenir durant la crise – qui dure plusieurs mois. Une fois la crise passée, les liquidités tant bien que mal restaurées et les clients affaires ou loisirs (« business/leisure » dit l’auteur inutilement en globish), il faut tirer parti des opportunités d’investir. Qui ne croît pas stagne et meurt, dans la jungle des affaires.
D’où l’irruption de Charles, anglo-franco-grec, en bref un métèque qui a trouvé la façon de s’imposer dans la société multinationale en entreprenant plus audacieusement que les autres. Il a racheté et rénové des hôtels vieillissants à Londres et a réussi à créer un groupe conséquent. Mais la crise pandémique rend difficile pour son entreprise d’honorer ses dettes, considérables. D’où l’exigence de s’adosser au Groupe de Jean. Les actionnaires y sont favorables, non sans avoir râlé un peu à cause des dividendes qui seront réinvestis, donc pas distribués. Et Jeanne, qui se prépare a de hautes fonctions dans le Groupe à l’avenir, est sensible au charme et au rentre-dedans de Charles.
D’ailleurs Antoine, Directeur-général du Groupe, est pris la main dans le sac des rétrocommissions pour certaines fournitures aux hôtels : il est viré malgré ses bons (mais pas loyaux) services. Pourquoi Charles ne le remplacerait-il pas ?
L’auteur s’ingénie à montrer tous les aléas de l’entreprise, surtout multinationale. Il démontre que les relations humaines sont aussi importantes que le calcul correct des risques et des rentabilités : choisir les bons employés, les surveiller, veiller à leur intéressement ; choisir les bons banquiers, les bons conseils, conserver avec eux des relations amicales et professionnelles de long terme. Qu’une division des actionnaires ne peut qu’être préjudiciable à tous, par exemple en introduisant un loup prédateur dans la bergerie qui fonctionne bien. En bref, c’est la jungle. Il faut y retrouver ses réflexes de survie, doublés d’expertises de haut niveau. Un entrepreneur se doit être complet.
La psychologie est un peu sacrifiée à la description minutieuse des manœuvres et des risques qui surviennent à tout moment, mais voici un bon livre où des « faits réels » sont utilisés pour une fiction éclairante sur les requins de la finance à l’affût des pachydermes de l’entreprise.
Jean-Jacques Dayries, Jungle en multinationale, 2023 éditions Code 9 Groupe Philippe Liénard, 297 pages, €24,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
Les autres romans de Jean-Jacques Dayries déjà chroniqués sur ce blog



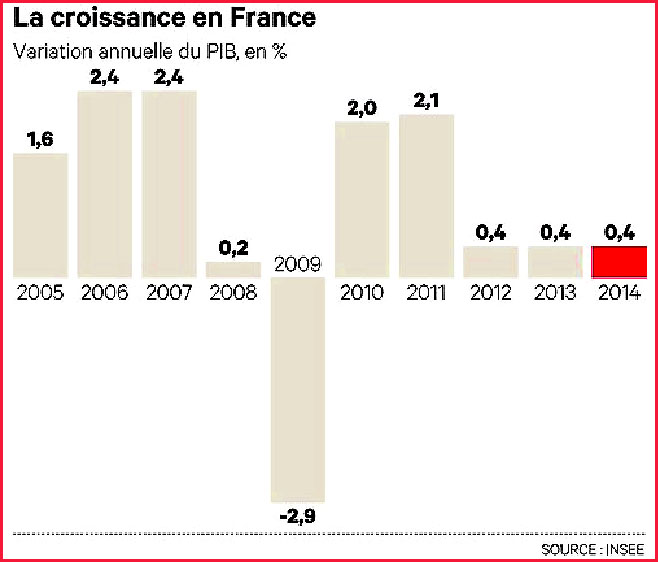
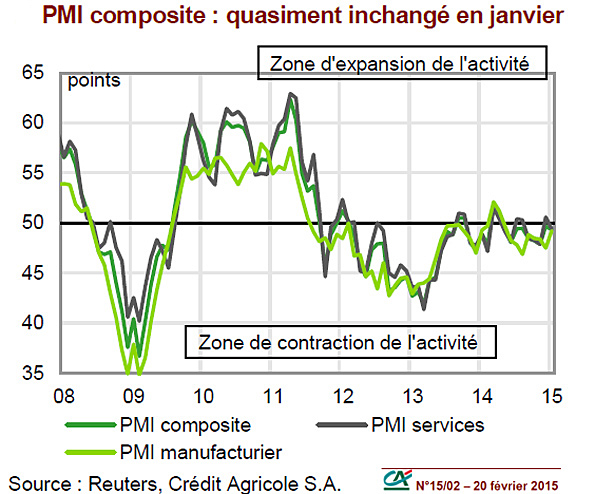




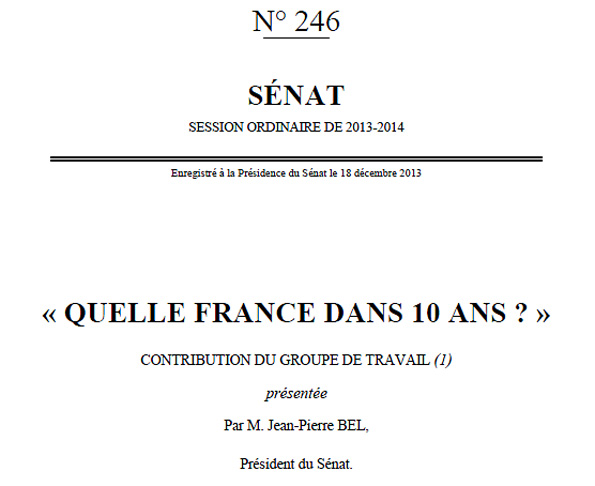



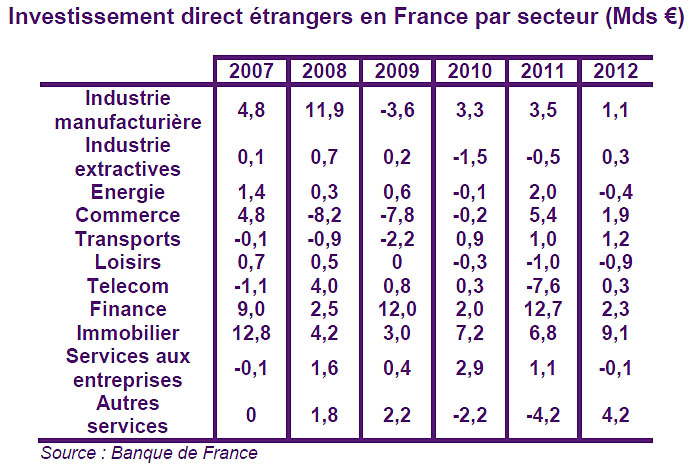


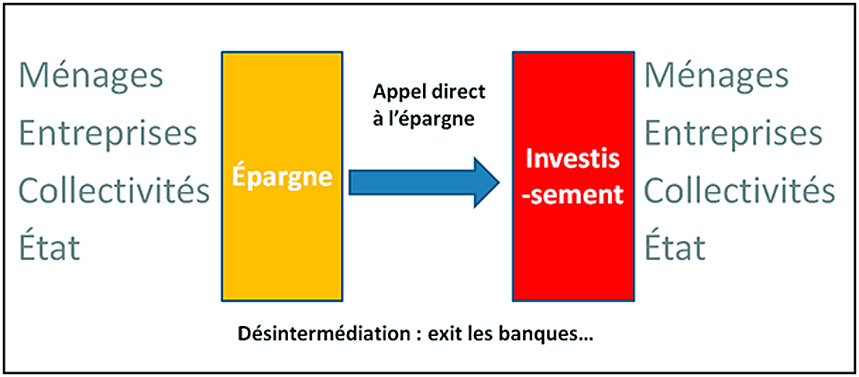



Édouard Tétreau, Analyste
La vraie vie vécue des années folles, celles de la bulle Internet 1998-2000, par un analyste en charge du secteur médias au Crédit lyonnais Securities Europe à Paris. Écrit clair, il y a de l’action à l’américaine et des exemples précis (sous pseudos pour éviter le judiciaire). Tout est vrai – j’y étais.
Mais, mieux que les anecdotes navrantes (la lâcheté Messier) ou croustillantes (le Puritain maître de la finance américaine et ses putes à Paris), une interrogation sur le snobisme social, les sursalaires indus et la course à la cupidité court-terme. La finance anglo-saxonne est une nuisance de l’économie globale, une guerre économique où « le droit », brandi par les puritains yankees, sert surtout à ligoter les autres, Européens et Japonais – alors que des hordes de lawyers et d’opportuns centres offshore à quelques dizaines de minutes de côtes américaines permettent d’y échapper.
Ce livre est écrit après l’éclatement des prémisses de la grande bulle (les valeurs technologiques en 2000 ont précédé la paranoïa du 11-Septembre en 2001 puis la comptabilité frauduleuse et l’audit mafieux en 2002) – mais avant le délire des dérivés en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008 – avec les conséquences systémiques, donc économiques, donc sociales, donc politiques dont on n’a pas encore vu tous les effets. Il décrit « comment ce théâtre de gens si savants au-dehors est en fait construit sur du sable. Le sable mouvant des fantasmes et des incohérences humaines » p.273.
Car vous pensiez que les analystes, après 5 ans minimum d’études supérieures en macroéconomie, audit, évaluation des entreprises et mathématiques financières, sont des experts capables de diagnostiquer la santé ou la maladie des sociétés cotées, de proposer des remèdes et de conseiller utilement les investisseurs ? Vous n’y êtes pas ! « Dans la formulation de son message comme dans sa conception, l’analyste doit aller au plus vite. Ce qui signifie : lire le communiqué de presse de la société, ou l’interview, ou le tableau de chiffres et, dans un minimum de temps, sortir le commentaire qui va faire vendre » p.39. Il ne s’agit pas de mesurer mais d’agiter. La bourse exige de la volatilité, des écarts de cours pour générer du business, donc de juteuses commissions. Ce pourquoi l’analyste passe plus de temps à commenter l’immédiat, appeler les clients, organiser des roadshows, qu’à analyser les entreprises. Il n’a plus « dans l’année que deux ou trois douzaines d’heures pour travailler activement sur chacune des entreprises suivies » p.174.
A son époque (2004) c’étaient les conseils d’achat et de vente aux gestionnaires de portefeuille pour faire tourner plus vite leurs actifs ; aujourd’hui (2014) plus besoin des gérants, le trading à haute fréquence, par algorithmes informatisés, s’en charge tout seul : plus besoin non plus d’analystes, ni de vendeurs, ni même de clients… Seul le marché pur et abstrait est le terrain de jeu pour les spéculateurs, entièrement déconnecté des entreprises réelles, de ce qu’elles produisent et des gens qui y travaillent.
Mais ce n’est pas que le commerce ou la bougeotte qui tord le métier d’analyste. C’est aussi la chaîne d’organisation, depuis l’entreprise jusqu’aux portefeuilles, qui incite à la stupidité. « Le processus d’investissement sur les marchés est simple : il suffit de suivre, ou de se raccrocher à la recommandation déjà émise par quelqu’un d’autre » p.49.
L’auteur l’a vécu, analyste médias dans les années flambeuses de J6M chez Vivendi (Jean-Marie Messier moi-même maître du monde, disait-il de lui-même…). « Le 6 mai [2002], deux jours après un changement de notation de l’agence Moody’s sur la dette de Vivendi, j’envoyais une note, alertant les clients investisseurs du Crédit lyonnais Securities d’un risque de faillite (bankruptcy) de ce groupe. Le lendemain, tous mes travaux furent placés sous embargo, en prélude à diverses sanctions disciplinaires. Le 3 juillet, Jean-Marie Messier quittait la présidence d’un groupe à quelques heures de la quasi-cessation de paiement » p.15.
Édouard Tétreau s’est reconverti en créant Mediafin, conseil en communication pour les entreprises. Il a publié fin 2010 ’20 000 milliards de dollars’ témoignage de trois années aux États-Unis après 2007 pour développer une filiale du groupe Axa, qui lui a fait comprendre combien la religion de la finance restait prégnante, laissant présager une bulle de la dette américaine vers 2020. L’ouvrage a été traduit en chinois, montrant combien la Chine est vigilante sur ses investissements en bons du Trésor des États-Unis…
Il y a pire que la vente à tout prix et la mauvaise organisation : l’emprise de toute une idéologie de la finance qui s’apparente à une véritable religion venue des États-Unis. Les croyants usent de mots magiques comme « création de valeur », « benchmark », EBITDA (bénéfices avant toute autre dépense), WACC (coûts du capital) et autre jargon en anglais. Lorsqu’il n’existe aucun mot dans votre langue pour traduire des concepts étrangers, vous les utilisez comme des boites noires sans savoir trop ce qu’elles contiennent. Mettant les habits d’une autre culture, vous avancez patauds, incertains, servilement scolaires. Ne comprenant pas le fond, vous singez. Non seulement vous vous abêtissez, mais vous agissez comme tout le monde pour donner le change et l’illusion sociale d’avoir compris. C’est bien ce qui se passe en analyse financière comme en gestion de portefeuille, j’en ai eu l’expérience directe personnellement (voir Les outils de la stratégie boursière, 2007).
Le « benchmark » est par exemple considéré par les directeurs de gestion français comme un garde-fou à surtout ne jamais franchir au-delà d’une étroite fourchette. La simple lecture d’un dictionnaire vous apprend que benchmark signifie en anglais utile le niveau du maçon : il est donc une mesure, pas un carcan ! Un maçon qui pave un trottoir parfaitement horizontal, selon le niveau à bulle, est un mauvais ouvrier doublé d’un imbécile : l’eau va stagner dans les creux. Le trottoir doit être en légère pente vers le caniveau pour remplir sa fonction de trottoir, le benchmark sert de référence pour marquer cette pente. Pas en France – où l’on doit obéir : à la hiérarchie qui n’y connais rien, à l’abstraction scolaire du mot anglais mal compris ! Quand on ne comprend pas on imite, quand on n’est pas pénétré de l’esprit on régurgite la leçon mot à mot. « Je mets d’ailleurs au défi n’importe lequel des dirigeants des vingt premières banques européennes d’être capable de comprendre, et accessoirement de faire comprendre à ses administrateurs et actionnaires, ce qui se passe exactement dans ces boites noires de l’industrie financière que sont les départements d’ingénierie financière et de produits dérivés… » p.75. M. Bouton, PDG de la Société générale, l’a illustré à merveille lors de l’affaire Kerviel.
Édouard Tétreau prend le même exemple en analyse avec la « shareholder’s value », maladroitement conçue en français comme « créer de la valeur pour l’actionnaire ». Or on ne « crée » pas de valeur, on en a ou on en hérite, l’entrepreneur ne crée que de la richesse (du flux), pas de la valeur (du stock). L’analyste français, par ce concept mal compris, ne va donc s’intéresser qu’à l’actionnaire, à la distribution de dividendes, au retour sur investissement du portefeuille. Alors que la base de la richesse de l’entreprise, celle qui va permettre qu’elle soit durable et puisse investir pour générer du bénéfice (à répartir ensuite en partie aux actionnaires apporteur de capital), est mesurée par la rentabilité : le retour sur fonds propres en fonction du risque assumé. C’est cela qu’il faut analyser, pas la distribution.
Plus qu’un simple témoignage de ces années stupides, ce livre est une sociologie de l’entre-soi parisien où les gens d’un même milieu, sortis des mêmes écoles avec les mêmes concepts abstraits, baignant dans le même jargon anglo-saxon qu’ils comprennent mal, font du fric en toute bonne conscience en enfumant les clients – qui sont, au total, vous et moi, les assurés comme les retraités. Mais ce qui est vrai de l’analyse financière l’est aussi en d’autres domaines : les médias, l’engouement web, les capteurs solaires, en bref tout ce qui est trop à la mode et qui fait délirer comme, il y a 4 siècles, les bulbes de tulipes !
Édouard Tétreau, Analyste – Au cœur de la folie financière, 2005, Prix des lecteurs du livre d’économie 2005, Grasset, 283 pages, €4.96 (occasion) à 18.34 (neuf)
Son site personnel
L’auteur de cette note a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière’ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009).