Article repris par Medium4You.
Oui ! répondent en chœur deux économistes. Ce sont deux femmes, ce pourquoi elles portent un regard différent des hommes sur la matière ; elles sont passées par la fonction publique, ce qui leur a permis de mesurer la dégradation politique du système social ; elles ne sont pas politiques, ce qui leur laisse un regard de technicien sur l’avenir. Ce qu’elles proposent est donc une richesse et un handicap. La chance à saisir pour un pays qui se pose des questions sur son avenir et donc sur son identité ; l’infirmité de la courte vue, du déficit abyssal et de la ponction fiscale déjà au sommet des pays comparables. Quel politicien pourra reprendre cette utopie pour sa campagne 2012 ? On se demande – d’où l’intérêt de lire ce livre.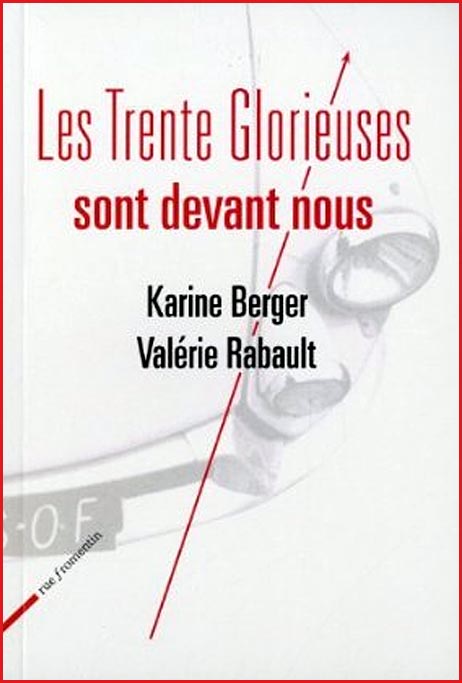
Foin de la crise économique, disent les auteurs, ce n’est qu’actualité immédiate. Projetons-nous de suite dans l’utopie : cet an 40 où tout ira bien, 2040 en inverse de 1940. La France y sera le pays d’Europe le plus prospère et le plus peuplé, avec pas moins de 80 millions d’habitants, plus que l’Allemagne. Mais il n’est pas dit de quelle culture : le melting-pot français, appelé hier « intégration » aura-t-il fonctionné ? L’Éducation nationale aura-t-elle réussi à redresser la barre de l’échec à lire-écrire-compter pour les sortants sans qualification du collège ? La recherche aura-t-elle ses bataillons d’ingénieurs motivés dès l’enfance, et de techniciens bien formés nécessaires à son expansion ? Rassurons-nous, on nous assure que tout cela n’a pas d’intérêt car le taux de chômage est retombé à 5,5 %, ce qui rassure les classes sociales en déclin et leur permet d’accepter les autres, tous ceux qui ne sont pas comme eux.
Comment cela a-t-il été possible ? C’est très simple, les idées étaient dans l’air dès 2007 avec la commission Attali. Il s’est agi de faire émerger de façon volontariste des champions nationaux dans l’industrie, surtout énergie (avec un mixte de solaire et de nucléaire) et chemin de fer, vieux tropisme centraliste d’État. On peut se demander si cette palette industrielle n’est pas un peu courte… Le nouveau cycle fait la part belle aux technologies de l’information et l’on ne voit guère où elles peuvent se nicher dans le train et l’énergie. Évidemment il a fallu lancer un « grand » plan d’investissement auprès duquel celui de la commission Attali a fait pâle figure. Mais il fallait rattraper toute une génération perdue sous Mitterrand et Chirac. Il a donc été nécessaire de négocier âprement avec les Allemands qui ont horreur de la dépense non financée dans un système monétaire commun. A été mise en œuvre une enveloppe fiscale européenne analogue à feu le serpent monétaire, un couloir limité dans lequel se tiennent tous les pays afin de limiter le dumping.
Ah oui, petit détail : la relance de l’immigration. Elle était indispensable pour servir l’ambition industrielle, nécessitant des bras jeunes et des cerveaux neufs. Il n’est pas dit d’où elle vient, mais l’on peut supputer qu’il s’agit de pays francophones, plus quelques centaines de milliers de Chinois parce qu’ils sont trop nombreux en Chine et qu’ils y manquent de femmes.
S’agit-il de méthode Coué ? D’optimisme systématique pour se poser contre le pessimisme ambiant ? La ‘Société de confiance’, dont parlait Alain Peyrefitte dans sa thèse, peut-elle se régénérer simplement par volontarisme d’État ? Pour ces auteurs femmes, « le modèle social français » si archaïque, si rigide, si décrié, n’est pas le problème mais la solution. Il ne marche plus si l’on ne considère que la dépense obligatoire, la protection sociale. Mais il fonctionne très bien si on le met en regard de la quantité de biens produits pour un même montant de ressources. En rationalisant, on consomme moins d’énergie et moins de matières premières importées, ce qui augmente d’autant le pouvoir d’achat des Français. Il suffisait d’y penser.
A condition de respecter la devise liberté, égalité, fraternité.
Liberté ? Elle ne naît pas toute armée dans les cerveaux français, plus tentés par la fonction publique protégée que par l’entreprise : 77% des jeunes rêvent d’être fonctionnaires… La France reste sous-investie car le privé se développe ailleurs, là où les marchés s’ouvrent et offrent une population jeune avide de produits de qualité française. Il faut donc que l’État retrouve son rôle d’incitateur et d’encadrement par ses commandes publiques. Le budget, en déficit permanent depuis 1974, ne le permet plus, d’où le grand plan volontariste. S’enclencherait alors un cercle vertueux, là aussi fort libéral, où le fait d’investir redonne le goût du risque d’entreprise, ce qui favorise en retour l’investissement… donc l’emploi. Et tout le monde est content.
Égalité ? Pour les auteurs, il faut que chaque citoyen participe au progrès – c’est là une conception libérale au sens noble où la solidarité est une convergence d’intérêts. L’augmentation des salaires (donc des cotisations) permet la protection sociale et celle-ci participe à la productivité des Français ; elle n’est pas un boulet qui coûte mais un investissement rentable qui fait que chacun travaille mieux et avec moins de craintes pour l’avenir.
Fraternité ? Il réside dans ce mélange unique de service public à la française, d’ouverture européenne âprement négociée, et d’immigration ouverte pour augmenter la richesse du pays.
 L’intérêt du livre en 2011 est que les auteurs tiennent à chiffrer leur plan, ce qui est assez rare dans l’intellocratie française pour le souligner. Ils retiennent 5 indicateurs clés : le taux de croissance, la productivité des ressources, le taux de pauvreté après transferts sociaux, le nombre d’années de vie en bonne santé, et la consommation d’énergie renouvelable.
L’intérêt du livre en 2011 est que les auteurs tiennent à chiffrer leur plan, ce qui est assez rare dans l’intellocratie française pour le souligner. Ils retiennent 5 indicateurs clés : le taux de croissance, la productivité des ressources, le taux de pauvreté après transferts sociaux, le nombre d’années de vie en bonne santé, et la consommation d’énergie renouvelable.
En fait rien de bien neuf, mais remis en perspective. Cette analyse montre qu’un certain avenir est possible, il suffit de le vouloir. Pour cela, quitter ces minables querelles d’ego, attisées par des médias avides de faire du fric avec les scoops des petites phrases assassines. Quand Nicolas Sarkozy suit le rapport de la commission Attali, il est dans le vrai : pourquoi ne pas le dire ? Quand François Hollande réclame une réforme fiscale d’ampleur qui rétablisse l’égalité des citoyens devant la ponction publique, il est loin d’avoir tort : pourquoi ne pas l’avouer ? Quand Jean-Pierre Raffarin fait la bronca sur une hausse du taux de TVA sur les parcs d’attraction, il est politiquement minable au regard des enjeux : pourquoi faire semblant de comprendre ce petit intérêt catégoriel régional ? Sur la convergence économique européenne, la protection contre le dumping social chinois ou les errements de la finance, chacun a des idées qui devraient être mises en œuvre plutôt que jetées à la tête de ses adversaires.
C’est la limite du livre : l’utopie est belle et bonne, mais sa réalisation ne peut passer que par la politique – et là, tout se gâte immédiatement !
Karine Berger et Valérie Rabault, Les Trente Glorieuses sont devant nous, mars 2011, éditions Rue Fromentin, 204 pages, €19


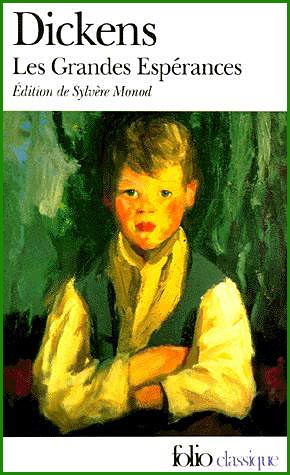


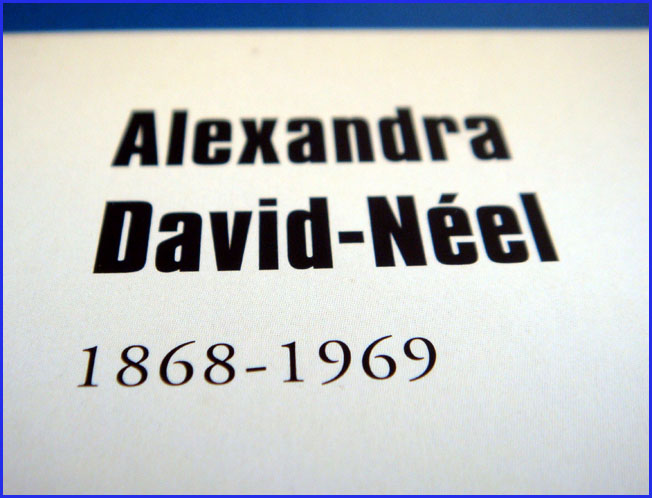
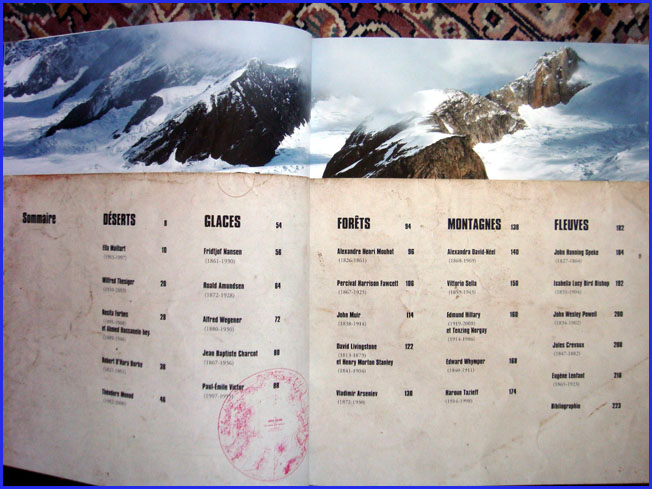

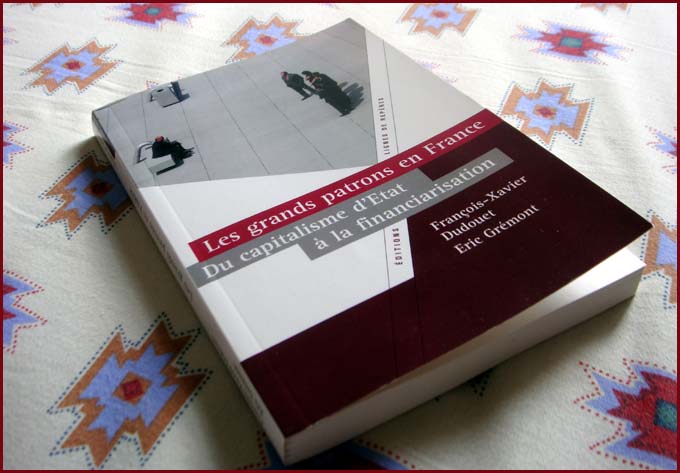
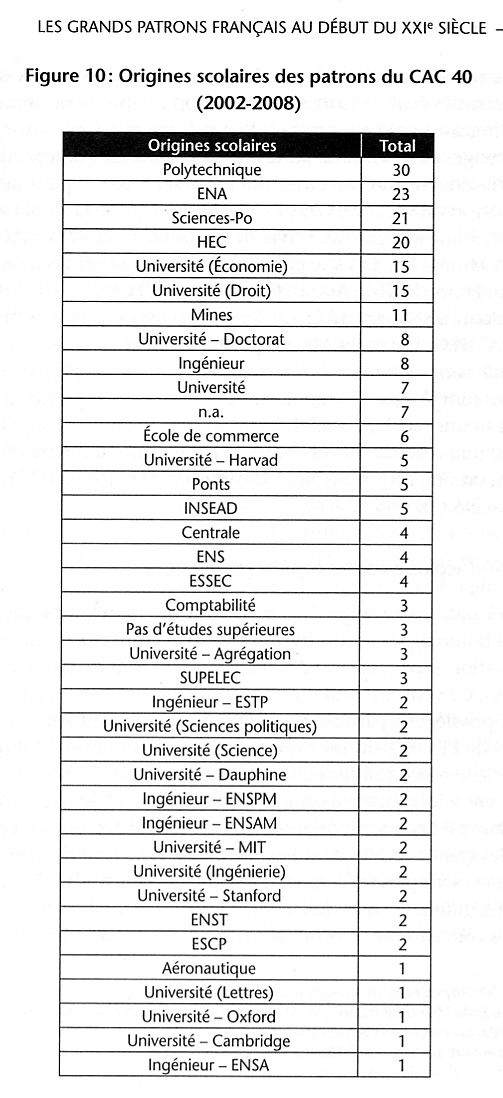
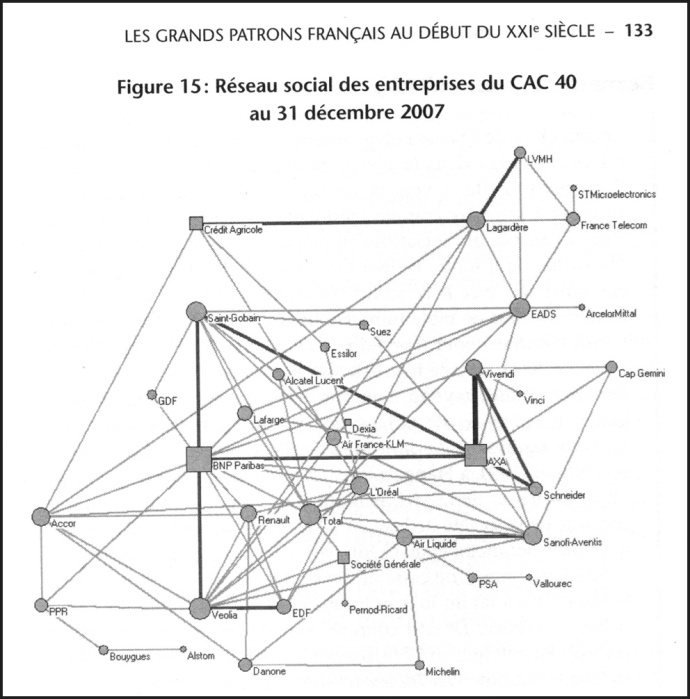












Commentaires récents