
La Grande dépression fut le second trauma de l’Amérique, après la guerre de Sécession (et avant le terrorisme de masse du 11-Septembre). La crise financière de 1929 a précipité la crise économique et sociale des années 30, qui ne sera vraiment résorbée qu’avec la guerre mondiale. Elle se double, dans les États du sud, de la tempête de poussière due à l’aridité sur des terres surexploitées par le coton. Ironiquement, cette sécheresse qui débute le roman fait le pendant au déluge qui le termine. Entre les deux, l’exil, de l’Oklahoma (terre des hommes rouges) à la Californie (où l’exploitation de la misère va encourager les rouges).
L’auteur, dans ce roman fleuve comme un testament biblique, raconte l’exil des métayers ruinés vers la terre promise que vantent les prospectus envoyés par les propriétaires fermiers aux travailleurs saisonniers pour cueillir leurs récoltes. De la vie quotidienne réaliste d’une famille, l’auteur s’élève, par des chapitres intercalaires qui font un peu prêches, à la dénonciation de tout un système. Il démonte les rouages du moteur capitaliste comme l’un des protagonistes démonte le moteur d’une guimbarde. L’épuisement de la terre et le climat amenuisent les récoltes, ce qui endette les fermiers, vite forcés à vendre leurs terres aux sociétés foncières qui, possédées par des banques anonymes, exigent du rendement par une exploitation mécanique et extensive ; le lien du travail physique à la récolte, de la terre à l’humain se brise. Les générations qui ont bâti une ferme et engendré des récoltes sont expulsées ; elles doivent recommencer leur vie ailleurs.
C’est la ruée vers l’or de la cueillette en Californie, où les pêches, les poires, le coton, les pommes, ont chacun leur saison éphémère. Près de 300 000 migrants affluent, ce qui fait peur aux possédants en même temps que cela leur permet de baisser les salaires, tout en vendant des produits de première nécessité dans les camps, plus chers qu’en ville. S’il y a surproduction, pas de cueillette mais destruction de récolte pour tenir les marges – ce qui est un scandale humanitaire, au moment où ceux qui ne travaillent plus ont faim. Ils deviennent les « Okies », terme dépréciatif tiré d’Oklahoma mais équivalent de « bougnoules ». Tout est bon pour les mépriser, penser qu’ils ne sont pas même humains ! Ils sont sales, pauvres, maigres, hargneux… D’où l’embauche de milices privées pour défendre la propriété et leur justice expéditive. Tel est le Système.
L’exil forcé est le lot de la famille Joad, dont le nom est tiré de la Bible. Car tout leur périple est imbibé d’images d’Ancien testament, comme si les Yankees, même éloignés de l’Église comme Steinbeck, ne pouvaient que boire à la même source. Sauf que les mythes du Livre sont décalés dans la réalité : l’exil n’est pas volontaire, la terre promise une vaste blague, les patriarches éliminés durant le voyage, et Moïse devenue une femme : Ma, la mère de famille autour de laquelle tout tourne lorsqu’il n’y a pas de travail ni de maison. Seule la mère assure le courant, réunissant, abritant, nourrissant, se débrouillant pour faire durer, en attendant que les hommes remplissent enfin leur fonction de protéger et de rapporter de l’argent.
Les grand-père et grand-mère morts en route, Noah, le fils aîné un peu différent s’installe au fil du courant du premier fleuve de Californie, comme le Noé biblique, sans que l’on sache s’il va trouver son pharaon. Tom, le second fils qui vient de sortir de prison où il a purgé quatre ans sur sept, libéré pour bonne conduite après avoir tué un copain de beuverie qui l’avait planté au couteau, ne peut s’empêcher de réagir avec violence contre l’injustice. Ce sera sa croix comme Simon Pierre, l’adjoint de Jésus-Christ sur lequel bâtir son église. Ce J-C est dans le roman Jim Casey, ex-pasteur qui a perdu la foi divine et cherche une nouvelle foi humaine à tâtons : « le péché et la vertu, ça existe pas. Uniquement les choses qu’on fait » p.377. De même les fous de Dieu qui contemplent « le péché » des danseurs qui se collent aux danseuses, dans un bal bon enfant. Ces tarés du péché font plus de mal avec leur vertu en bandoulière, leur aigreur de ne pas oser le plaisir comme s’il était défendu, leur jalousie rancunière contre les gens qui vivent normalement au lieu de se torturer pour des Commandements, que le plaisir lui-même. Ma remettra à sa place une mégère de ce type, sorte d’évangéliste qui va jusqu’à la transe à éructer la description du « péché ».
Casey découvre sa nouvelle religion (« ce qui relie ») confusément dans le fait qu’être deux plutôt qu’un est le début d’un humanisme terrestre, encore mieux si l’on rassemble. Ce pourquoi, comme le Christ au Mont des Oliviers, il est frappé par les miliciens – le crâne fracassé – et que Tom, tel Pierre, saisit un gourdin pour tuer à son tour le tueur avant de fuir. Mais Jim Casey a mis en lui les germes de la nouvelle religion sociale du syndicalisme « rouge ».
Ce n’est pourtant pas l’idéal de l’auteur, ni celui de l’Américain moyen qui, comme Jefferson, préfère une communauté de petits propriétaires paisibles guidés par la raison. La grande propriété capitaliste a rompu le contrat social des Pionniers sur leur Terre promise ; la cité de Dieu reste donc à construire. Les Joad connaîtront toutes les étapes de la descente à la misère, ils boiront le calice jusqu’à la lie. Pauvres comme Job, ils n’auront pas la ressource de se tourner vers Dieu, qui reste manifestement indifférent au malheur, mais vers les autres, dans un sentiment de solidarité humaine spontanée. La dernière scène – forte – du roman, en est l’illustration.
Steinbeck observe avec détachement chaque âge et nous les rend à la fois proches et aimables. Les deux vieux récusent le déracinement et en meurent, l’un d’une attaque, l’autre de stress. Parmi les adultes, Pa est dévalorisé parce qu’il ne sait pas conduire, qu’il ne sait pas où aller, qu’il ne sait pas décider en situation de nomadisme, et qu’il ne gagne pas le pain de la famille. Ma prend sa place, en mère qui vit chaque moment à son rythme et assure la continuité de la vie. L’oncle John, 50 ans, se reproche sans cesse la mort de son épouse, il y a des années, d’une péritonite qu’il a minimisée avant qu’il soit trop tard. Il est hanté par « le péché », ce qui le rend aussi inutile qu’un vieux sac vide. C’est moins la Morale qui compte que ce que l’on fait, suggère l’auteur.
Parmi les enfants, Noah l’aîné, dans les 22 ans, s’efface, Rose of Sharon (encore un prénom tiré de la Bible) est enceinte de son Connie, 19 ans, au prénom bien nommé en français tant il est velléitaire et peu fiable (à 98 %, ce prénom est donné aux filles…). Le garçon, qui ne s’intéresse qu’au sexe, jure qu’il va travailler, bâtir une maison, prendre des cours du soir en radio, mais, contrairement à Tom, n’a aucune constance (Connie dériverait du prénom Constance). Il va d’ailleurs abandonner sa femme lorsqu’elle commencera à se plaindre sans rien foutre. Car Rosasharn (contraction phonétique de Rose of Sharon) est égoïstement centrée sur son bébé à naître, toujours fatiguée, toujours à se lamenter ; elle mériterait une bonne baffe pour se secouer – et c’est ce que lui dit sa mère. Elle ne s’élèvera au-dessus d’elle-même qu’à la fin, ayant perdu mari et bébé, réduite à coucher nue sous une couverture sale.
Tom, dans les 20 ans, tient de sa mère, il est solide et fiable, mais peut se laisser aller à des accès de violence. Il conduit la guimbarde, tout comme son jeune frère Al, 16 ans, qu’il aime bien. « Il y avait de l’affection entre ces deux-là » p.446, écrit sobrement l’auteur. Al est un queutard fini et cherche toujours une fille, avant d’envisager de « se marier » à la fin, lorsqu’ils sont dans la misère. « S’il pouvait lui arriver d’être un vrai bouc en rut, il était toutefois responsable de ce pick-up, de son bon fonctionnement et de son entretien » p.459. Sa passion à lui, outre les filles à défoncer, ce sont les moteurs à démonter : il les bricole, les répare ; il sait conduire et a décidé quelle vieille voiture d’occasion, une antique Hudson Super-Six pour 75 $, les mènera en Californie. Il l’a bien choisie, elle ne les laisse pas en rade. Il représente l’avenir mécanique en ville, loin de la terre des paysans.
Restent les deux petits, Ruthie et Winfield, la première, 12 ans, « prenait la mesure de la puissance, des responsabilités et de la stature contenue dans ses seins naissants » p.457 Pléiade. Le second, 10 ans, « était un jeune chien fou » en salopette, débraillé et crasseux.
Ce long roman puissant dénonce et illustre à la fois la condition des métayers chassés de leurs terres au début du XXe siècle. Il est intemporel tant chacun peut se reconnaître dans les situations (le chômage dû à l’externalisation ou à la mondialisation) ou les caractères (le velléitaire, celui qui vit d’un jour à l’autre, le résigné, l’égoïste, le baiseur, le consciencieux…)
John Steinbeck, Les raisins de la colère (The Grapes of Wrath), 1939, Folio 1972, 640 pages, €11,76
John Steinbeck, Romans – En un combat douteux, Des souris et des hommes, Les Raisins de la colère, À l’est d’Éden, Pléiade 2023, 1664 pages, €72,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)
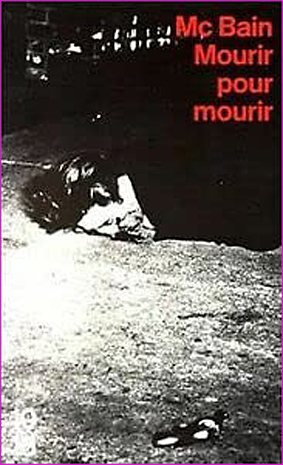


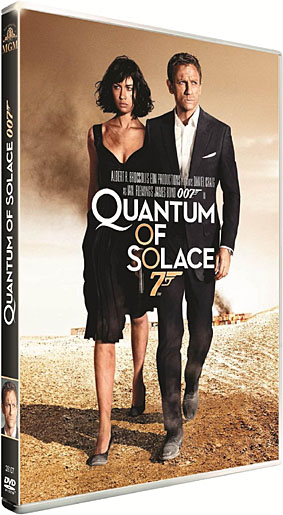



 James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.
James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.











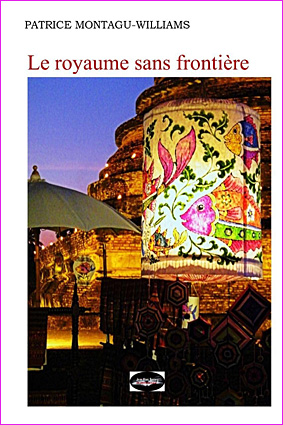
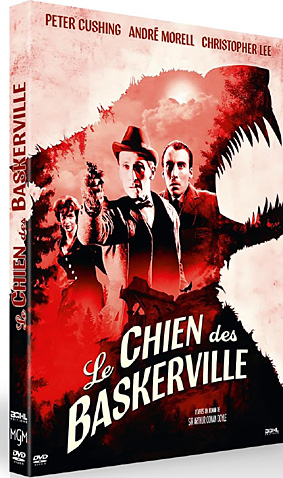









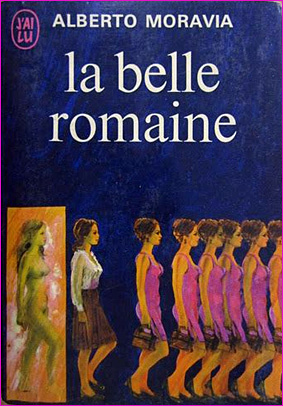
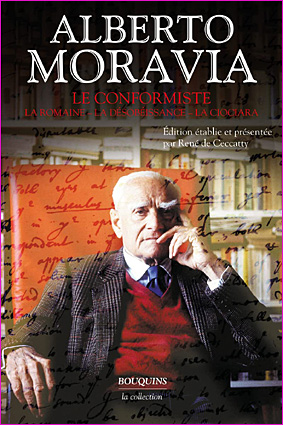
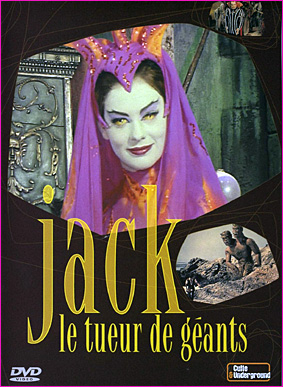







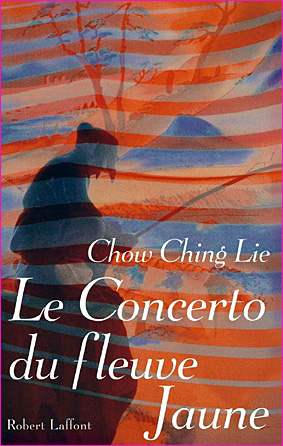
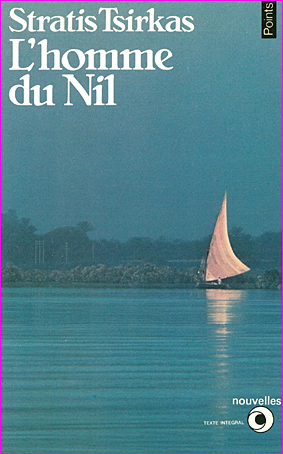

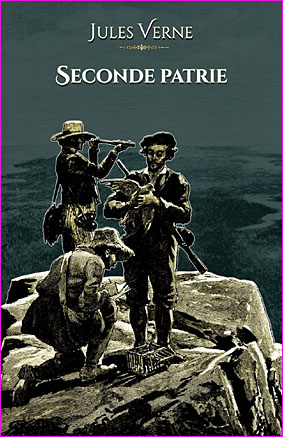






























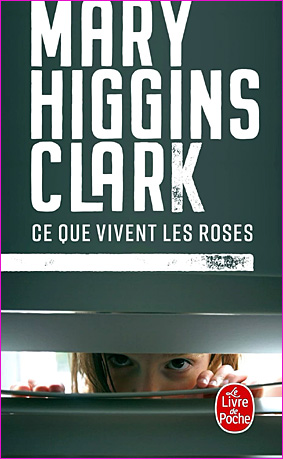

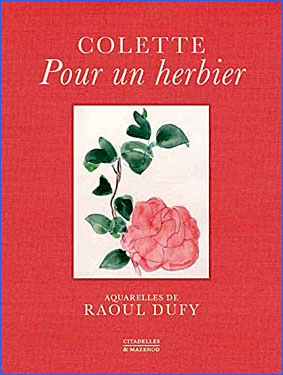









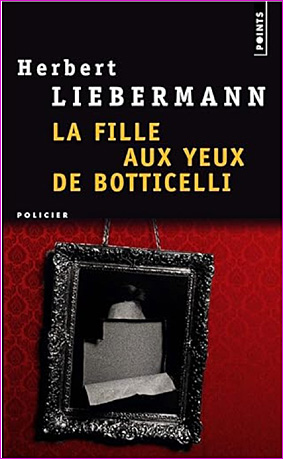
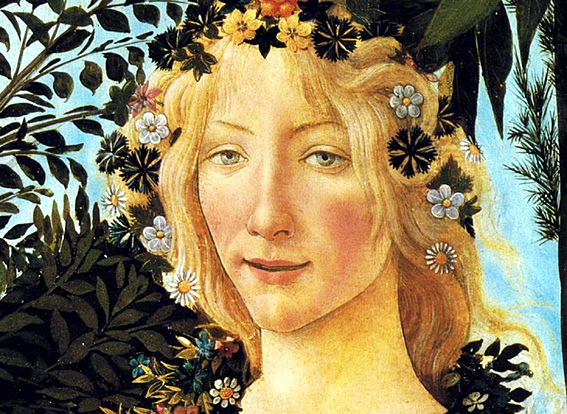
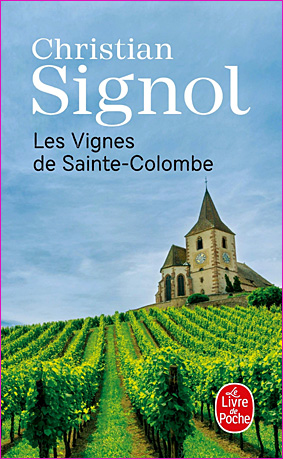










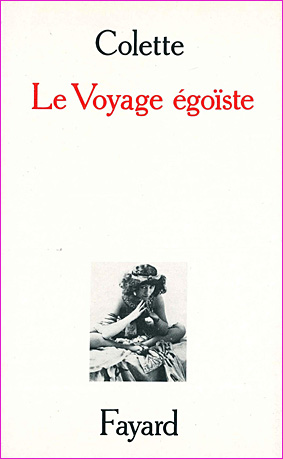

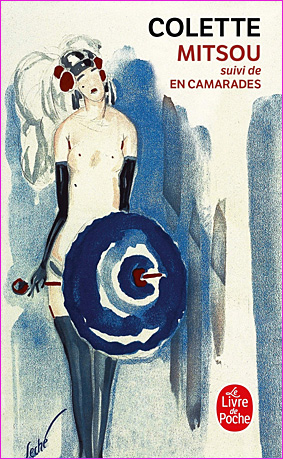








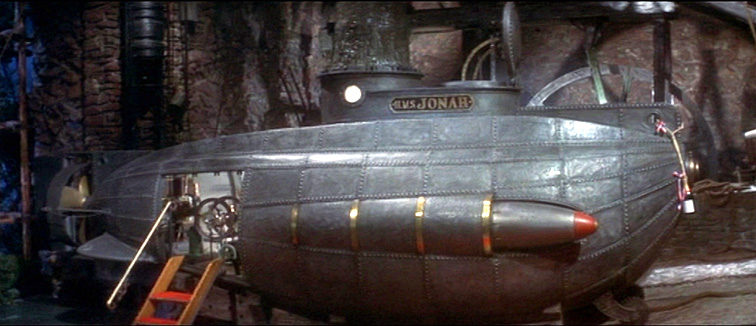


Commentaires récents