Ce roman est – et c’est naturel dans notre société superficielle qui se contente d’agiter des images et de scander des slogans – tout à fait différent de l’impression qu’a pu en laisser « la critique ». C’est un vrai roman avec une histoire, un conte philosophique qui fait penser et, mieux, qui laisse « libre » de penser (ce qui est plutôt rare en ces temps de militantisme affirmé).
Car le narrateur est et n’est pas Michel Houellebecq. Il est son double, mais un double construit, probablement plus simple que l’original. L’époque pousse à la caricature tant, en ces temps d’incertitudes, l’opinion est avide d’ancrages. Daniel1 est plus complexe que Daniel25, son clone des temps futurs imaginé par l’auteur. Mais l’auteur est plus complexe que son sujet. Le roman se lit de façon fluide, il captive, et ses remarques anodines sur l’époque visent à renverser ce conformisme si confortable, si larmoyant, si « de gôche, ma chère ». Et c’est bien, car tout divorce avec la réalité, qu’il soit naïveté ou illusion, finit par s’y heurter en retour, quels que soient les bons sentiments. La révolte des banlieues l’a montre à l’envi en 2005, comme la révolte antifiscale fin 2013.
Le héros de Houellebecq n’est pas un « modèle », comme la doxa aime tant à en créer de toutes pièces pour se rassurer. Daniel, comme l’auteur, est un être qui se cherche, dans le désespoir du vide si bien philosophé par Schopenhauer. Seuls les ignorants ont pu parler de Nietzsche à propos de ce livre ; c’est avoir une vue plate et scolaire du Surhomme et ignorer toute la joie nietzschéenne de la danse du corps et des scintillements de l’intelligence. Schopenhauer, plus laborieux, est mieux en phase avec le nihilisme houellebecquien.
Mai 68 avait chanté la « libération » des corps source de désaliénation des esprits. Michel Houellebecq montre ce qu’il en est : un prodigieux égoïsme narcissique qui commence dès 12 ans (les « pétasses »), un corps objet qui se livre au plaisir comme un petit animal (Esther), l’impossibilité des relations durables (Isabelle), la dictature de la jeunesse sur l’ensemble de la société, depuis la consommation jusqu’à l’idéologie. Les « vieux » deviennent des déchets dont il faut se débarrasser (bienveillante canicule !). Et Daniel, antihéros contemporain, évolue en ce monde comme un zombie, ne vivant et ne réussissant partiellement sa vie qu’entre 13 et 35 ans en gros, l’avant étant bave, merde et braillardise, l’après étant déchéance désespérante d’un corps qui lâche et d’une solitude qui monte. Pour Houellebecq, « solidarité » n’est qu’un slogan de bonne conscience, « amour » qu’une rencontre de sexe à patte avec chatte au vent (ah, ces jupettes qui couvrent à peine des fesses sans culottes, si révolutionnaires !). Daniel rêve d’un amour qui soit fusionnel, retour vers…
Ce pour quoi lui, l’a-religieux, découvre un certain bonheur de la secte. Non pas celui des filles superbes à disposition des mâles dominants (il a des phrases sarcastiques sur le sujet), mais celui d’une espérance, celle que donne toute religion, au fond. Il n’y « croit » pas mais l’être humain est ainsi fait qu’il a besoin d’ailleurs. Pour le commun des mortels, ce sont les enfants, parfois Dieu, quel que soit le nom qu’il porte, ou bien le sort des autres. Michel Houellebecq, dans la vraie vie, a un fils, Etienne, né lors de l’avènement Mitterrandien. Son personnage, Daniel, n’a pas l’air attaché au sien, je ne sais ce qu’il en est de l’auteur. En tout cas, l’espérance houellebecquienne ne réside pas dans les enfants, mais dans l’espèce elle-même que la Raison scientifique et technicienne devrait pouvoir modeler dans le futur pour éliminer ce nihilisme profond qui vient du sexe, du seul sexe, de l’impossible libération de l’avidité sexuelle.
Houellebecq n’est pas Raëlien comme on l’a dit précipitamment, il projette les tendances du présent dans un futur possible. Ne voit-on pas, aux États-Unis, pays de la modernité la plus avancée, des nantis se protéger dans des enclaves fermées ? Ne voit-on pas l’explosion des sectes avides de croire en autre chose qu’en la réalité vide ? N’espère-t-on pas dans le clonage et dans la génétique ? Mêlez tout cela et vous avez le conte philosophique, La possibilité d’une île. Qui est terriblement de notre époque. C’est moins sage que Jardin ou Weyergans, mais cela ouvre plus de portes. Il y a du Diogène le Cynique chez Houellebecq.
De la claire et volontaire provocation aussi, dans la lignée des grands prédécesseurs de Mai 68. Le symbole de la secte élohimiste n’est-elle pas une étoile de David gammée, « à six branches, aux pointes recourbées » ? Son prophète n’est-il pas ignare, manipulateur et grand baiseur ? Le héros, humoriste, n’a-t-il pas un spectacle de « partouzeuses palestiniennes » ? La référence internet notée « kdm.fr.st » existe réellement, elle renvoie à The Hacking Academy, forum de hackeurs.
Il est certain que vous apprécierez mieux La possibilité d’une île si vous êtes mâle, Blanc et avec une certaine aisance. Tel est, disons, le « cœur de cible » du lectorat. Mais ce n’est pas si mal vu, la société n’aime pas se voir critiquée ainsi et c’est dommage, le signe que sa jeunesse d’esprit s’en va, qu’elle se sclérose. La possibilité d’une île est à prendre au seconde degré, comme la jouvence de l’abbé Houellebecq.
L’attrait de l’auteur, ce sont aussi les sentences, ciselées à la Flaubert. Elles font souvent mouche. Florilège :
« Il restait si peu de choses à observer dans la réalité contemporaine : nous avions tant simplifié, tant élagué, tant brisé de barrières, de tabous, d’espérances erronées, d’aspirations fausses ; il restait si peu, vraiment. » p.21
« Finalement, le plus grand bénéfice du métier d’humoriste et, plus généralement, de l’attitude humoristique dans la vie, c’est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité. » p.23
« La vie commence à 50 ans, c’est vrai ; à ceci près qu’elle se termine à 40. » p.25
« Lorsque je gagnais mon premier million d’euros (je veux dire lorsque je l’eus vraiment gagné, impôts déduits, et mis à l’abri dans un placement sûr), je compris que je n’étais pas un personnage balzacien. Un personnage balzacien venant de gagner son premier million d’euros songerait dans la plupart des cas aux moyens de s’approcher du second. » p.30
« Tu connais le journal où je travaille : ce que nous essayons de créer c’est une humanité factice, frivole, qui ne sera plus jamais accessible au sérieux ni à l’humour, qui vivra jusqu’à sa mort dans une quête de plus en plus désespérée du fun et du sexe ; une génération de kids définitifs. » p.37
« Sa méthode de gestion du personnel : ne dire du mal de personne, en aucune circonstance, jamais ; toujours au contraire couvrir les autres d’éloges, aussi immérités soient-ils – sans évidemment s’interdire de les virer le moment venu. » p.40
« La reconnaissance artistique, qui permettait à la fois l’accès aux derniers financements publics et une couverture correcte dans les medias de référence, allait en priorité, dans le film comme dans les autres domaines culturels, à des productions faisant l’apologie du mal – ou du moins remettant gravement en cause les valeurs morales qualifiées de ‘traditionnelles’ par convention de langage. » p.51
« Quand l’amour physique disparaît, tout disparaît ; un agacement morne, sans profondeur, vient remplir la succession des jours. Et, sur l’amour physique, je ne me faisais guère d’illusions. Jeunesse, beauté, force : les critères de l’amour physique sont exactement les mêmes que ceux du nazisme. » p.74
« L’Espagne se rapprochait des normes européennes, et particulièrement anglaises. L’homosexualité était de plus en plus courante et admise ; la nourriture végétarienne se répandait, ainsi que les babioles New Age ; et les animaux domestiques, ici joliment dénommés ‘mascotas’, remplaçaient peu à peu les enfants dans les familles. » p.75
Pascal : « on sentait à le lire que les tentations de la chair ne lui étaient pas étrangères, que le libertinage était quelque chose qu’il aurait pu ressentir ; et que s’il choisissait le Christ plutôt que la fornication ou l’écarté ce n’était pas par distraction ni par incompétence, mais parce que le Christ lui paraissait définitivement plus ‘high dope’ ; en résumé, c’était un auteur sérieux. » p.82
« On ne peut pas dire que le communisme ait spécialement développé la sentimentalité dans les rapports humains : c’est plutôt la brutalité, dans l’ensemble, qui prédomine chez les ex-communistes – en comparaison, la société balzacienne, issue de la décomposition de la royauté, semble un miracle de charité et de douceur. » p.105
« Il habitait un pavillon à Chevilly-Larue, au milieu d’une zone en pleine phase de ‘destruction créatrice’ comme aurait dit Schumpeter : des terrains vagues boueux, à perte de vue, hérissés de grues et de palissades ; quelques carcasses d’immeubles, à des stades d’achèvement variés. » p.149
« La plupart des gens naissent, vieillissent et meurent sans avoir connu l’amour (comme des étiquettes sur la viande bovine) ‘né et élevé en France. Abattu en France’. Une vie simple, en effet. » p.174
« La différence d’âge était le dernier tabou, l’ultime limite, d’autant plus forte qu’elle restait la dernière, et qu’elle avait remplacé toutes les autres. Dans le monde moderne on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux. » p.213
« Tout le monde s’était habitué à ce que les personnalités s’expriment dans les medias sur les sujets les plus variés, pour tenir des propos en général prévisibles, et plus personne n’y prêtait une réelle attention, en somme le système spectaculaire, contraint de produire un consensus écœurant, s’était depuis longtemps effondré sous le poids de sa propre insignifiance. » p.274
« Mes années de carrière dans le show-business avaient quelque peu atténué mon sens moral. » p.296
« L’élohimisme marchait en quelque sorte à la suite du capitalisme de consommation qui, faisant le la jeunesse la valeur suprêmement désirable, avait peu à peu détruit le respect de la tradition et le culte des ancêtres – dans la mesure où il promettait la conservation indéfinie de cette même jeunesse, et des plaisirs qui lui étaient associés. » p.356
Michel Houellebecq, La possibilité d’une île, 2005, Prix Interallié, Livre de poche 2007, 474 pages, €5.75

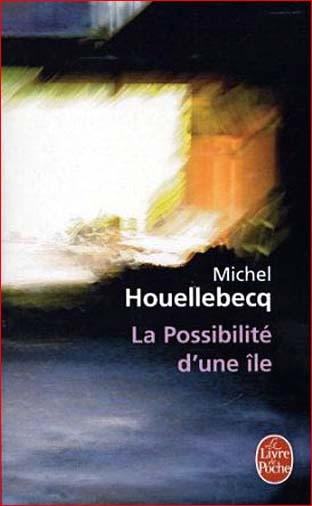








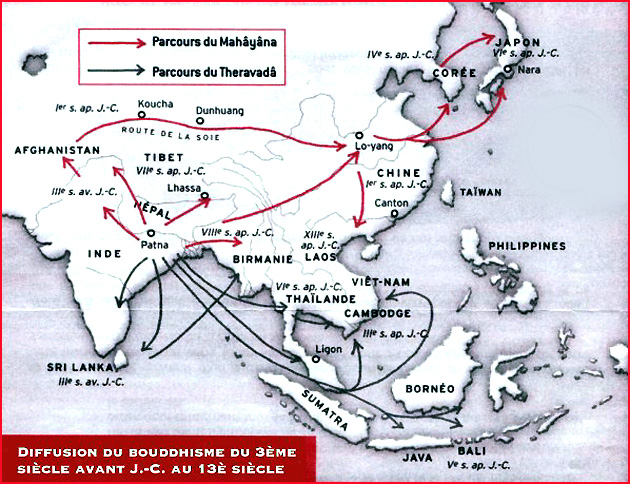
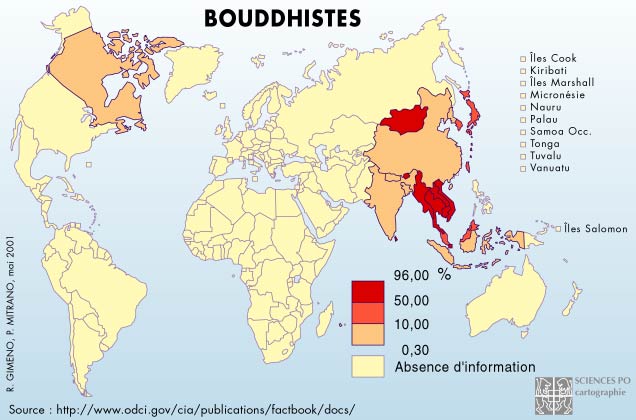

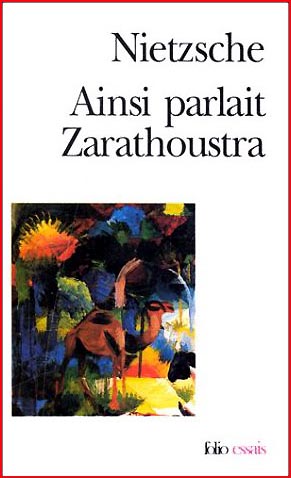




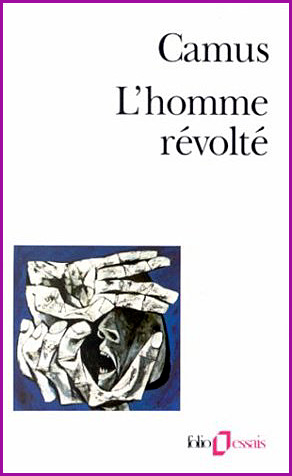
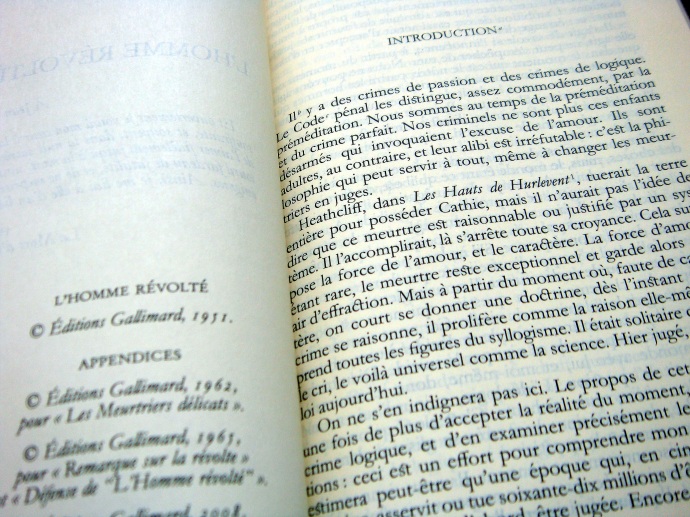
Commentaires récents