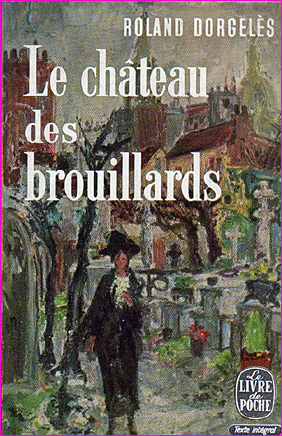
Roland Dorgelès n’est pas seulement l’auteur du célèbre récit Les croix de bois, sur cette guerre de 14 que François Hollande a aimé « commémorer », comme il disait. Comme s’il fallait garder la mémoire des imbécilités du temps, la vanité des politiciens férus d’un « honneur » imité des aristos dont leur bourgeoisie étriquée ne connaissait plus le sens à l’ère de la guerre industrielle. L’héroïsme des Poilus lâchés sans armes suffisantes et en pantalon rouge bien visible de loin par des badernes qui se croyaient encore au défilé n’a fait que masquer les intérêts coloniaux, le nationalisme des revanchards de l’empire qui avaient perdu l’Alsace-Moselle par pure forfanterie, se croyant « insultés » par la dépêche d’Ems. Si l’on ravive le souvenir, ravivons-le jusqu’au bout : qui est responsable de cette guerre de 14 ? Qui a suicidé la population européenne pour rien – puisqu’une nouvelle guerre allait naître vingt ans plus tard faute d’avoir compris, d’avoir appris, d’être resté dans les fameuses et tant célébrées « traditions » ? Qui a mis en regard la « Victoire » des héros qui ont tenu Verdun avec les conséquences de la fausse paix des traités à Versailles ? Certainement pas Hollande…
Roland Dorgelès a combattu en 14 et a été blessé. Après-guerre, il veut se souvenir – lui – de ce qui « était mieux avant » : la Belle époque de la dèche à Montmartre, alors un village excentré sur les hauteurs de Paris, encore rural, peuplé de cabarets et de logis minables pour rapins, marlous, arpètes, anarchistes et filles de Pigalle. Sorti des Beaux-Arts, Dorgelès a été rapin et tiré le diable par la queue. Il a picolé du mauvais vin, couché sur des galetas pleins de poux, été amoureux des radasses ou des cousettes qui passaient. Mais il était jeune et il chante sa jeunesse pauvre à Montmartre.
Il en fait ce roman – vingt ans après. La rue Lepic et le Lapin agile, la neige et les ruelles non éclairées, le loyer en retard et la facture du gaz. Les villas décaties cernées d’un parc fermé par une grille comme le Château des brouillards sont rares. Lucie la relieuse l’occupe, vierge, solitaire, obstinée. Elle accueille des anarchistes pour qui tout est à tout le monde ; ils font de la fausse monnaie. Mais aussi les chiens perdus comme ce frère de 15 ans, Sauvageon, qui s’exerce torse nu à devenir acrobate. Et Gérard, poète dont le petit capital échu en héritage de sa mère fond comme neige au soleil avec les grisettes et les amourettes.
Il a écrit des vers, au fond pas mauvais, Gérard, l’ami de Roland, mais surtout met en chantier une pièce de théâtre qui devrait le faire connaître. En attendant, il lutine ici ou là, trop pour sa bourse plate, Une Marie-Louise mariée qui a le béguin pour lui car son mari représentant n’est jamais là et qu’il met en cloque (2000 francs pour la faire avorter), une sœurette Cricri de 13 ans surnommée la Poison tant elle agace par ses excès de mamours ou de cris (50 francs ici ou là pour qu’elle la ferme ou aille faire les courses), une Daisy américaine qui joue la comédie et se laisse entretenir comme « cela se fait » (200 francs par soirée, au spectacle et au restaurant) – et Lucie enfin, dont il découvre le trésor de cœur sur le tard, au moment où tout va mal, où il n’a plus un rond, où il a trempé dans la fausse monnaie avec les anars, où la police recherche tout ce beau monde et les cueille un à un.
C’est alors qu’au fond du trou la guerre de 14 éclate. Quelle délivrance ! Gérard se voit sauvé, comme Sauvageon et Lucie, revenue de Belgique où elle s’était mise au vert avec un faux passeport. Une délivrance dérisoire, car Gérard y restera, dans cette guerre inepte. Lucie n’a pas su l’empêcher d’aussitôt s’engager, elle avait pourtant fait faire par ses copains anars deux faux passeports espagnols pour échapper à la guerre. Mais le destin n’a pas voulu.
« Ce que nous ignorions, ce que la jeunesse apprend toujours trop tard, c’est qu’il lui est interdit d’espérer. Elle se croit forte : elle est fragile ; elle se croit éternelle : ses instants sont comptés. La jeunesse, mais on ne la franchit jamais assez vite. (…) C’est la pire épreuve au contraire. La passe dangereuse. L’âge où l’on désire tout sans savoir ce qu’on veut, le combat féroce qu’il faut livrer avec un cœur d’enfant, la timidité qui a honte et se fait prendre pour du cynisme, le geste qui vous entraîne sans qu’on ait le temps de réfléchir » p.229. Pas mal vu, un siècle après…
Il écrit bien, Dorgelès, il dit des vérités d’expérience. Et il décrit un monde « d’avant » disparu, celui du Paris des petites gens qui se croient des génies méconnus et qui le resteront en effet, car le génie est rare et se travaille assidûment. Un bon roman, même désuet.
Roland Dorgelès, Le château des brouillards, 1932, Livre de poche 1961, 243 pages, € e-book Kindle €7.99













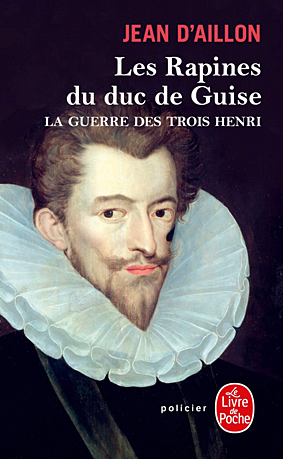


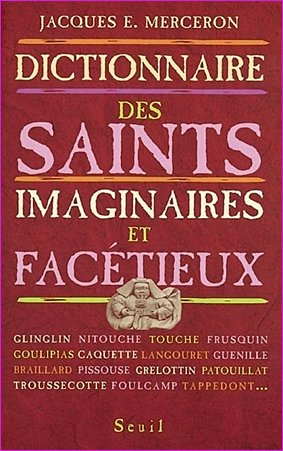



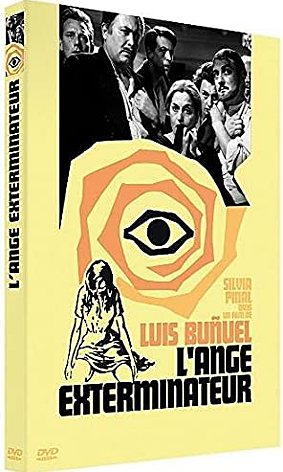














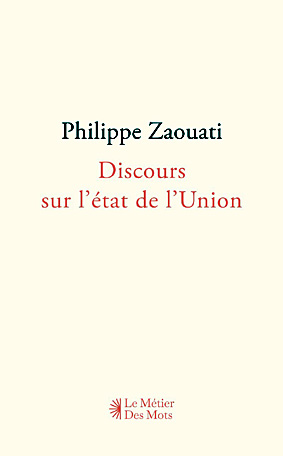


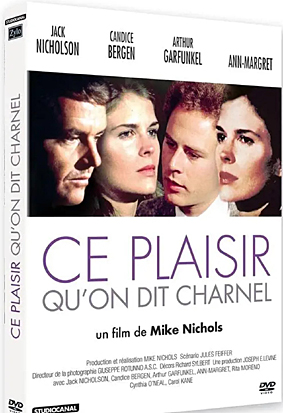











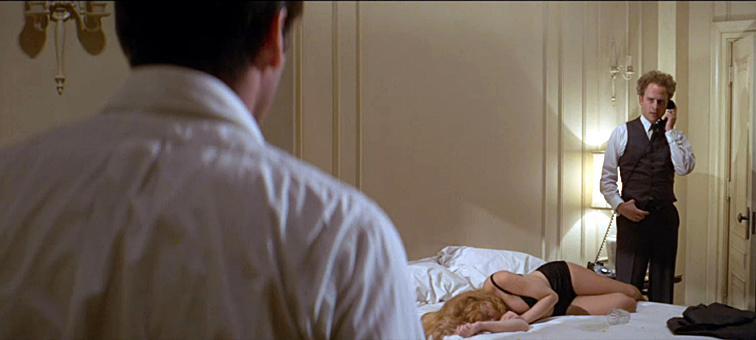



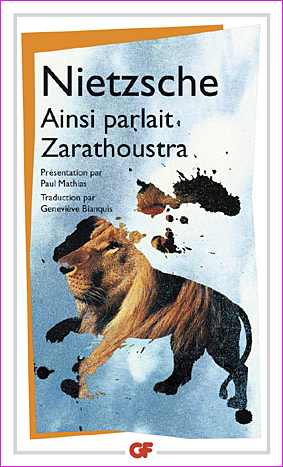

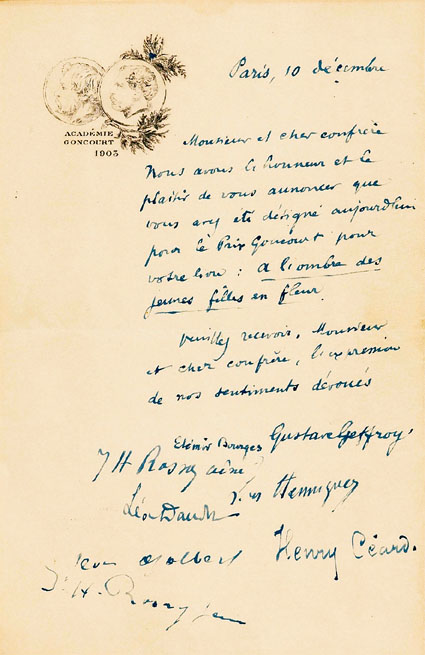
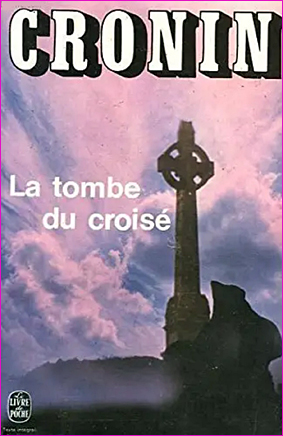
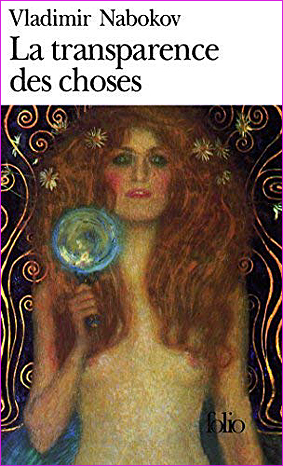














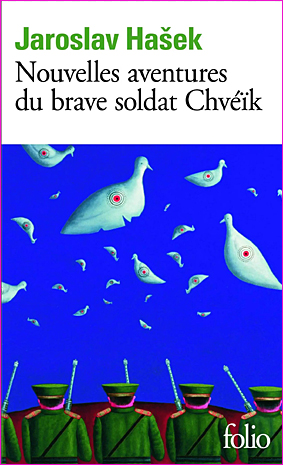

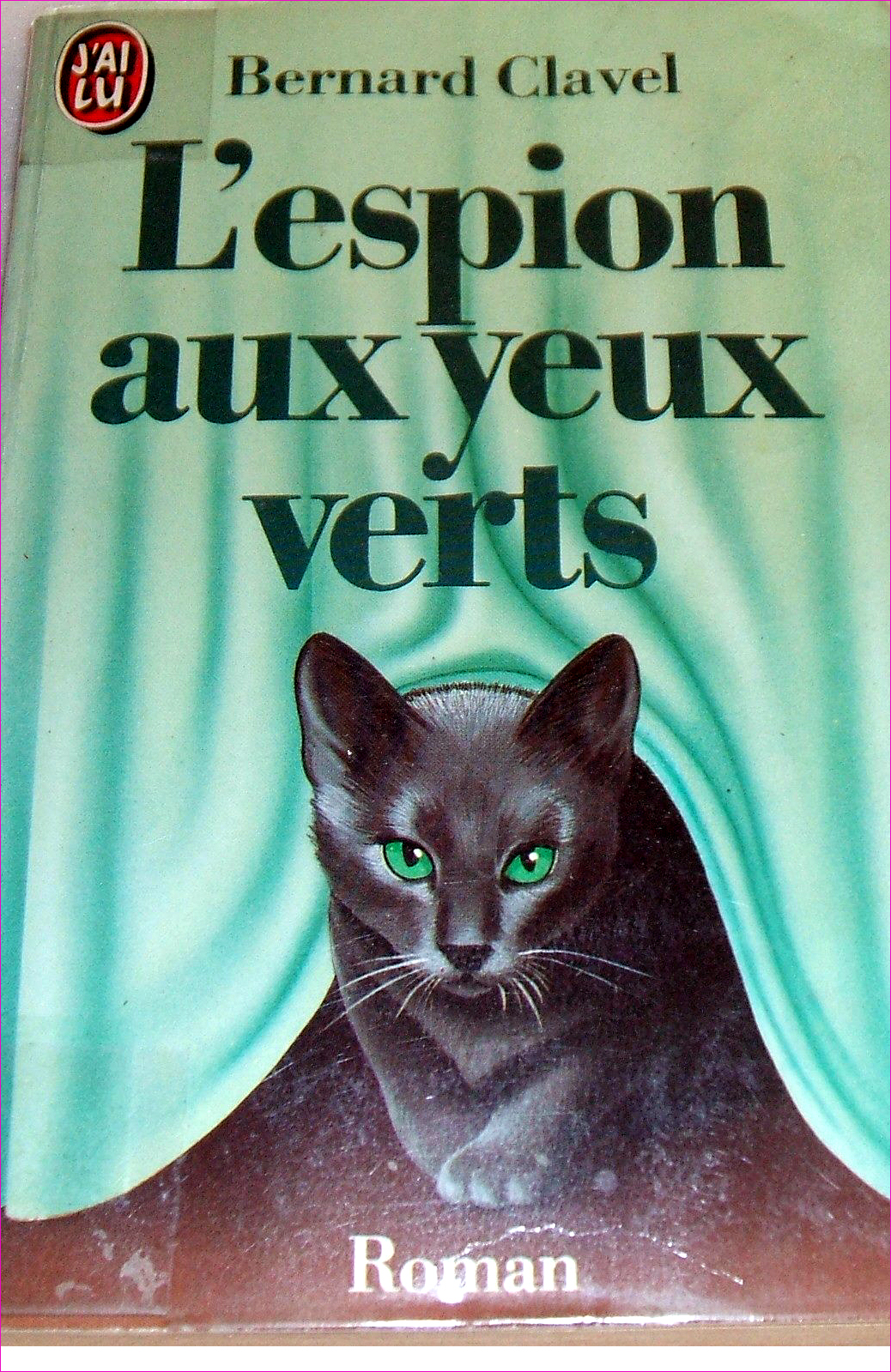



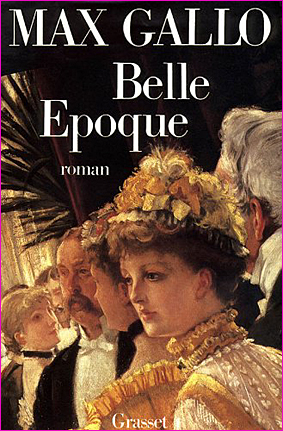











Commentaires récents