Plus Montaigne vieillit, plus il devient brouillon. Il n’a jamais le temps de faire court et sa pensée s’égare en digressions, certes bien écrites, mais oiseuses au point qu’on ne sait plus trop ce qu’il veut dire. C’est le cas de chapitre VI du Livre III des Essais intitulé « Des coches » qui commence par une théorie des causes avant d’analyser le mal de mer et d’en venir aux coches, qui sont des véhicules qui peuvent servir à la guerre. Mais ce n’est pas tout. Au lieu d’en faire un texte autonome, Montaigne poursuit son propos sur la munificence des rois et les libéralités qu’ils consentent, et enchaîne sur l’Amérique et la colonisation des conquistadores. Ouf ! Que tout ceci est bien pesant !
Le lecteur qui s’accroche ne lira ce chapitre qu’à petites doses, remettant au lendemain tout changement de propos. Ainsi en viendra-t-il à bout. Commençons par les causes : les « grands auteurs », dit Montaigne (en ne citant que les Romains), usent des causes comme de tout bois, « ne se servent pas seulement de celles qu’ils estiment être vraies, mais de celles encore qu’ils ne croient pas, pourvu qu’elles aient quelques invention et beauté. » Ainsi des vents : ceux du bas, ceux de la bouche, ceux du nez – les seuls à être bénis… De la haute réflexion, Montaigne passe à la matérialité des choses – il en est coutumier. Ce n’est pas un intellectuel mais un penseur pratique, ce qu’il lit, il cherche à le mettre à l’épreuve des faits humains.
Vous suivez ? Passons alors au mal de mer. Montaigne y est sujet, et non seulement en bateau mais aussi en litière et même en coche (voilà enfin les coches !). Au fond, il ne se sent bien qu’à cheval. Petite vanité d’aristocrate, sans doute, mais surtout habitude depuis l’enfance. Montaigne est un nomade, il aime à voir de haut et rêver ; le cheval est ainsi le transport le meilleur, allant à l’amble ou au galop, s’adaptant à son tempérament. Du mal de mer, qui tient le bas-ventre, Montaigne par association en vient à la peur.
Lui n’est pas pris de panique, comme certains : « Tous les dangers que j’ai vus, ç’a a été les yeux ouverts, la vue libre, saine et entière ; encore faut-il du courage à craindre. » Et de citer Alcibiade, le bel éphèbe grec ami de Socrate, qui se retirait du combat perdu la tête haute et sans frayeur. Car si la peur envahit l’être, suppute Montaigne, c’en est fait de lui. Citant Tite-Live en latin (ici traduit) : « moins on a peur, moins on court de danger ». Notre philosophe lui-même avoue qu’il lâcherait si d’aventure il devait être saisi d’effroi: « Je ne me sens pas assez fort pour soutenir le coup de l’impétuosité de cette passion de la peur, ni d’autres véhémentes. Si j’en étais un coup vaincu et atterré, je ne m’en relèverai jamais bien entier. » Il est vrai que la peur est contagieuse, comme toute passion, et s’alimente d’elle-même une fois le cycle enclenché.
Et d’en revenir aux coches, utilisés jadis en guerre, le thème étant propice aux exemples historiques glanés dans les lectures. Montaigne fait ainsi de ses Essais de plus en plus un livre de choses remarquables, une sorte de cabinet de curiosités littéraire. La réflexion lui vient moins que l’inventaire. Les Hongrois ont utilisé les coches de guerre contre les Turcs, il s’en servant comme des sortes de chars d’assaut munis d’arquebuses. Quant aux Romains, ils préféraient les chars à la parade. C’est ainsi qu’Héliogabale attela entre autres à son coche « quatre garces nues, se faisant traîner par elles en pompe tout nu ». Ce qui est assez cocasse pour être noté…

Mais la morale revient par cet exemple. Est-ce la vertu des rois que l’ostentation et la vanité ? Non point, conclut Montaigne, mais la libéralité. Car la richesse du dirigeant vient de ce qu’il a prélevé au peuple, et c’est une sorte de justice que de lui rendre en partie. « Il doit être loyal et avisé dispensateur. Si la libéralité d’un prince est sans discrétion et sans mesure, je l’aime mieux avare. » Si la largesse « est employée sans respect du mérite », elle fait honte à qui la reçoit et n’attire pas la faveur au dirigeant. En témoignent les profs, augmentés largement et sans contrepartie sous Jospin, et qui ont voté ailleurs (« pas assez à gauche, ma chère ! ») ; ou ces étudiants « aidés » de plus en plus sans que cela soit jamais assez (alors qu’hier en France comme aujourd’hui en d’autres pays, les étudiants travaillent à temps partiel ou pendant les vacances pour payer leurs études – je l’ai moi-même fait). C’est le règne du Toujours plus, vilipendé en son temps par François de Closet, l’éternel refrain des quémandeurs jamais contents et de plus en plus revendicatifs, ce dont témoigne Montaigne : « Les sujets d’un prince excessif en dons se rendent excessifs en demandes ; ils se taillent non à la raison, mais à l’exemple (…) On n’aime la libéralité que future : par quoi plus un prince s’épuise en donnant, plus il s’appauvrit d’amis. » Le président Macron peut en témoigner : le Quoi-qu’il-en-coûte, inégalé dans le monde, ne lui est pas porté à son crédit ; il aurait mieux fait de laisser les gens se démerder tout seuls comme Trump aux États-Unis, désormais encore plus populaire ! « La convoitise n’a rien si propre que d’être ingrate », dit Montaigne.
Et d’en venir à l’Amérique, récemment découverte, il y a moins de cinquante ans pour Montaigne. C’était « un monde enfant », encore pur et naturel, loin de nos vices et de notre religion. Nous l’avons perverti par cruauté et avidité, dit Montaigne, préférant l’or aux âmes. « Bien crains-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C’était un monde enfant ; aussi ne l’avons nous pas fouetté et soumis à notre discipline par l’avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l’avons conquis par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. » Au contraire ! Cuzco et Mexico étaient des villes « magnifiques », les arts de la plume et de la pierrerie étaient sans pareils, la hardiesse et le courage meilleurs que les nôtres – aidés plutôt par l’armure, l’arquebuse et le cheval, toutes choses étranges aux « peuples nus ».

Les soudards espagnols n’étaient pas d’anciens Grecs « qui eussent doucement poli et défriché ce qu’il y avait de sauvage, et eussent conforté et promu les bonnes semences que nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et ornement des villes les arts de deçà, en tant qu’ils y eussent été nécessaires, mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays ! » Ainsi s’exclame Montaigne, regrettant que l’on n’ait pas « appelé ces peuples à l’admiration et imitation de la vertu et dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence ! Combien il eût été aisé de faire son profit d’âmes si neuves, si affamées d’apprentissage, ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels ! Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, luxure, avarice et vers toutes sortes d’inhumanité et de cruauté, à l’exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service du commerce et du trafic ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l’épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre ! Mécaniques victoires. » Mécanique est ici mis pour « vile, logique, sans humanité ».
Après cet éclat, suivi de « la pompe et magnificence » des peuples du Pérou et du Mexique, Montaigne cherche à retomber sur ses pattes : « Retombons à nos coches », dit-il. Et de conclure que ces rois du Pérou se faisaient porter sur les épaules. Au moins n’avaient-il pas le mal de mer.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog
















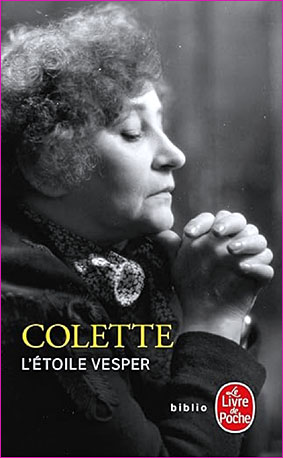









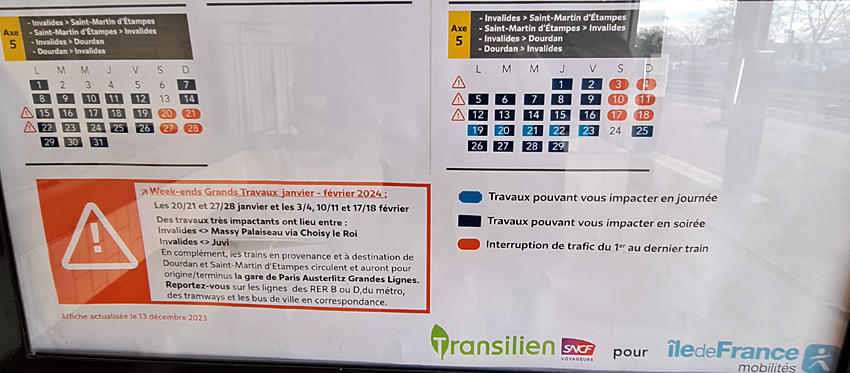









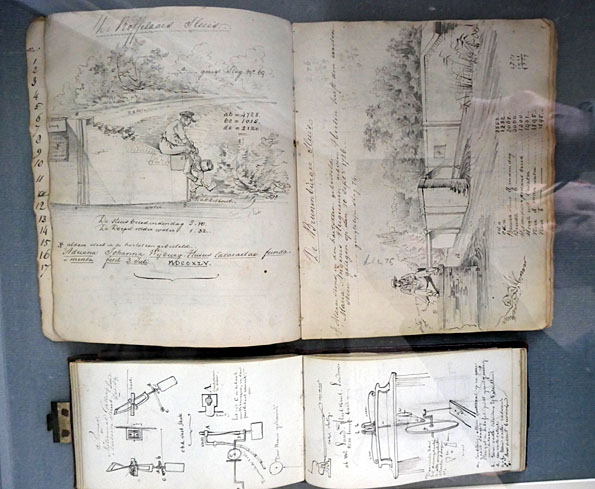



















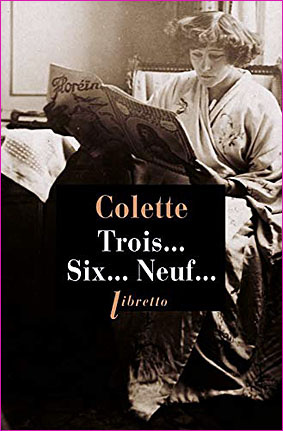
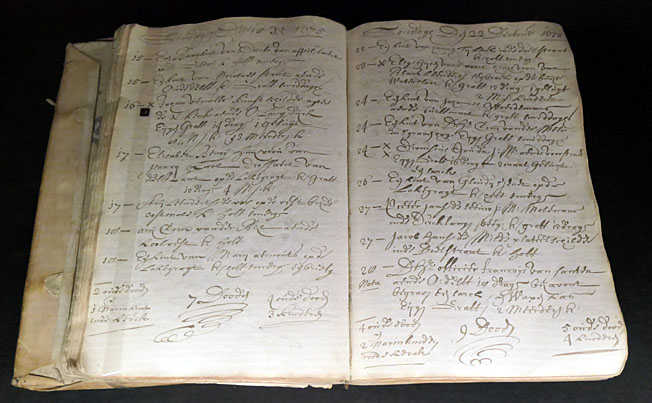










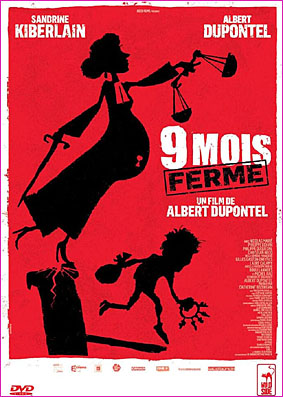























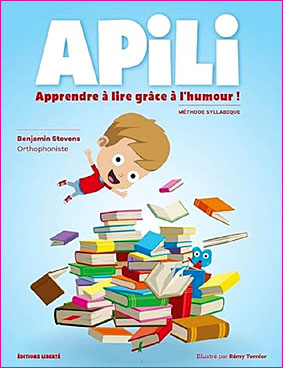




































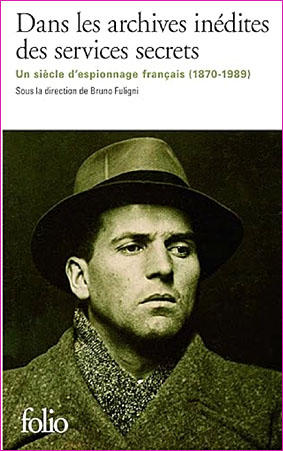




















































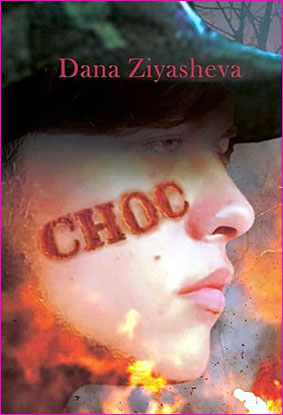










































Commentaires récents