
« Cinq âmes en transit » est le sous-titre de cette suite de contes gothiques des années 1970, tirés des Contes de la crypte parus dans les magazines américains des années cinquante. Il y a constante référence à la mort, des cercueils, des croix, des cimetières, des moines. Justement, les visiteurs férus de frôler le destin aiment à visiter les souterrains des monastères. En arpentant l’un d’eux, à la suite du gardien qui les presse de rester groupés au risque de se perdre… les voilà perdus.
Au sens métaphysique du terme : « vous êtes perdus ! » Un passage emprunté par les cinq derniers en habits de ville, comme sortant du salon ou du bureau, aboutit à une impasse. Celle de l’éternité. Un moine à la coule brune trône sur un siège sculpté dans la roche en forme de tête de mort. Face à lui, cinq plots de roc émergent, un pour chacun. Ils sont priés de s’asseoir. Plus aucune sortie, la porte de pierre s’est refermée avec un bruit sourd. Ce qu’ils font ici ? Prendre conscience. De ce qu’ils sont, de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils resteront éternellement. Car nous sommes aux antichambres de l’enfer.

A chacun de se dévoiler, de révéler à tous – et à lui-même – son inconscient. Fini le déni ! La mort est l’instant de vérité, l’ultime, celle qu’on n’a pas voulu voir durant toute sa vie. Les chrétiens et les bourgeois manient le déni avec maestria, sur l’exemple de Pierre qui nia trois fois le Christ, pourtant son seigneur – qu’il disait. S’ils sont là, c’est qu’ils sont tous des monstres malgré leur apparence civile et respectable.

La première à être sollicitée de se révéler est une femme (Joan Collins). Elle a tout simplement tué son mari le soir de Noël d’un coup de tisonnier, on ne sait pourquoi, par ennui peut-être, et s’est retrouvée (ironie du destin) aux prises avec un psychopathe évadé d’un asile déguisé en père Noël. Il embobine sa petite fille et attire la mère derrière les rideaux avant de l’étrangler avec une lourde jouissance – instrument du destin. Voilà pourquoi elle est morte et se retrouve ici, portant sans vergogne la broche marguerite en opaline que son mari lui offrait pour Noël. Ne jamais faire confiance à une femme, elle n’y connaît rien en meurtre.


Le second est un jeune homme (Robin Phillips), fils de famille et fils unique, imbu de son rang et de sa propriété, que son père regarde avec indulgence au lieu de l’élever. Il déteste son voisin d’en face, pauvre jardinier de la commune veuf (Peter Cushing), dont les seuls plaisirs sont de recueillir les chiens errants et de donner des jouets aux enfants. Pourquoi les attire-t-il – au vu et su de tout le monde ? La paranoïa du bourgeois est celle d’aujourd’hui : le sexe soupçonné, des réseaux sociaux pour se dédouaner, la rumeur malveillante. Le fils de famille riche commence une campagne de diffamation pour faire partir le vieux, pourtant à deux ans de sa retraite et qui a toujours vécu dans sa maison. Il fait croire que les chiens ont déterré les roses du voisin, objets de ses soins précieux (alors que lui y est allé de nuit), reçoit pour le thé la bonne société du voisinage afin d’instiller le doute chez les mères sur les intentions perverses supposées du solitaire envers les enfants, envoie une suite de lettre de saint Valentin injurieuses en le pressant de s’en aller. Le vieux, privé d’épouse, de chiens, d’enfants, de boulot, de relations sociales, se pend. Bel exemple de christianisme bourgeois que ce harcèlement communautaire ! Il ira en enfer direct, puisque l’enfer existe, selon sa croyance. Un an après, à la saint Valentin, le vieux sort de sa tombe pour aller se venger.

Le troisième est un homme d’affaires impitoyable qui aime le risque et a perdu. Il est ruiné. Rentré chez lui, il annonce à son épouse (Barbara Murray) qu’ils doivent vendre leur collection de meubles, de tableaux et d’objets d’art rapportés de leurs voyages. Elle avise une statuette de jade achetée dans une boutique obscure à Hongkong et s’aperçoit qu’une inscription est gravée (en anglais!). Le propriétaire de la statue peut faire trois vœux. La conne s’empresse d’en faire un sans réfléchir, redevenir riche. L’associé de l’homme d’affaires lui téléphone à ce moment-là pour lui dire de revenir tout de suite au bureau, une grande nouvelle l’attend. Pressé, fébrile, il prend son coupé sport rouge et file sur la route. Un motard tout en noir le suit comme le destin et c’est l’accident : il meurt. Sa femme affolée s’empresse de faire un autre vœu tout aussi peu réfléchi : qu’il revienne. Les croque-morts apportent justement son cercueil. Oui mais qu’il redevienne exactement tel qu’il était avant l’accident et qu’il vive désormais éternellement, exprime en troisième vœu tout aussi con la femme. Sauf que, juste avant l’accident, il a eu une crise cardiaque… Il est désormais embaumé et – à nouveau vivant – souffre atrocement (et pour l’éternité) des acides qui lui brûlent en permanence le corps. Ne jamais faire confiance à une femme, elle n’y connaît rien en affaires.

Le quatrième est un mari adultère qui quitte un soir sa famille pour raisons professionnelles, dit-il. Il embrasse ses enfants petits, une fille et un garçon comme il se doit, et prend sa voiture. Il file droit chez sa maîtresse qui l’attend avec ses valises ; elle a fait déménager son appartement. Mais il est fatigué, elle lui propose de conduire la grosse Jaguar MK2 aux quatre phares de calandre. Il rêve qu’ils ont un accident par la faute de sa maîtresse qui fonce droit sur un camion dont les phares l’hypnotisent ; en lui faisant donner un coup de volant, il envoie la voiture dans le décor et se retrouve mort. Il s’éveille brusquement pour s’apercevoir qu’il est encore dans la voiture et qu’il s’est assoupi. A ce moment, les phares d’un camion, le coup de volant, etc. A nouveau mort, il parvient jusqu’à l’appartement de sa maîtresse, désormais vide, mais s’aperçoit qu’elle est revenue, avec tous ses meubles. Il sera éternellement sujet à revivre ces moments où il a gravement fauté contre la morale, la famille et la société. Ne jamais faire confiance à une femme, elle n’y connaît rien en amour.
Le cinquième et dernier est un ancien major (Nigel Patrick), embauché comme directeur d’hôpital pour les aveugles exclusivement mâles. Il n’y connaît rien en aveuglement mais a la certitude de bien connaître les hommes. Qu’il croit. Il impose désormais des restrictions pour faire des économies : moins de nourriture, plus de chauffage passé 21 h, moins de couvertures. Les habitués râlent, d’autant que le directeur se goberge, mais son chien-loup les tient en respect. Lorsqu’un aveugle meurt, de faiblesse et de froid, c’en est trop. Les autres décident de rendre au mauvais dirigeant la monnaie de sa pièce. Ils séduisent le chien avec des morceaux de bacon dont chacun donne une tranche pour l’emmener à la cave et l’enfermer dans une cellule, puis font irruption chez le directeur, le maîtrisent et l’entraînent dans la même cave, où il est enfermé lui aussi. Commence alors une activité aveugle derrière la porte. C’est tout un système de cages qui est bâti à force de scie et de clous. Au final, le directeur repu est livré au chien rendu fou par des jours de faim. Exactement le sort qui l’attendait en affamant les malades.
Deux histoires d’hommes peu reluisants et trois histoires délicieusement misogynes de femmes peu futées. Tout le sel de l’ambiance chrétienne anglo-saxonne dans ces contes édifiants au seuil de la mort. Décédé à Londres en 2007 à 89 ans, Freddie Francis le réalisateur a été un spécialiste des adaptations de Comics américains des années cinquante qui font une satire de la société puritaine et affairiste du temps sous forme d’histoires d’épouvante en bandes dessinées. Appât du gain, trahison, avarice, égoïsme sont impitoyablement vengés comme s’il existait une Justice immanente. La Morale est sauve, l’Illusion aussi.
DVD Histoires d’outre-tombe (Tales of the Crypt), Freddie Francis, 1972, avec Ralph Richardson, Joan Collins, Peter Cushing, Ian Hendry, Richard Greene, ESC editions 2022, 1h32, €27,22 e-book Kindle €7,99
D’autres films de Freddie Francis déjà chroniqués sur ce blog











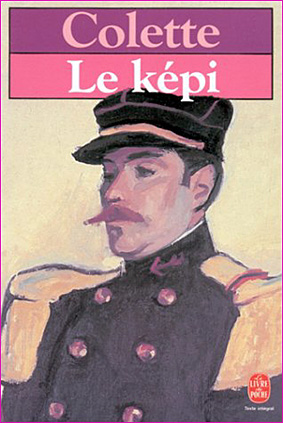







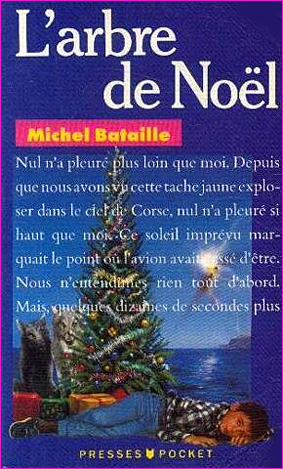

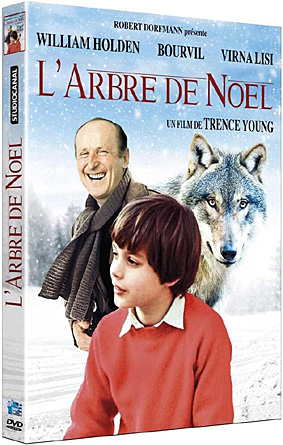









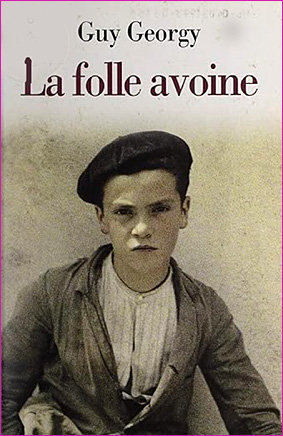
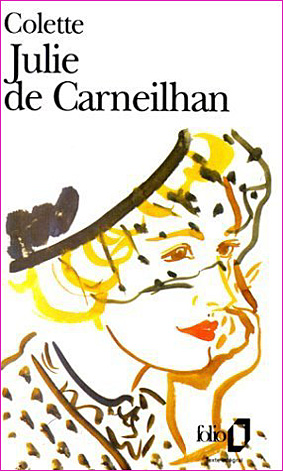







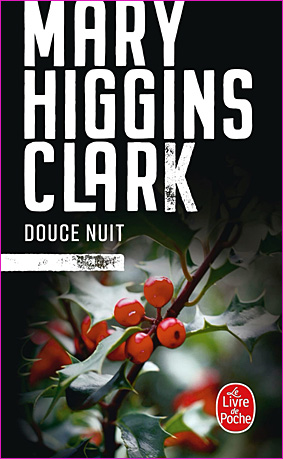
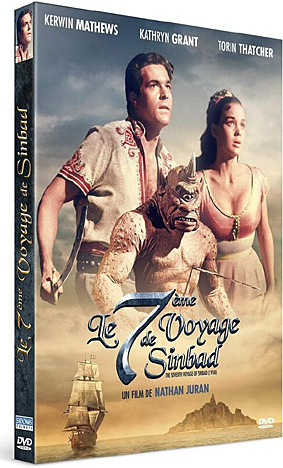



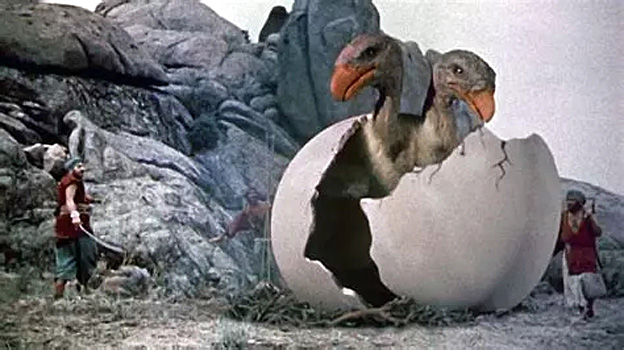





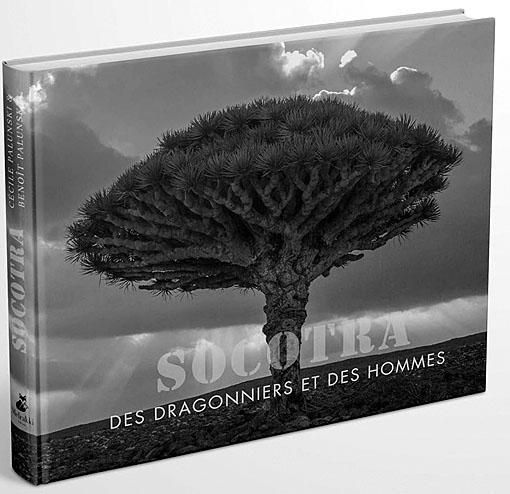


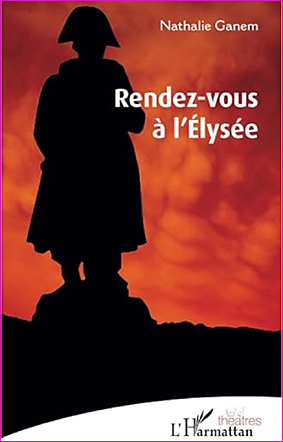










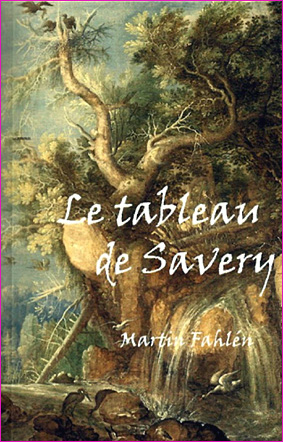
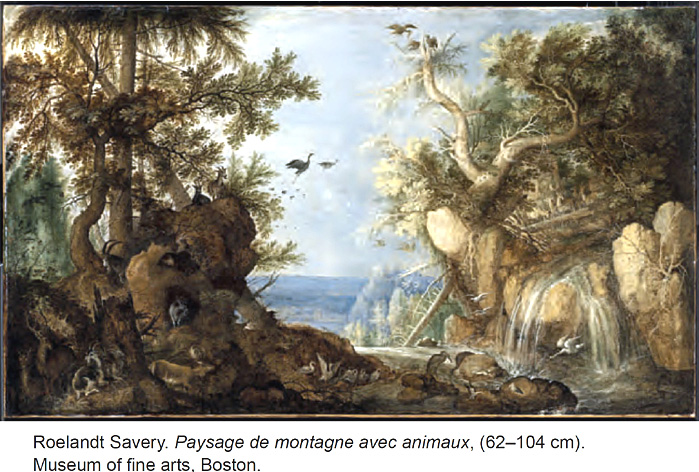



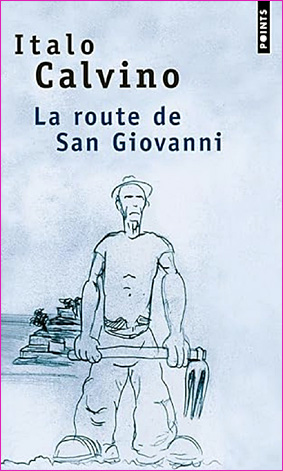

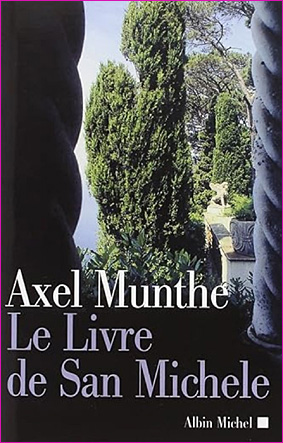








Commentaires récents