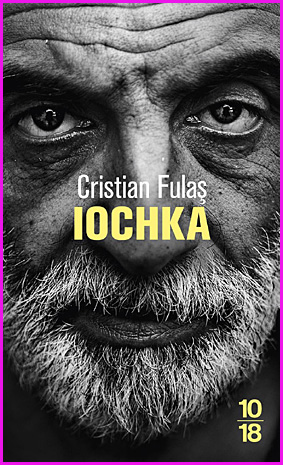
Écrivain, éditeur et traducteur, Cristian Fulaş est quasi inconnu en France. Né le 3 juillet 1978 à Caracal au sud de la Roumanie, il vit près de Bucarest et entreprend la tâche titanesque de traduire Proust, La recherche du temps perdu, en roumain. Iochka est son premier livre traduit en français et a connu un succès critique – même s’il est ardu à lire tant les phrases sont longues et la langue un torrent. Mais il suffit de se laisser porter, et de ne pas tenter de « tout » lire d’une seule traite. La matière est trop riche pour s’en prendre une indigestion.
Iochka est un cœur simple. Né fils de maréchal-ferrant en Roumanie avant la Seconde guerre mondiale, il a commencé par aider son père dans ses très jeunes années avant d’être envoyé, alors que la guerre commence, comme enfant de troupe sur le front ; il doit avoir dans les 12 ou 14 ans. Cinq ans de guerre, dix ans de camp de travail pour avoir été du mauvais côté (non-communiste), il est affecté sur un chantier d’une vallée perdue où l’on construit un « asile ». pour les fous, mais aussi pour tous ceux qui n’acceptent pas la « vérité » (pravda) du régime et sont donc considérés comme ayant perdu la raison. « En réalité, beaucoup de ceux qui s’y trouvaient n’avaient jamais été fous de leur vie et ils ne savaient presque pas ce que cela voulait dire, ils y étaient enfermés dans une autre sorte de prison, tout simplement. Enfermés pour en avoir trop dit ou pas assez, parce qu’ils avaient vu des choses ou au contraire n’en avaient pas vu, parce qu’ils avaient entendu et fait semblant de ne pas avoir entendu, parce qu’ils avaient fait des choses ou ne voulaient pas en faire, ou au contraire, voulaient faire des trucs mais dans l’imagination d’une justice à jamais aveugle et à jamais divine, ils étaient forcément coupables, certains pour la simple raison qu’ils existaient et qu’ils ne devraient pas exister, chose sensée dans un monde où tous les hommes n’existent pas réellement » p. 488.
Iochka est un solitaire, un taiseux. Il a pour amis d’autres hommes simples, un peu « fous » selon les critères du régime communiste : Vasilé le contremaître ancien partisan et soucieux de ses hommes, Iléana sa compagne sauvage qui s’est accouplée dans la forêt avec un loup (dit-elle), le pope oublié du régime et qui collectionne les icônes religieuses pour éviter leur destruction par les athées communistes, le docteur des fous laissé dans cet isolement. Mais surtout Ilona, sa femme, l’amante auprès de qui il a éprouvé l’amour le plus pur et le plus profond, une vraie bénédiction fusionnelle. Ils auront un seul fils, Iochka junior, mais ce n’est pas faute d’avoir baisé et rebaisé. Car il y a beaucoup de sexe animal, vital, instinctif, dans ce roman. Les hommes très jeunes en sont tourmentés, les filles ne sont pas en reste ; on se demande pourquoi il n’y a pas plus d’enfants en Roumanie.
Le roman se déroule sans chronologie, comme les souvenirs affluent, sans aucune incidence de « la politique » dans ce lieu reculé, isolé et préservé. « Il vivait cette permanence comme il l’aurait fait avant, comme du temps qui s’écoule, il la percevait de la même manière, il voyait, entendait, sentait, sauf que les choses n’avaient plus d’ordre établi dans le temps, leur ordre étant celui des causes et des effets. Une chose générait une autre chose qui, à son tour, en générait une autre qui en générait une autre, et ainsi de suite, mais sorties du temps, ces choses ne se passaient plus l’une avant l’autre, avant ou après, plus tôt ou plus tard » p.455.
Le contremaître Vasilé, qui a gardé des « camarades » devenus hauts placés, veille particulièrement sur ce paradis. Il fait partie de cette masse anonyme qui permet le pouvoir, et au pouvoir de durer. « Parce que, mais cela seul les sages le comprennent et le comprendront jamais, les mondes dirigés par un seul homme ne sont pas dirigés par lui mais par des milliers et des milliers d’autres hommes qui le soutiennent et donnent l’impression qu’il est excessivement puissant alors que ce sont eux qui le sont et sont prêts à prendre les rênes de l’État » p.276. Ceausescu a été déboulonné en une journée, mais le pouvoir a-t-il changé ? Non, une autre mafia de puissants a pris sa place. « Au plus petit signe d’hésitation du puissant, lorsque les peuples se révoltent, ceux qui l’entourent l’exécutent et mettent en place un autre puissant derrière lequel ils se cacheront et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps. » Pessimisme post-communiste, que seule la Chine a réussi à transgresser. On attend encore la Russie et Cuba…
Épreuves, amour, amitié, alcool – un roman de l’homme vrai, d’un Européen central pris dans la guerre des dictatures et qui s’en fout, vivant sa petite vie comme il doit.
Cristian Fulas, Iochka, 2021, 10-18 2024, 501 pages, €9,90, e-book Kindle €7,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

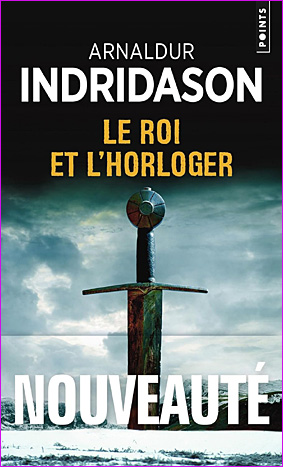
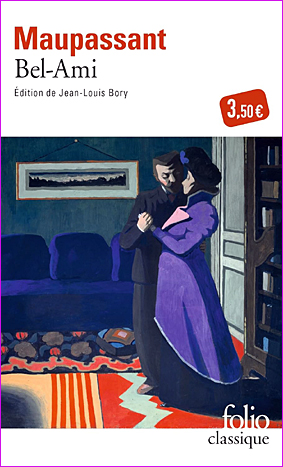
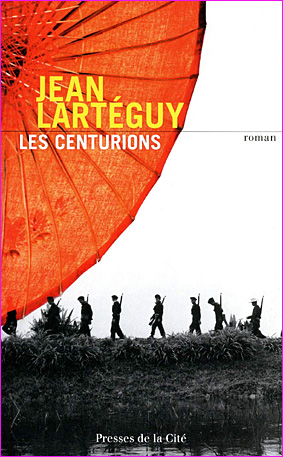
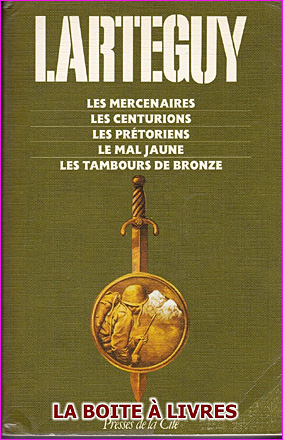
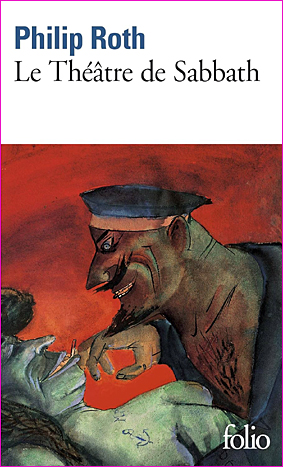
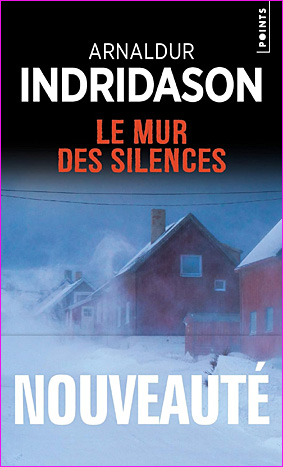
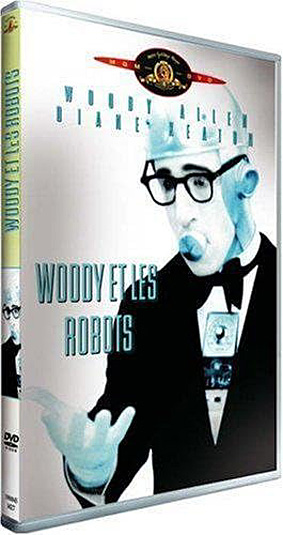





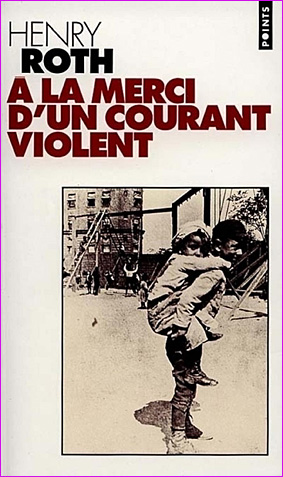









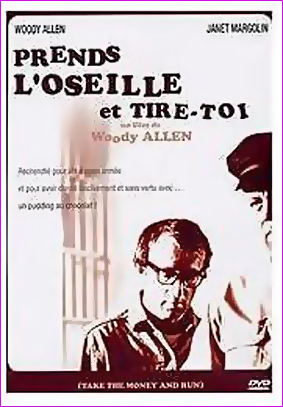







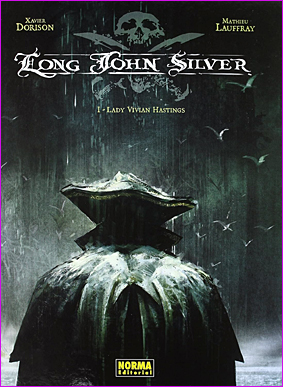


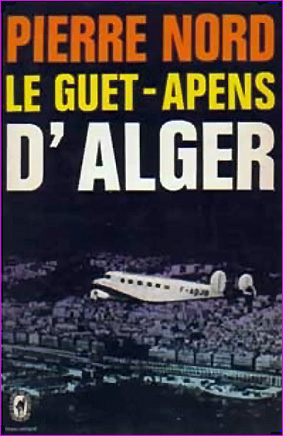
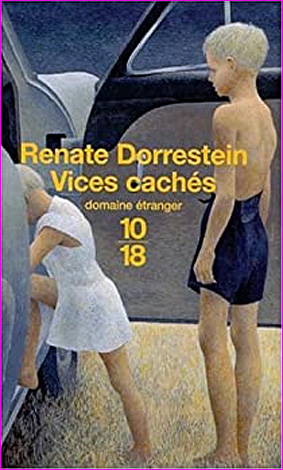
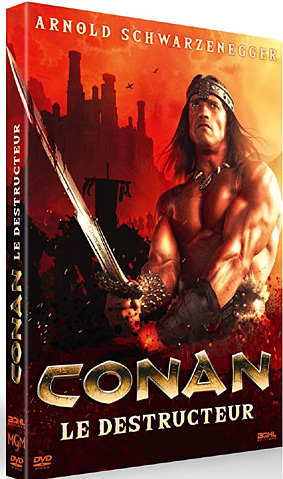









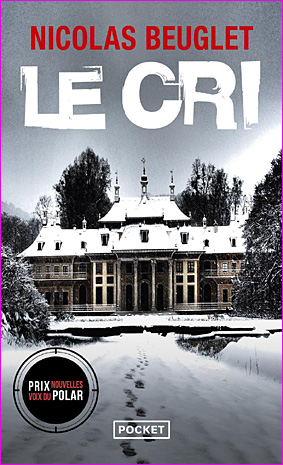
































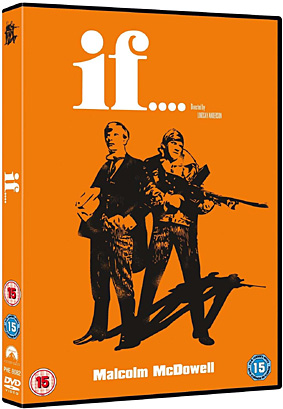





















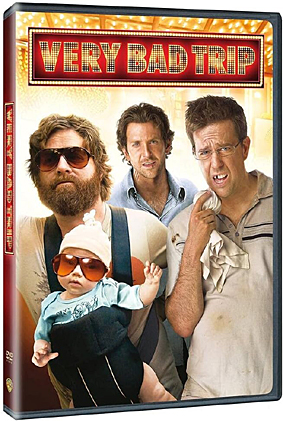









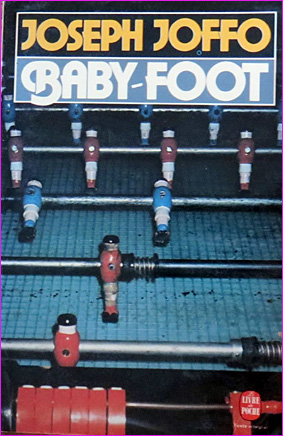
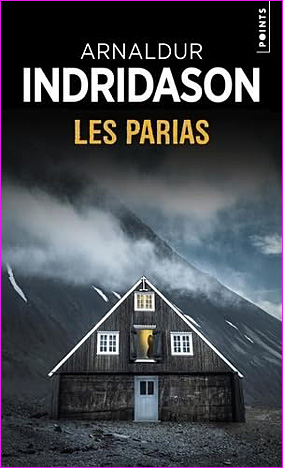
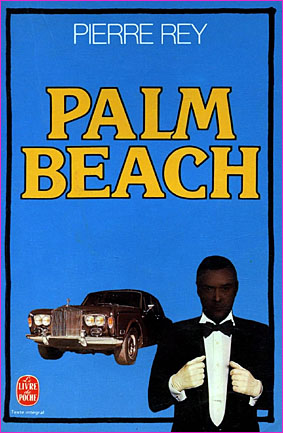

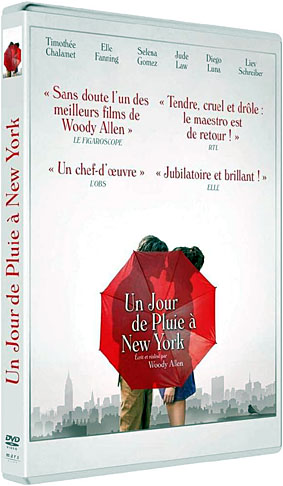








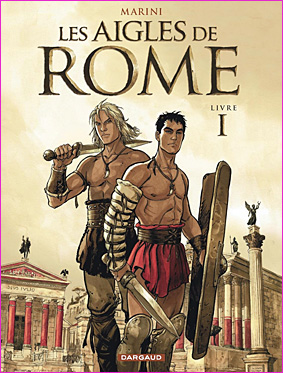

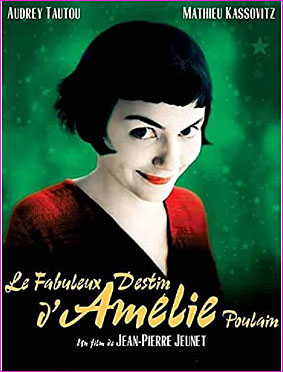












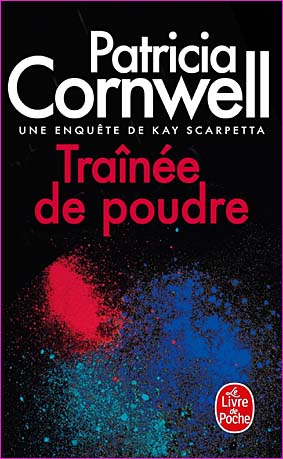
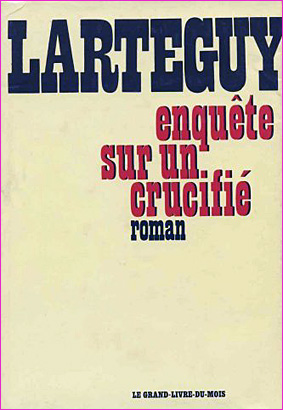
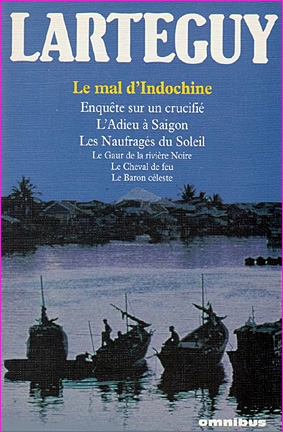
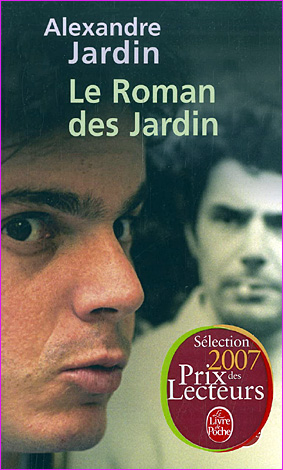


Commentaires récents