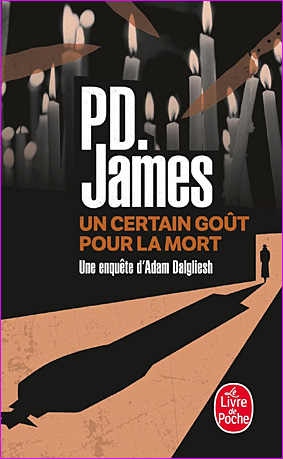
Une vieille fille de 65 ans, solitaire punaise de sacristie, et Darren, un gamin de 10 ans miséreux et fils de pute, se rencontrent sur le chemin de halage un matin vers huit heures et demie. Ils vont ouvrir l’église Saint-Matthew à Londres, épousseter et mettre des fleurs devant la BVM (Blessed Virgin Mary – la Bienheureuse Vierge Marie). Ils découvrent… deux hommes égorgés dans la sacristie de l’église. Ce n’est pas banal, d’autant que l’un d’eux est un clochard et l’autre un ancien ministre qui vient juste de démissionner. Double meurtre ou suicide ? Les indices sont maigres et les analyses donnent peu d’informations. Tout se joue, comme toujours, dans la psychologie des personnages, leurs habitudes, leur famille et relations.
Pour le vagabond alcoolique, pas grand-chose à dire, il était marginal, et se réfugiait dans ce lieu ouvert à tous – à condition d’en demander la clé au presbytère. C’est vraisemblablement l’autre personnage qui l’a fait entrer. Il s’agit de sir Paul Berowne, baronnet qui a obtenu le titre après la mort en Irlande de son frère aîné Hugo, militaire, et qui est devenu député conservateur, puis secrétaire d’État.
Adam Dalgliesh, commissaire à la tête de la toute nouvelle section des enquêtes sensibles mettant en cause des personnalités, officie ici sur un cas compliqué. Sir Paul avait connu ces deux derniers jours comme une révélation. Il avait attrapé la foi comme on attrape la grippe, aussi soudainement, aussi absolument. Son existence, pourtant réussie en apparence, ne le satisfaisait pas. Il avait pris le titre et la maison de son frère, il s’était remarié avec une fille belle et sotte surnommée Barbie après avoir tué sans le vouloir sa première femme dans un accident de voiture, et délaissé sa fille Sarah. Celle-ci, désormais adulte, s’est maquée avec un bourgeois révolutionnaire qui adore comploter et créer des cellules secrètes, faisant engager du personnel acquis à ses convictions pour espionner, et l’occuper ainsi pour le garder sous sa coupe. Quant à Swayne, le frère de Barbie qui aurait aimé être un Ken, il vit en parasite, délaissé par leur mère qui vole d’amant riche en amant riche. Sarah elle-même a pour amant le docteur Lampart, gynécologue et directeur d’une clinique très rentable d’accouchements et d’avortements. Règne sur la maisonnée la matriarche de 82 ans, fille de comte, Lady Ursula, qui garde les mystères de famille et du petit personnel sous sa morgue aristo. De plus, Barbie est enceinte… mais pas de son amant, qui a subi une vasectomie.
Le commissaire Dalgliesh, avec son adjoint inspecteur-principal Massingham et l’inspecteur femme Miskin, aime son métier et son équipe. Il « aime la mort » car elle révèle l’humanité des gens. Le titre est d’ailleurs tiré d’un poème d’Alfred Edward Housman : « There’s this to say for blood and breath,/ they give a man a taste for death » – il y a ceci à dire sur le sang et le souffle,/ ils donnent à l’homme le goût de la mort.
L’affaire a des ramifications dans le passé puisqu’un tract anonyme (mais orienté) accuse sir Berowne d’avoir provoqué la mort de sa femme et d’une infirmière de sa mère, retrouvée nue après s’être jetée alcoolisée dans la Tamise à la suite d’un avortement. On le soupçonne d’avoir été le père du fœtus, ce qu’il nie. Car il a convoqué Adam Dalgliesh plusieurs semaines avant sa mort pour lui faire part du tract anonyme, reçu au courrier, et d’un article de la Paternoster Review, feuille de chou confidentielle mais néanmoins conservatrice qui en reprend les termes. Le commissaire ne peut manquer de voir un lien entre ces morts successives et les égorgements de Saint-Matthew. D’autant que chacun ment sans arrêt, et presque sur tout. Il faut à chaque fois enquêter, vérifier, établir de façon irréfutable les faits avec preuves physiques et témoignages concordants, pour que les menteurs avouent candidement avoir menti à la police, par souci de bienséance.
Mais tout finit par se savoir et le lecteur connaîtra vers la fin qui a tué et pourquoi. Ce qui compte est comment le prouver, et surtout l’imprévu du dénouement final. La société anglaise des gosses de riches, des politiciens démagogues, mais aussi la bureaucratie des « services sociaux » n’en sortent pas grandis, et c’est ce qui fait tout le sel des romans de Phyllis Dorothy James.
Ainsi les députés de gauche qui proposent des lois imbéciles : « Si j’ai bien compris le raisonnement assez confus de mon honorable collègue, on demande au gouvernement de garantir à tous les citoyens l’égalité de l’intelligence, du talent, de l’énergie et de la fortune, et d’abolir le péché originel à partir de la prochaine année fiscale. Le gouvernement de Sa Majesté est prié de réparer par décrets statutaires l’échec éclatant que la divine providence connaît dans ce domaine » p.317.
Ou encore le besoin de religion jusqu’à l’absurde, rôle tenu dès les années 80 par l’antiracisme (touche pas à mon pote) et reprise aujourd’hui avec délice par LFI : « Le lycée polyvalent d’Ancroft avait eu sa religion lui aussi. Une religion à la mode et bien pratique vu qu’il était fréquenté par des élèves de vingt nationalités différentes : l’antiracisme. Vous ne tardiez pas à comprendre que vous pouviez vous permettre d’être aussi rebelle, paresseuse ou stupide que vous vouliez si vous connaissiez à fond cette doctrine fondamentale. Celle-ci ressemblait à n’importe quelle autre religion : on pouvait l’interpréter comme on voulait ; composée de quelques banalités, mythes et slogans, elle était facile à apprendre ; elle était intolérante, pouvait parfois servir de prétexte à une agression sélective et permettait d’ériger en vertu morale le fait de mépriser les gens qu’on n’aimait pas. Et par-dessus tout, elle ne vous coûtait rien » p.367. Délicieusement vrai…
Long roman, mais il le mérite.
Grand prix de littérature policière, meilleur roman étranger 1988
Phyllis Dorothy James, Un certain goût pour la mort (A Taste for Death), 1986, Livre de poche 1989, 575 pages, €8,90, e-book Kindle €7,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans policiers psychologiques de P.D. James déjà chroniqués sur ce blog




























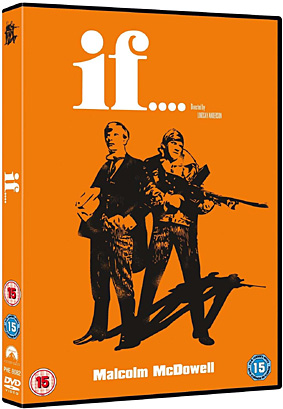




























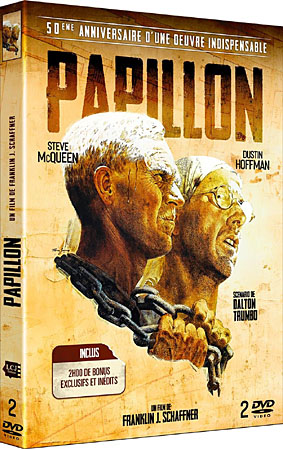













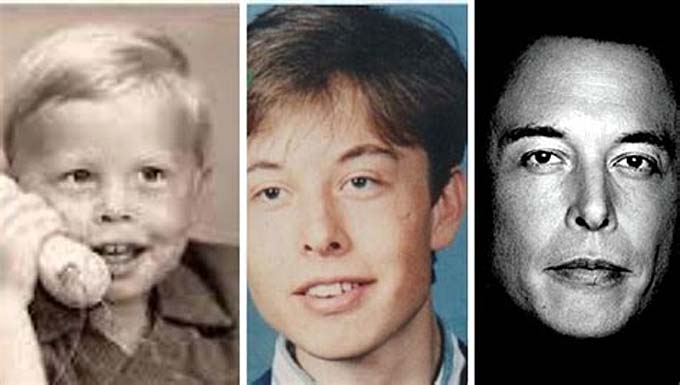

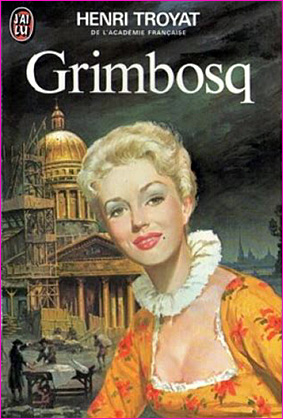
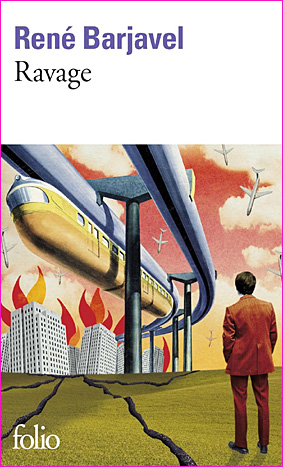


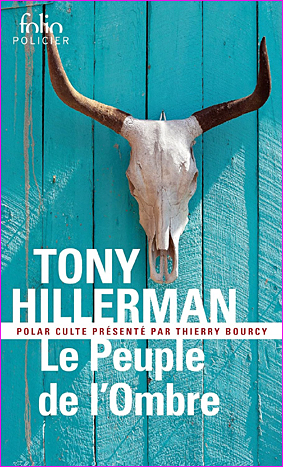
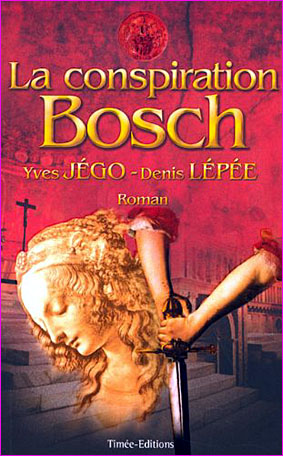



























































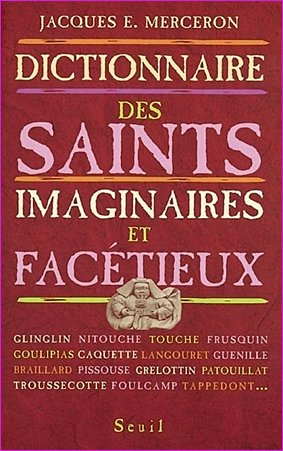
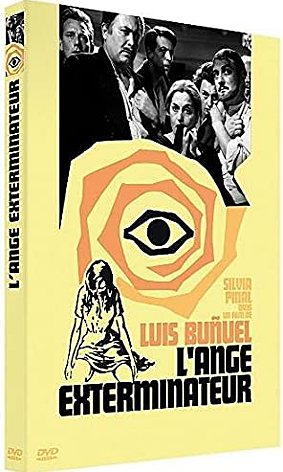












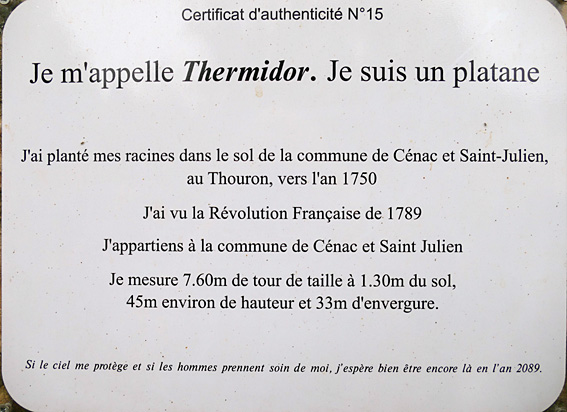


















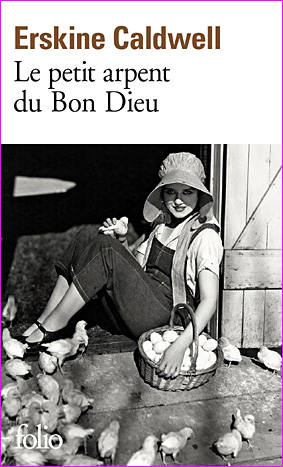















Commentaires récents