Dans un long chapitre, Zarathoustra résume sa pensée ; il attend son heure entre les anciennes tables de la lois et les nouvelles qu’il prône. Les anciennes tables sont celles de son temps, le très long temps du christianisme, cette religion d’esclaves soumis au jaloux Créateur des tables, Commandeur des croyants et Rachat du « péché » par le Fils issu de vierge – les trois religions proche-orientales du même Livre.
« Lorsque je suis venu auprès des hommes, je les ai trouvés assis sur une vieille présomption. Ils croyaient tout savoir, depuis longtemps, ce qui est bien et mal pour l’homme. » Or personne ne sait ce qui est bien et mal, sinon le créateur. « Or le créateur est celui qui donne un but aux hommes et qui donne son sens et son avenir à la terre : lui seul crée le bien et le mal de toute chose. » Pour Nietzsche, le créateur, ce n’est pas UN Dieu, mais soi-même. A chacun de définir SON bien et son mal car il n’est point de Dieu mais une multitude de dieux qui dansent de joie vitale et rient de leur exubérance irrationnelle – comme on le dit des adolescents.

Le bien, c’est l’avenir, pas le passé. C’est ce qui est bon aujourd’hui pour le futur, d’où la création permanente des valeurs – de ce qui vaut pour ses enfants. Nietzsche est au fond libertaire, adepte de la plus totale liberté du désir, lequel est le jaillissement même de la vie en lui. Certes, le désir instinctif chez l’être humain accompli – « noble » dit Nietzsche – passe par les passions du cœur maîtrisées par la volonté et tempérées par l’esprit (qui est à la fois souffle et raison). Mais le désir en lui-même est « sage » puisqu’il vient de la vie, du vital en soi : « Et souvent il m’a emporté loin, par-delà les monts, vers les hauteurs, au milieu du rire : je volais en frémissant comme une flèche, dans une extase enivrée de soleil : – loin, dans un avenir que nul rêve n’a vu, en des midis plus chauds que jamais poète n’en rêva : là-bas ou des dieux dansants ont honte de tous les vêtements ». Il faut se fuir et se chercher toujours, dit Nietzsche, se remettre en question « comme une bienheureuse contradiction de soi ». Loin, bien loin de « l’esprit de lourdeur et tout ce qu’il a créé : la contrainte, la loi, la nécessité, la conséquence, le but, la volonté, le bien et le mal ».
Loin « des taupes et des lourds nains », Nietzsche/Zarathoustra recherche le sur-homme « et cette doctrine : l’homme est quelque chose qui doit être surmonté ». Homme mis pour être humain sans distinction de sexe, cela va de soi dans la langue française traditionnelle (celle que l’on n’apprend plus, d’où les bêtises émises par les féministes mal éduquées nationalement). L’homo sapiens est un pont et non une fin. L’espèce ne cesse d’évoluer, comme elle l’a fait depuis des millions d’années. « Surmonte toi toi-même, jusque dans ton prochain : tu ne dois pas te laisser donner un droit que tu es capable de prendre. Ce que tu fais, personne ne peut le faire à son tour. Voici, il n’y a pas de récompense. Celui qui ne peut pas se commander à soi-même doit obéir. » D’où le refuge de la masse flemmarde dans la religion, la croyance, le parti, le gourou, le complot : se laisser penser comme on se laisse aller, par confort de chiot en sa niche au milieu de sa nichée, sans effort. « Celui qui fait partie de la populace veut vivre pour rien ; mais nous autres, à qui la vie s’est donnée, nous réfléchissons toujours à ce que nous pourrions donner de mieux en échange ! » Et ceci pour ceux tentés de violer par seul désir, au mépris de la maîtrise de soi : « On ne doit pas vouloir jouir, lorsque l’on en donne pas à jouir. (…) Car la jouissance et l’innocence sont les deux choses les plus pudiques : aucune des deux ne veut être cherchée. Il faut les posséder. »
Le désir est jeune car la vitalité est neuve, l’avenir est ouvert parce que le désir est grand. Cela agace les vieux qui se croient sages parce que leurs désirs se sont éteints et qu’ils disent à quoi bon ? Mais est-ce sagesse ? « Ce qu’il y a de mieux en nous est encore jeune : c’est ce qui irrite les vieux gosiers. Notre chair est tendre, notre peau n’est qu’une peau d’agneau : – comment ne tenterions nous pas de vieux prêtres idolâtres ! » On voit, cum grano salis, que la tentation pour les enfants de chœur à peine pubères ne date pas de Mitou. Les vieux rassis et trop contraints sont obsédés par la liberté en fleur. Hypocritement, ils cèdent en disant le bien et le mal qu’ils ne pratiquent pas. « Être véridique : peu de gens le savent ! Et celui qui le sait ne veut pas l’être ! Moins que tous les autres, les bons » – ceux qui se disent bons, qui se croient bons parce qu’ils obéissent en apparence aux Commandements de la Morale ou du Dieu jaloux.
Abandonner le passé, les vieilles valeurs qui ne valent plus car inadaptées. « Abandonner à la grâce, à l’esprit et à la folie de toutes les générations de l’avenir, qui transformeront tout ce qui fut en un pont pour elle-même ! » Chaque génération tracera sa voie, les valeurs d’hier ne seront pas celles d’aujourd’hui, ni encore moins celles de demain. Ce pourquoi s’arc-bouter sur le passé, les traditions, les valeurs du passé, est un leurre, dit Nietzsche. Et il se fait prophète, avant le siècle des dictateurs : « Un grand despote pourrait venir, un démon malin qui forcerait tout le passé par sa grâce et et par sa disgrâce : jusqu’à en faire pour soi un pont, un signal, un héraut et un cri de coq. » Et Hitler vint, après Mussolini et Staline, le vieux Pétain et le vieux Franco, et avant Mao, Castro, Pol Pot et autres Khadafi.

Ce pourquoi Nietzsche en appelle à « une nouvelle noblesse », de celle qui ne s’achète pas comme des offices, comme les fausses particules de l’Ancien régime, « des créateurs et des éducateurs et des semeurs de l’avenir. » La noblesse d’empire, conquise sur les champs de bataille, paraissait à Nietzsche comme à Stendhal de meilleure facture. Car « ce n’est pas votre origine qui vous fera dorénavant honneur, mais votre but ! Votre volonté et votre pas qui veut vous dépasser vous-même – que ceci soit votre nouvel honneur ! » Où l’on voit que, malgré l’apparence de chevalerie des ordres nazis, l’honneur n’est pas fidélité mais, au contraire, grande liberté requise. « Il faut une nouvelle noblesse, adversaire de tout ce qui est populace et despotisme, et qui écrirait d’une manière nouvelle le mot ‘noble’ sur des tables nouvelles. » Ni populace, ni despotisme – ni Mélenchon, ni Le Pen, vous l’aurez compris…
Et Nietzsche d’enfoncer le clou où crucifier les futurs nazis et leurs épigones jusqu’à aujourd’hui : « Ô mes frères ! Ce n’est pas en arrière que votre noblesse doit regarder, c’est au-dehors ! Vous devez être des expulsés de toutes les patries et de tous les pays de vos ancêtres ! Vous devez aimer le pays de vos enfants : que cet amour soit votre nouvelle noblesse – le pays inexploré dans les mers les plus lointaines, c’est lui que j’ordonne à vos voiles de chercher et de chercher toujours. Vous devez racheter par vos enfants d’être les enfants de vos pères : c’est ainsi que vous délivrerez tout le passé ! » Pas de traditions, pas de nationalisme, pas de sang et sol – mais l’amour du futur, des enfants à naître et à élever pour les rendre meilleurs que vous n’avez été : seul cela justifie d’être les enfants imparfaits de parents imparfaits – et des immigrés intégrés dans un pays d’accueil…
Même s’il y a de la fange dans le monde, la vie reste une source de joie. Perpétuellement. Ne calomniez pas le monde, faites avec. Apprenez les meilleures choses et mangez bien, aspirez à connaître. « La volonté délivre : car vouloir, c’est créer, c’est là ce que j’enseigne. » Et contre les chômeurs alors qu’il y a de l’emploi, contre les mendiants qui pourraient travailler, contre les assistés qui ont la paresse de se prendre en main, Nietzsche est cruel – mais juste. Il dit : « Car si vous n’êtes pas des malades et des créatures usées, dont la terre est fatiguée, vous être de rusés fainéants ou des chats jouisseurs, gourmands et sournois. Et si vous ne voulez pas recommencer à courir joyeusement, vous devez disparaître ! Il ne faut pas vouloir être le médecin des incurables : ainsi enseigne Zarathoustra : disparaissez donc ! »
A quoi cela sert-il, en effet « d’aider » sans cesse et tant et plus ceux qui ne veulent pas s’aider aux-mêmes : les pays en développement qui ne cessent de se sous-développer et de dépenser l’argent prêté en armements et en richesses accaparées par la corruption comme en Haïti et dans tant de pays d’Afrique ; les sempiternels « ayant-droits » aux caisses de l’État-providence qui crient maman dès qu’une difficulté survient : quoi, travailler à mi-temps pendant ses études (je l’ai fait) – vous n’y pensez pas ! Quoi, vivre chez les parents au lieu de payer un co-loyer (je l’ai fait) – vous n’y pensez pas ! quoi, refuser une rémunération et des conditions de travail correctes dans les métiers « en tension » – vous n’y pensez pas (dit le patronat qui en appelle à une immigration massive d’esclaves basanés, jusqu’à 3,5 millions d’ici 2050) ! « Si ces gens-là avaient le pain pour rien, quelle infortune ! après quoi crieraient-ils ? Leur entretien, c’est le seul sujet dont ils s’entretiennent. » Le pain ou le profit, même égoïsme.
Le « plus grand danger » est dans le cœur « des bons et des justes », dit Nietzsche. Car eux save, nt déjà tout ce qu’il faut savoir, croient-ils Bible en main, et n’en démordent pas. Ils ne cherchent plus, ils restent immobiles, ils ruminent comme des vaches à l’étable, contents de soi. « Leur esprit est prisonnier de leur bonne conscience. » Jésus lui-même l’avait dit des Pharisiens, ce mot qui est devenu depuis synonyme d’hypocrite et de Tartuffe. « Il faut que les bons crucifient celui qui avance sa propre vertu ! » démontre Nietzsche, pas fâché d’utiliser ainsi le christianisme dans sa partielle vérité. « C’est le créateur qu’ils haïssent le plus : celui qui brise des tables et de vieilles valeur, le briseur – c’est celui qu’ils appellent criminel. Car les bons ne peuvent pas créer : ils sont toujours le commencement de la fin : ils crucifient celui qui inscrit des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles, il se sacrifient l’avenir à eux-mêmes – ils crucifient tout l’avenir des hommes ! » Rien de pire que les conservateurs. Au contraire, prône Nietzsche, nous ne voulons pas conserver mais explorer : « nous voulons faire voile vers là-bas, où est le pays de nos enfants ! »
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog


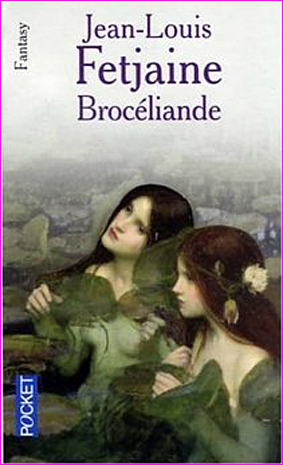

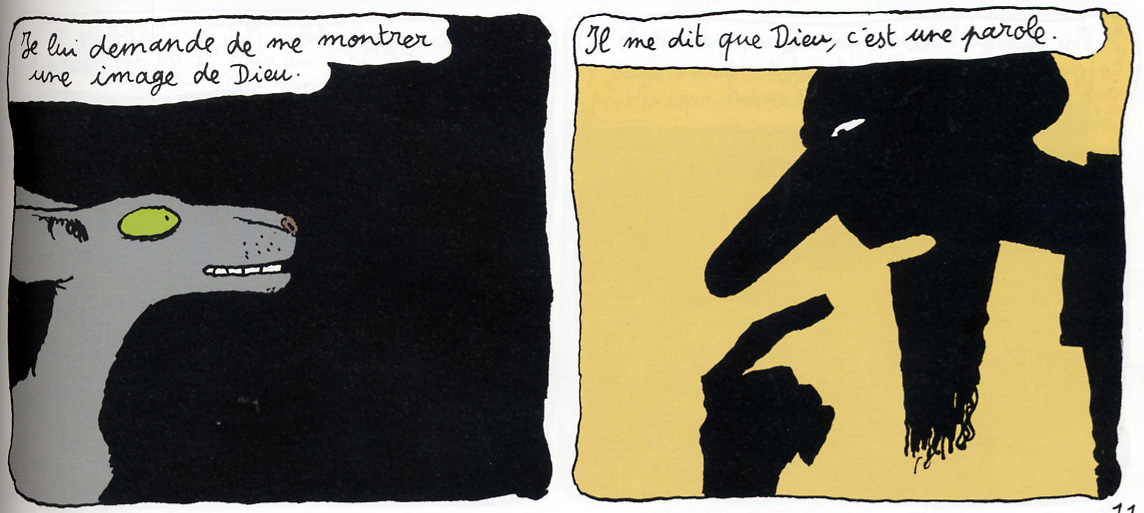
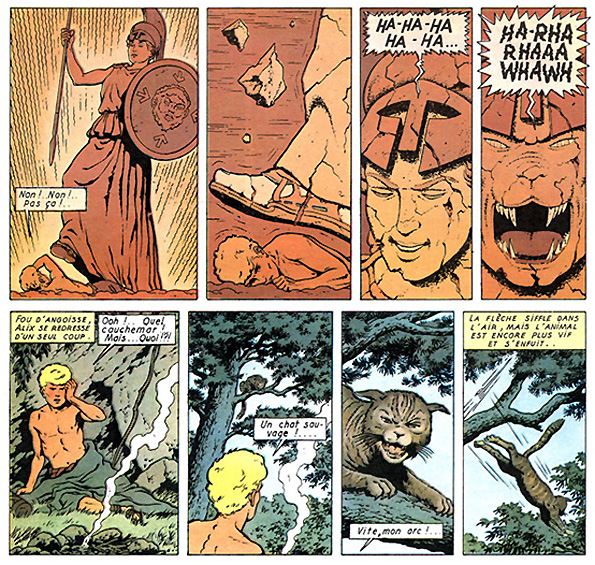

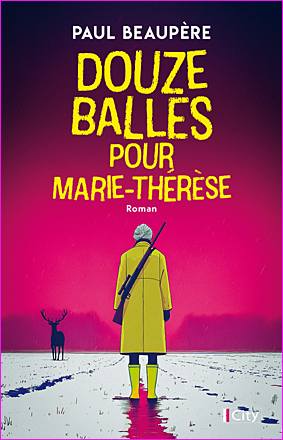
 Photo copyright Paul Bertin
Photo copyright Paul Bertin
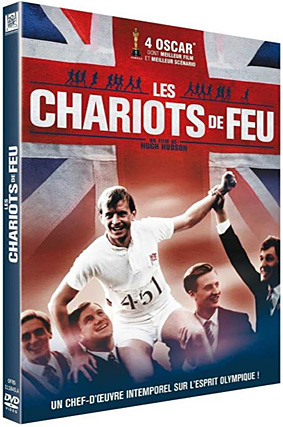










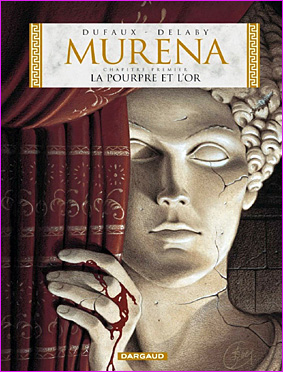
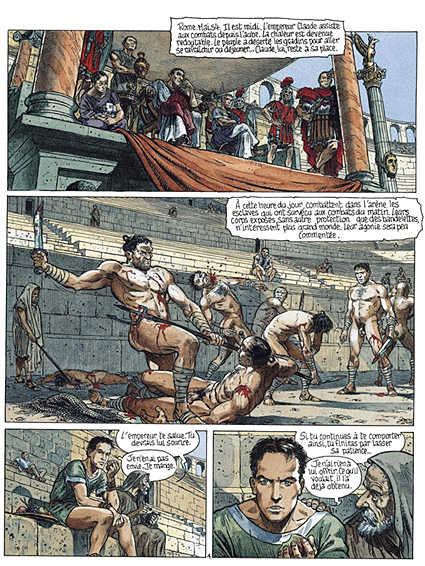
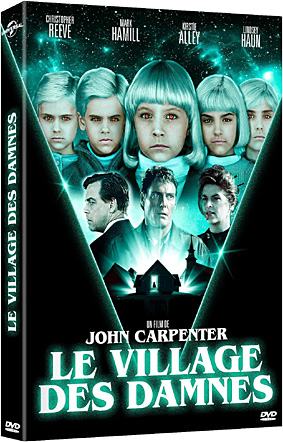





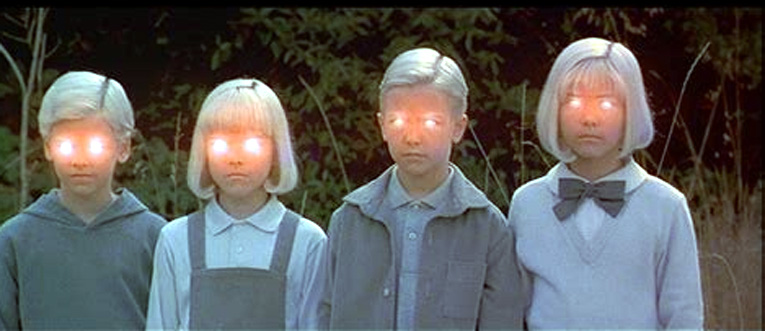








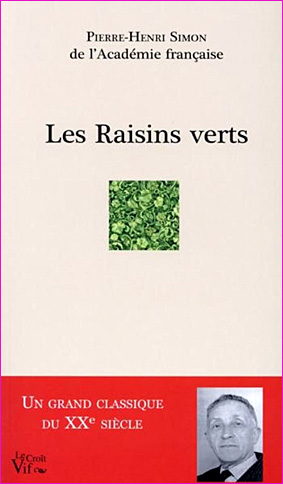
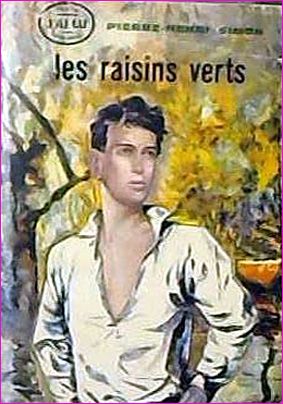


































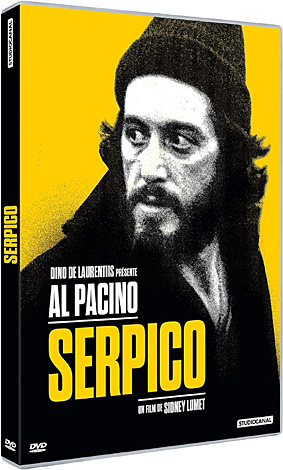









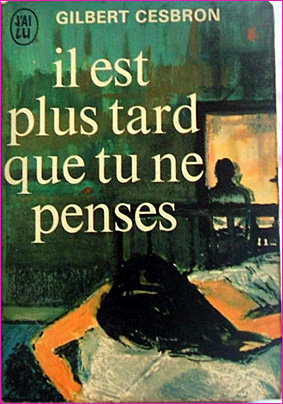

Commentaires récents