
« Sur les décombres de la [crise financière], l’assurance renaissante des jeunes comme des vieux s’était vue dopée par la jeunesse relative de [Trump],et par ses allures de sportif délié, diamétralement opposées aux handicaps physiques de [Biden], séquelles de la polio. Et puis il y avait le miracle du [spatial] et du nouveau mode de vie qu’elle promettait (…), la voie inconnue d’un avenir aéronautique, tout en leur assurant par ses manières vieux jeu, et même collet monté, qu’il n’y avait aucun risque de voir les succès de la technologie moderne éroder les valeurs de la tradition. Il apparaissait donc, concluaient les experts, que les Américains du XXe siècle, las de faire face à une nouvelle crise tous les dix ans, avaient soif de normalité. (…) Le nouveau président des États-Unis, partit rencontrer [Vladimir Poutine]en [Alaska] où,à l’issue de deux jours d’entretiens ‘cordiaux’, il signa un ‘accord’ garantissant des relations pacifiques entre [la Russie] et les États Unis » p.932. On se croirait aujourd’hui, or cela avait lieu en 1940 dans l’uchronie de Philip Roth. Remplacez Trump par Lindberg, crise financière par Grande dépression, spatial par aéronautique, Russie impérialiste par Allemagne nazie, Alaska par Islande, et vous aurez le texte original.
En trois ans de travail, l’auteur quitte pour une fois son univers obsessionnel du sexe, des bites et des seins pour se concentrer sur son autre obsession : les Juifs. Que se serait-il passé, si… ? Il imagine que le démocrate F.D. Roosevelt a été battu aux élections de novembre 1940 au profit d’un héros à grande gueule qui promet la paix, Charles Lindberg. L’aviateur qui a franchi l’Atlantique en 1927 aux commandes de son Spirit of St. Louis est aussi sympathisant du régime nazi et membre du comité isolationniste America First. Tout est vrai de FDR et de Lindberg, comme de beaucoup de personnages historiques dans le livre (leur bio réelle est donnée par l’auteur en annexe). Lindberg, Américain d’origine suédoise, visite l’Allemagne de Hitler en 1936 et assiste aux JO de Berlin, où il considère que le petit caporal est « un grand homme » ; il est décoré en octobre 1938 par le maréchal de l’armée de l’air nazie Goering de la croix de l’Aigle allemand, médaille d’or à quatre petites croix gammées ; il écrit dans son Journal le 1er septembre 1939, dans les jours qui suivent l’invasion de la Pologne par l’Allemagne : « Nous devons nous protéger des attaques des armées étrangères, et de la dilution par les races étrangères (…) ainsi que de l’infiltration d’un sang inférieur. L’aviation est l’un de ces biens précieux qui permettent à la race blanche de survivre dans une mer menaçante de Jaunes, de Noirs et de Basanés » Annexes, p.1230. On le voit, les idées de Trump et de son vice Vance étaient déjà les idées des années trente en Amérique : isolationnisme, ségrégation raciale, égoïsme sacré de l’America First, pari sur l’avance technologique pour sauver ‘la race blanche’ (« Non-Hispanic Whites ») de la submersion raciale – prévue par les démographes aux États-Unis vers 2045.
Pour ce projet ambitieux, Philip Roth fait revivre Weequahic, le quartier juif de Newark, dans le New Jersey de son enfance, et laisse décrire les événements par un Philip entre 7 et 9 ans. Son grand frère Sandy est charmé par le programme d’assimilation des ados, « Des Gens parmi d’Autres », concocté par le nouveau pouvoir pour briser les ghettos et faire découvrir les chrétiens ruraux aux petits juifs urbains restés entre eux. Sa tante Evelyn s’est entichée du rabbin collabo Bengelsdorf et finira par l’épouser, à être invitée à la Maison Blanche et à sympathiser avec la Première Dame. Elle tombera de haut lorsque la répression contre les Juifs « bellicistes » se manifestera par l’assassinat de Winchell, journaliste juif candidat à l’investiture républicaine, les pogroms de nationalistes blancs, dont la mère de son copain Seldon, juive grillée vive dans sa voiture dans le Kentucky où elle avait été « exilée » par le programme de dispersion des quartiers juifs par l’administration. Tout le suspense du roman est d’imaginer ce qui pourrait arriver avec le temps, plus que de constater ce qui survient au présent. Les Juifs ne sont plus américains, mais allogènes, rejetés comme non-Blancs. Ils perdent leur emploi, les meneurs sont surveillés par le FBI. Certaines familles émigrent au Canada, mais pas les Roth.
Philip Roth observe l’obstination de son père à persister dans ce qu’il croit vrai, sans écouter personne. Un trait courant dans la culture juive, si l’on en croit le côté « roquet » de nombre d’animateurs de radio et de télévision juifs. Ils persistent à avoir raison, ils insistent en reposant inlassablement les mêmes questions pour « faire dire » ce qu’ils voudraient entendre dire. Le père n’écoute pas sa femme, qui prépare une cagnotte au Canada au cas où. Lorsque les émeutes commencent et que les frontières sont fermées, il regrette, mais trop tard, toujours trop tard, à cause de sa rigidité mentale – tous comme les Juifs français en 1940.
Heureusement, l’avion du Président disparaît mystérieusement et ne reparaît pas. La théorie du Complot stipule qu’il été subtilisé par les nazis parce qu’il ne les servait plus aux États-Unis, et qu’il va retrouver son fils de 12 ans, le « bébé Lindberg » enlevé en mars 1932 par l’immigré allemand Bruno H. Hauptmann. Le cadavre décomposé découvert près de la propriété serait une substitution, l’enfant aurait été emmené en Allemagne et élevé comme un petit Hitlerjugend afin de « tenir » le président Lindberg et de lui faire faire une politique favorable aux nazis. On pense aussitôt à Trump, qui serait de même « tenu » par la Russie et ses services secrets pour quelque scandale d’argent ou de mœurs… ce qui expliquerait l’inclination trompiste à une indulgence sans précédent pour la Russie mafieuse et impérialiste.
Mais, comme le 1984 de George Orwell qui faisait une allégorie du système communiste, le Plot against America est lui aussi une allégorie des potentialités américaines. Il ne désigne aucun régime en particulier, pas plus celui de Bush le Petit que celui de Trump bis, mais s’applique aux deux, et à d’autres à venir. Si Trump défend les Juifs – son gendre l’est, ses copains milliardaires aussi pour la plupart, et son copain de jeux sexuels Epstein aussi – il ne se défend pas de valoriser la race blanche, au détriment des Noirs, Latinos et autres Jaunes. Il veut les cantonner, les marginaliser, les expulser, manu militari s’ils sont illégaux. La fascisation de l’Amérique est un possible du pays, la « liberté » n’étant au fond pas une valeur en soi, mais seulement le pouvoir libertarien de faire ce qu’on veut lorsqu’on est le plus fort – avec la volonté de le rester. Et ne croyez pas que c’est du fantasme : ça arrive DES AUJOURD’HUI sous sa majesté Trompe II.
Un roman prémonitoire à bien des égards, même s’il est centré uniquement sur les Juifs. Le régime démocratique est fragile, à la merci d’une majorité, le plus souvent crédule et manipulable par les agitateurs populistes et les réseaux. Même les contre-pouvoirs ont leurs limites. D’où l’exigence de l’éducation, de l’esprit critique, de l’analyse des sources, du penser par soi-même – au cœur des libertés des Lumières, et de la tradition grecque.
Philip Roth, Le Complot contre l’Amérique (The Plot Against America), 2004, Folio 2007, 576 pages, €10,50, e-book Kindle €9,99
Philip Roth, Romans 1993-2007 : Opération Shylock, Le théâtre de Sabbath, Le complot contre l’Amérique, Exit le fantôme, Gallimard Pléiade, édition Philippe Jaworski, 2025, 1609 pages, €70,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)











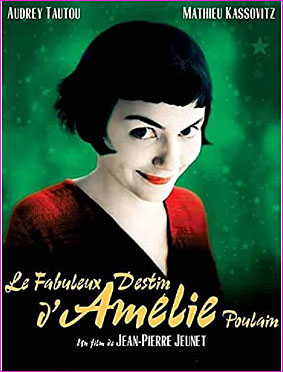
















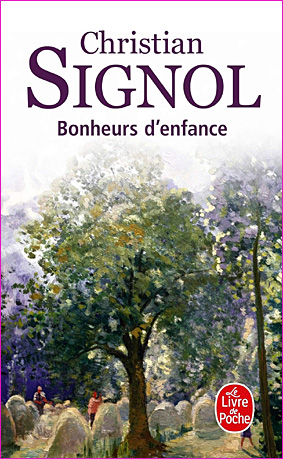

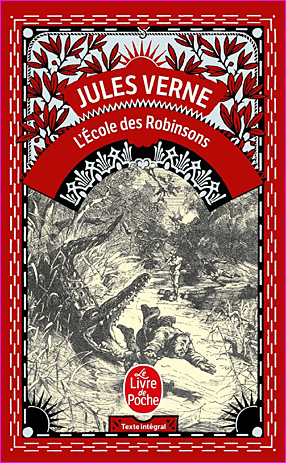
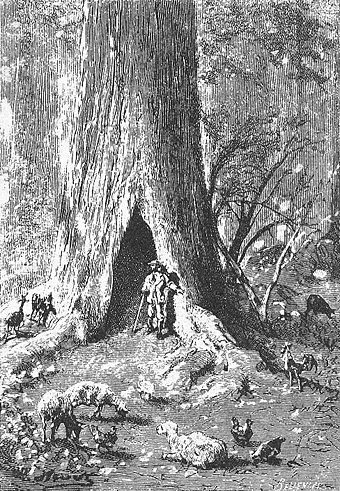











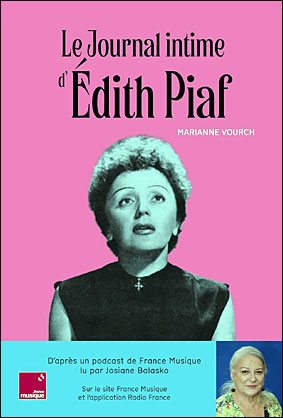
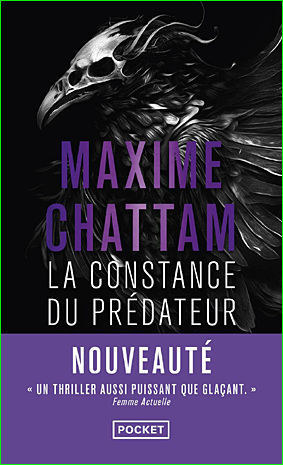
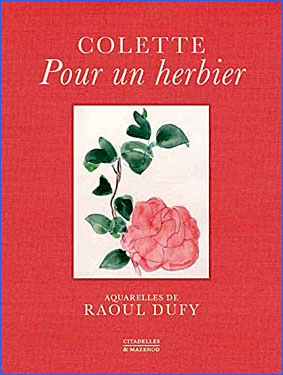
















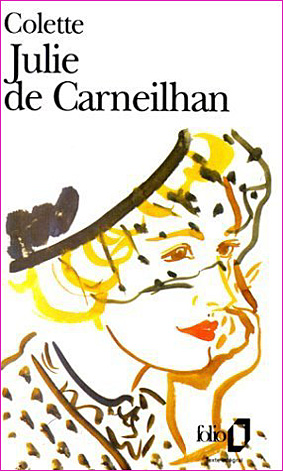
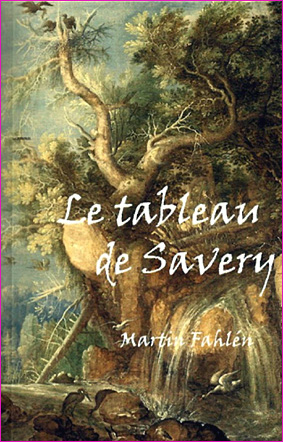
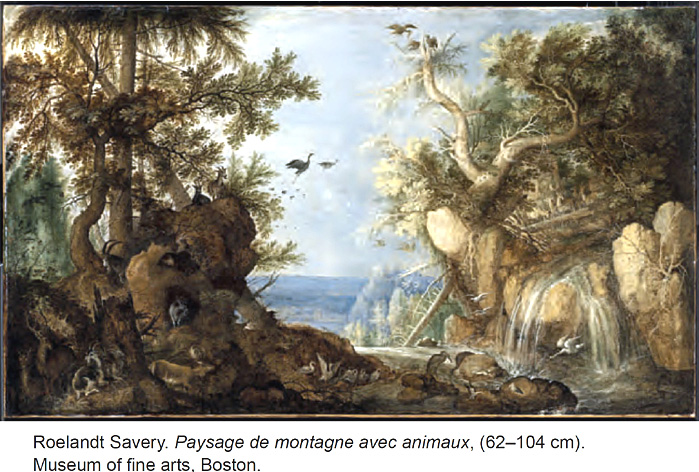
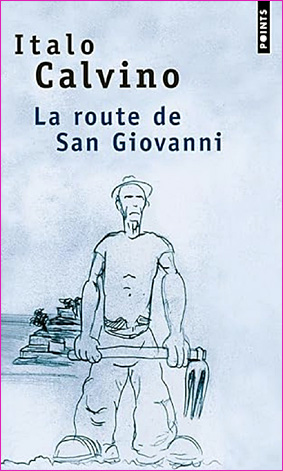




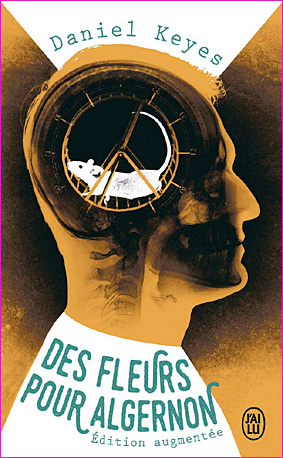
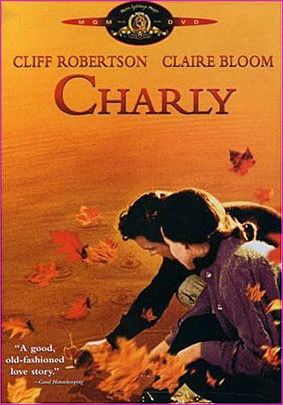



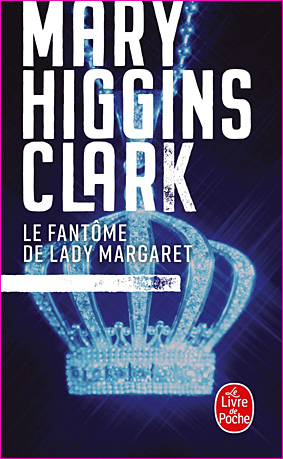

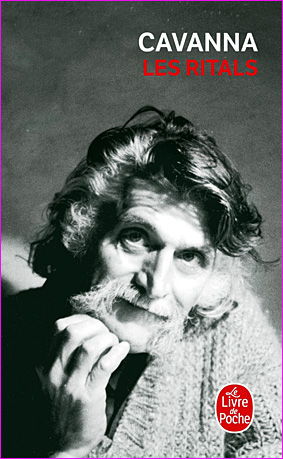



Commentaires récents