Nier scientifiquement les races n’est pas le problème, la dignité humaine est question de droit, pas de biologie. Se croire supérieur est remis en cause par l’histoire même. Seuls les échanges permettent d’avancer – à condition d’être ouvert, donc capable d’être soi, bien formé par le système scolaire et la société. Or l’idéologie antiraciste est devenue un politiquement correct qui conforte l’immobilisme et ne veut rien connaître du ressentiment des petits Blancs. Elle est la bonne excuse des gens de gauche pour surtout ne rien changer aux maux de la société. Pour vivre ensemble en bonne intelligence, il faut plutôt conforter transparence et démocratie : c’est de la politique, ni de la science, ni de la morale.
1/ Les races humaines n’existent pas pour la biologie moléculaire qui ne considère que les gènes ; pas plus pour la génétique des populations qui fait des « races » des fréquences statistiques en perpétuel changement. Mais les classifications faites par chacun pour parler des autres ne sauraient se réduire au réductionnisme moléculaire. La science peut nous dire comment est fait le monde ; elle ne nous dit rien sur la façon de nous conduire. Ce qui est en question dans la société n’est pas la différence entre minorités visibles, mais l’égalité des droits et devoirs en dignité et comme citoyens. Les rapports sociaux sont infiniment plus importants dans la vie de tous les jours que les classements en fonction des peaux, des sangs et des gènes. L’égalité des droits ne doit rien à la biologie ; la politique n’est pas, chez nous, une biopolitique. En démocratie, les assistés imbéciles ont les mêmes droits que les géniaux inventeurs et nul ne peut savoir si l’un est plus « utile » à la société que l’autre car ni le génie ni la bêtise ne se transmettent par les gènes, seulement par l’éducation, la culture et le milieu historique. Nul être humain ne se réduit à un ensemble de caractéristiques objectives, mesurables, scientifiques. Le sujet ne saurait être un objet.
Nous ne vivons pas chaque jour dans une population de gènes, nous vivons dans une population d’humains. Claude Lévi-Strauss le disait déjà dans Race et histoire (1951) : il ne faut pas confondre les caractéristiques biologiques et les productions sociales et culturelles. Certains médicaments, comme le vasodilatateur BiDil sont efficaces seulement chez les populations d’origine africaine – c’est un fait d’expérience. Mais reconnaître ce fait n’est pas de l’ethnocentrisme, qui consiste à rejeter tout ce qui ne correspond pas à notre norme. Ni de la xénophobie, qui consiste à faire de l’étranger (à la famille, au village, à la région, à la nation, à la race) un bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans notre société. Comme les Grecs disaient « barbares » tous les non-Grecs – forcément non-« civilisés ». Les ados aujourd’hui « niquent » ou tabassent tous ceux qui ne sont pas comme eux (photo) : où est la différence ?
Elle est dans la culture : quand Alexandre a vaincu les Perses, il a bien vu que la civilisation n’était pas seulement grecque. Et de cette fécondation croisée est née la grande bibliothèque d’Alexandrie – progrès – avant son incendie par les sectaires chrétiens, puis son éradication totale par l’islam intolérant.
2/ L’évolutionnisme biologique formulé par Darwin est fondé sur l’observation des espèces, mais le « faux évolutionnisme », selon Lévi-Strauss, est fondé sur l’apparente continuité historique qui aurait fait se succéder les civilisations dans un Progrès linéaire. Or le progrès n’est jamais linéaire : mille ans avant Jésus, on croyait la terre ronde ; mille ans après, on la croyait plate… Les civilisations stables dans la durée n’en sont pas moins subtiles et en évolution, même si leur histoire – tout aussi longue que la nôtre – présente peu de changements apparents. Les civilisations à la même époque se juxtaposent et échangent des marchandises, des idées et des hommes ; elles se combattent ou s’allient. La Renaissance se caractérise par la rencontre des cultures grecque, romaine, arabe, orthodoxe avec la culture européenne ; le jazz, le blues, viennent du melting-pot américain par le rythme africain et les vieilles chansons de marche françaises. Seule la puissance fait qu’une civilisation s’impose provisoirement, mais la puissance est sans cesse remise en cause : le Royaume-Uni régnait sur le monde en 1914 ; il a cédé le pas aux États-Unis dans les années 1930 ; ceux-ci vont probablement céder le pas à la Chine d’ici la fin du siècle.
Pour Lévi-Strauss, les sociétés qui connaissent le plus d’échanges ont pu cumuler le plus les idées, les capitaux et les innovations. Ce que montrent aussi l’historien Fernand Braudel et les économistes Joseph Schumpeter, Nicolaï Kondratiev et Immanuel Wallerstein. Chaque grappe d’innovations engendre de nouveaux métiers qui rebattent les distinctions sociales. La globalisation, au lieu d’aboutir à une même culture, amène plus de diversité. Elle est le moteur du progrès qui, par ses innovations, produit à son tour une diversité de cultures. A condition d’être ouvert à la nouveauté, et bien formé pour la recevoir. C’est là qu’est le problème…
3/ Être ouvert, c’est avoir une personnalité forgée par le savoir scolaire, mais aussi par les disciplines comme le sport qui forment le caractère. Pour être ouvert aux autres, il faut d’abord être soi. Claude Lévi-Strauss, dans la conférence Race et Culture prononcée à l’UNESCO à Paris en 1971, déclare : « toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs pouvant aller jusqu’à leur refus et même leur négation ». Scandale pour les béni oui-oui du politiquement correct ! Ce n’est pourtant que ce que tous les sages disent à leurs disciples : « Deviens ce que tu es » (temple de Delphes), « trouve ta voie » (Bouddha), « des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants » (Nietzsche), « vaincre toutes les aliénations de l’homme « (Marx), « tuez le Père » (Freud). Pour être soi même, il faut quitter sa famille, se dresser contre la tradition paternelle, sortir de son milieu. C’est à ce titre seulement que l’on devient adulte et responsable, individu créateur et pas un pion formaté interchangeable. Dire que tout ne vaut pas tout, ce n’est pas être « raciste » ni ingrat, mais déclarer que certaines façons d’être ont à nos yeux plus de valeurs que d’autres. Est-ce que l’école et même la société forment des êtres de caractère et de culture ? La démission du système depuis 1968 et peut-être avant (1940 ?) n’est-elle pas une part du problème ?
 4/ Créée sous l’égide de l’UNESCO en 1950, l’idéologie antiraciste était destinée à lutter contre les séquelles du nazisme et à affronter l’apartheid qui régnait aussi bien en Afrique du sud qu’aux États-Unis. Mais le politiquement utile est devenu politiquement correct. L’association CRAN s’est créée sur le critère de la « race » noire – ce qui disqualifie son combat même. L’apartheid a été éradiqué, sauf peut-être entre Israël et Palestine, mais n’empêche nullement des massacres « ethniques » en ex-Yougoslavie, les « génocides » au Rwanda et au Congo, ou autres répressions de « minorités » au Tibet, en Birmanie ou en Irak – sans que l’UNESCO s’en émeuve. Le retour des guerres de religion a remplacé ces derniers temps les guerres raciales. Mais le mécréant est situé par les croyants bien en-dessous de l’humain, comme s’il était d’une autre « race » : donc exploitable, vendable, corvéable à merci. Le lumpen proletariat d’Arabie Saoudite, les chrétiens enlevés et négociés par les sectes islamiques, les Coptes massacrés par les « musulmans en colère » sont autant d’exemples de sous-humanité traitée comme du bétail – dont les « antiracistes » ne disent pas un mot.
4/ Créée sous l’égide de l’UNESCO en 1950, l’idéologie antiraciste était destinée à lutter contre les séquelles du nazisme et à affronter l’apartheid qui régnait aussi bien en Afrique du sud qu’aux États-Unis. Mais le politiquement utile est devenu politiquement correct. L’association CRAN s’est créée sur le critère de la « race » noire – ce qui disqualifie son combat même. L’apartheid a été éradiqué, sauf peut-être entre Israël et Palestine, mais n’empêche nullement des massacres « ethniques » en ex-Yougoslavie, les « génocides » au Rwanda et au Congo, ou autres répressions de « minorités » au Tibet, en Birmanie ou en Irak – sans que l’UNESCO s’en émeuve. Le retour des guerres de religion a remplacé ces derniers temps les guerres raciales. Mais le mécréant est situé par les croyants bien en-dessous de l’humain, comme s’il était d’une autre « race » : donc exploitable, vendable, corvéable à merci. Le lumpen proletariat d’Arabie Saoudite, les chrétiens enlevés et négociés par les sectes islamiques, les Coptes massacrés par les « musulmans en colère » sont autant d’exemples de sous-humanité traitée comme du bétail – dont les « antiracistes » ne disent pas un mot.
En nos pays développés, le tabou sur les minorités visibles, victimes – forcément victimes – fait que l’on ne peut critiquer leurs travers sans être accusé de la rage : le racisme. Pourquoi ne pas dire qu’il y a plus de délinquants d’origine maghrébine dans les prisons françaises que la moyenne ? Pourquoi ne pas dire aussi que de très nombreux étudiants aux noms maghrébins présentent des thèses en économie, finance, mathématique, médecine et autres domaines ? En quoi serait-il injurieux de dire les faits ? Au contraire, la transparence permet seule de remonter aux causes et de tenter des solutions. L’attitude du déni ne sert que l’immobilisme et le fantasme du Complot.
Progressisme de substitution, paravent commode à l’immobilisme du système social, l’idéologie antiraciste remplace la lutte des classes et fait religion pour les laïcs. Le « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » a été engendré la mondialisation et par l’essor des techniques, aboutissant à cette création médiatique : le consommateur aliéné. Nul ne peut plus blasphémer sans être aussitôt moralement condamné par la bonne conscience « de gauche » – forcément de gauche – confite dans le contentement de soi.
Les prolétaires sont d’autant plus racistes que leur privilège de Blancs est bien la seule chose qui les distingue de leurs collègues de couleur, tout aussi exploités et méprisés. Les homophobes sont d’autant plus attachés à leurs privilèges d’hétérosexuels que c’est bien un des seuls dont ils peuvent encore jouir en ces temps de féminisme. Comprendre cela, c’est saisir que « le racisme » n’est pas une conviction profonde mais une réaction d’humilié qui cherche à se distinguer socialement. C’est donc pouvoir agir sur les causes : le chômage, le déclassement, les ghettos périurbains, l’inadaptation scolaire… Tout ce à quoi échappent les bobos confortablement installés dans les CDI par copinage, le statut social par mariage, les centres-villes, les écoles privées. La gauche, par son « indignation » moraliste, se garde bien de concrètement agir. Surveiller et punir est plus paresseux que de se retrousser les manches sur l’emploi, la formation, le logement, les programmes scolaires et la formation des maîtres.
Que veut-on ? L’assimilation au nom du nivellement de toutes les différences ? Ou la juxtaposition en bonne intelligence de communautés fermées sur elles-mêmes ? Ni l’un ni l’autre, me direz-vous peut-être ?…
Donc acceptons les différences, acceptons que l’on parle des différences, acceptons les règles de la bonne intelligence – dont la première consiste à ne pas choquer les autres en public, en agitant des bananes ou en arborant un niqab.












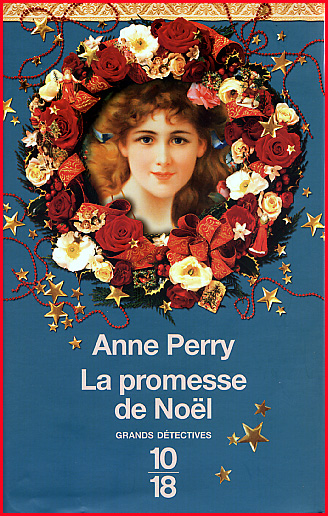


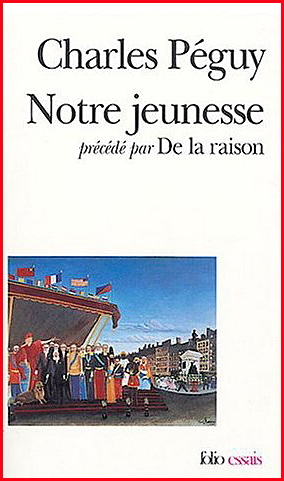


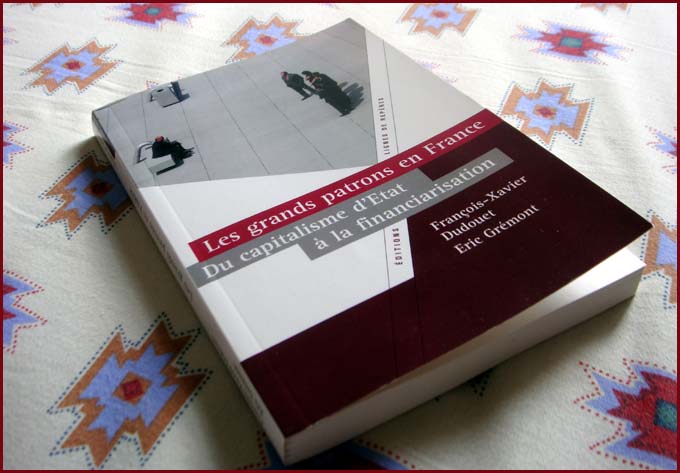
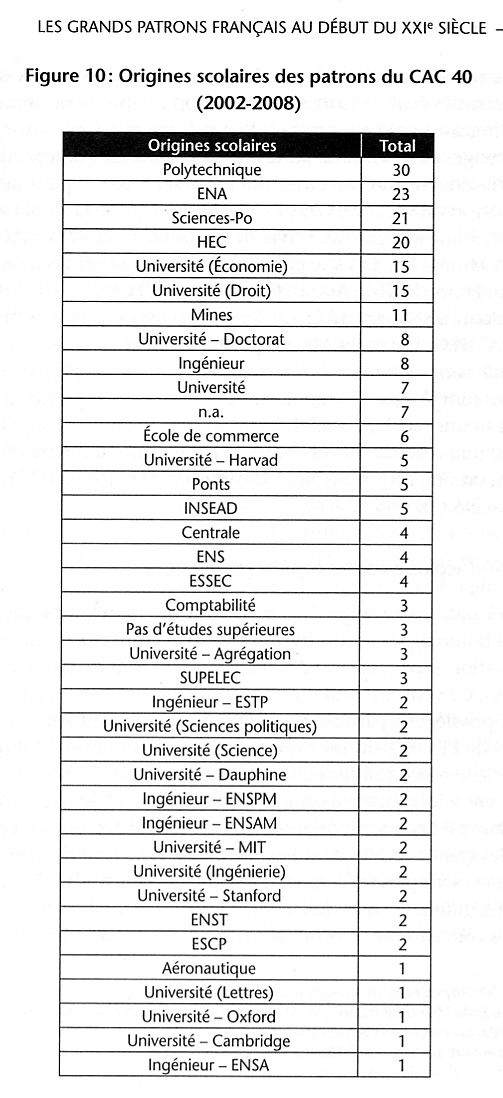
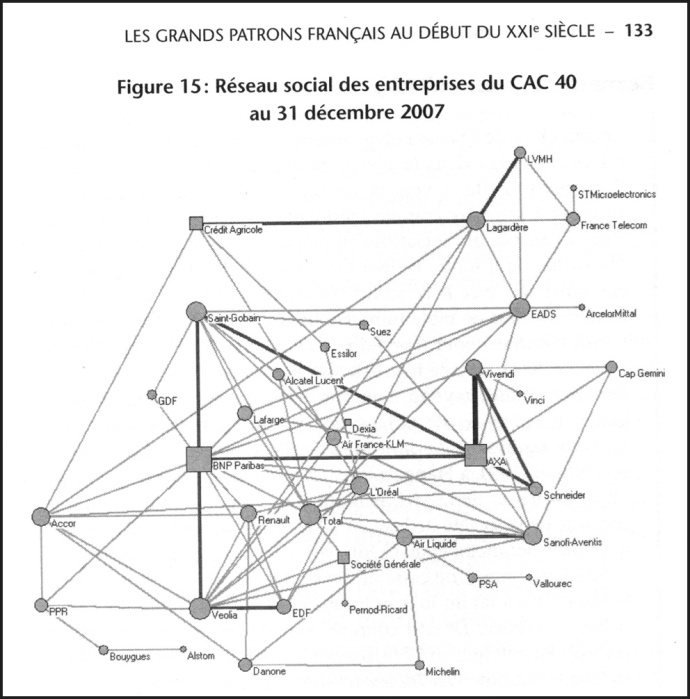
Commentaires récents