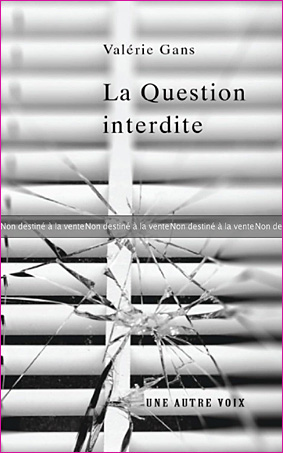
Un roman puissant, d’actualité, sur la vérité. Écrit au lance-pierre, avec des billes lancées à grande vitesse qui frappent juste et lourdement : sur l’effet de meute, l’anonymat lyncheur des réseaux sociaux, la dérive hystérique d’un certain féminisme. La « question interdite » ne devrait pas l’être : « et si ce n’était pas vrai ? »
Pas vrai qu’un homme de 40 ans ait abusé d’une adolescente de 13 ans (et demi) ? Pas vrai que la fille l’ait ouvertement accusé ? Pas vrai que la mère abusive ait « cru » le « non-dit » ? Pas vrai que l’inspectrice de la police (on dit plutôt lieutenant aujourd’hui, je crois) ait capté la vérité dans les propos décousus et incohérents de l’une et de l’autre ?
Une histoire simple, comme dirait Sautet au nom prédestiné : un vidéaste connu monte un projet sur la féminité. Adam, au nom d’homme premier, est soucieux du droit des femmes et milite depuis toujours contre le machisme, ayant montré dans ses vidéos les horreurs de la soumission dans les pays autour de la Méditerranée et en France. Il s’entiche – professionnellement – en 2017 d’une gourde un peu grosse rencontrée dans un café où elle s’essaie à devenir adulte en ingurgitant le breuvage amer qu’elle n’aime pas. Il voit en elle son potentiel, le développement de ses qualités physiques et mentales. Il lui propose de tourner d’elle des vidéos spontanées, qu’il montera avec des vidéos de femmes plus âgées, afin d’exposer l’épanouissement d’une adolescente à la féminité. En tout bien tout honneur, évidemment, avec autorisation de sa mère et contrat dûment signé. Lui est marié à Pauline, une psy qui enchaîne les gardes pour obtenir un poste.
La mère, Ukrainienne mariée à un Iranien décédé, ne vit plus sa vie de femme depuis le décès de son mari cinq ans auparavant ; elle se projette sur sa fille et fantasme. Elle la pousse dans le studio, sinon dans les bras du bel homme connu. Shirin la gamine se révèle ; elle devient femme, se libère de ses complexes face aux regards des autres, améliore ses notes, devient populaire. Les autres filles l’envient, les garçons de son âge sont un peu jaloux et voudraient en savoir plus sur les trucs qui se passent.
Mais il ne se passe rien.
Jusqu’au jour où Shirin, désormais 14 ans, rentre en larmes et claque la porte de sa chambre. Sa mère, biberonnée à l’environnement féministe, aux soupçons immédiats sur le sexe pédocriminel, à la différence d’âge qui ne s’admet plus, se fait un cinéma : sa fille vient d’être violée et, même si elle n’a rien dit, c’est normal, elle est « sidérée » – mot de la mode qui plaque un concept qui n’explique rien. Elle la convainc d’aller « porter plainte », comme la mode le veut, pour que le (présumé) coupable soit « puni », autrement dit retiré de la société pour trente ans, comme s’il avait tué. La policière qui reçoit mère et fille entend surtout la mère, la fille est bouleversée, elle borborygme, elle n’avoue rien. Normal, pense la pandore formatée par l’époque, elle est « sous emprise » – mot de la mode qui plaque un concept qui n’explique rien.
Le présumé innocent est convoqué, interrogé, soupçonné. Il nie évidemment qu’il se soit passé quoi que ce soit, mais la fille ne parle pas. Il est donc coupable. Aux yeux de la police, aux yeux de l’opinion, aux yeux de son avocat, un soi-disant « ami » qui ne le croit pas puisque personne n’y croit. Les réseaux sociaux se déchaînent, chacun dans sa bulle confortable : les hommes prêts à juger les autres pour les turpitudes qu’ils auraient bien voulu avoir ; les femmes (qui n’ont que ça à foutre, faute de mecs à leur convenance) dans l’hystérie anti-mâles, revanchardes des siècles de « domination » – mot de la mode qui plaque un concept qui n’explique rien. Adam est boycotté par ses clients, jeté de sa galerie où il expose ses vidéos, une pétasse qui avait 15 ans et lui 19 vingt ans auparavant l’accuse (gratuitement) de « viol » – mot de la mode qui plaque un concept juridique qui n’explique rien des faits réels. Il entre en mort sociale. Pauline, sa femme, demande le divorce tant la pression des autres et de ses collègues lui font honte de rester avec un tel criminel (pas encore jugé, la justice est très très lente en ces matières). Désespéré, il se suicide.
Fin de l’histoire ?
Non. Shirin, vingt ans plus tard, a du remord. Elle sait ce qui s’est passé, c’est-à-dire rien, et elle voudrait réhabiliter Adam qui l’a révélée à elle-même contre les autres, sa mère possessive qui vivait ses fantasmes par procurations, ses petits copains boutonneux qui ne pensaient qu’à baiser sans aimer, ses copines jalouses et venimeuses qui ne songeaient qu’à se faire valoir aux dépens des autres. Tout le monde en prend pour son grade.
Nous sommes désormais en 2028 et la société a bien changé. Valérie Gans l’imagine sans peine comme un prolongement hystérisé des tendances actuelles, ce qui donne un chapitre savoureux (et inquiétant) d’anticipation. Plus aucune relation entre hommes et femmes sans le regard des autres, la « transparence » réelle des bureaux vitrés, des surveillances de tous contre tous. « Pour peu que Shirin s’offusque d’un compliment, d’un sourire, d’une invitation qu’elle jugerait déplacée, Stan se retrouverait condamné » p.116. « Un regard trop appuyé, s’il est surpris – voire photographié et instagramé – par quelqu’un de l’autre côté de la vitre peut entraîner sa perte » p.117. Admirable société où l’homme est un loup pour la femme et réciproquement. « Dans ce monde régi par la peur de se faire accuser de harcèlement, les hommes déjà pas très courageux avant se sont repliés sur eux-mêmes. Célibataires malgré eux, quand ils n’ont pas tout simplement viré gays, ils sortent entre eux, vivent entre eux… simplement parce qu’ils n’osent plus draguer. Triste » p.116. Mais vrai, déjà aujourd’hui.
Shirin, qui vit avec son amie Lalla sans être lesbienne, faute de mec à accrocher, décide de rétablir la vérité contre sa mère, contre la police qui n’a pas été jusqu’au bout, contre la société qui a hystérisé la cause sans chercher plus loin que « le symbole » – mot de la mode qui plaque un concept qui n’explique rien. Elle poste donc un rectificatif sur l’ex-fesses-book des étudiants d’Harvard, devenu vitrine respectable des rombières de la cinquantaine ménopausées en quête de CAD (causes à défendre) : « Et si ce n’était pas vrai ? »
Mais raconter qu’on ne s’est pas fait violer – ça n’intéresse personne ! Pour son équilibre mental, Shirin veut « donner sa version des faits plutôt que, ce qu’il y a vingt ans, on lui a fait avouer » p.120. Elle déclenche une riposte… « atomique ». Les réseaux sociaux se déchaînent contre l’ex-violée qui refuse son statut symbolique (et socialement confortable) de « victime » – mot de la mode qui n’explique rien. La désormais « bonne » société des vagins éveillés (woke) ne veut pas entendre parler de la vérité car « la vérité » n’est pas le réel mais ce qu’elle croit et désigne comme telle. Comme des Trump en jupons (violeur condamné récemment pour avoir payé une actrice du porno afin qu’elle la ferme), les hystériques considèrent que la vérité est relative et que la leur est la bonne : il t’a regardé, il t’a donc violée. « Victime, on te croit », braille le slogan des bornées.
Shirin ne va pas s’en sortir car recommence – à l’envers – le même processus des réseaux, des accusations, de l’opprobre et de l’agression physique, jusqu’à la mort sociale. Et le suicide de Shirin, qui reproduit celui d’Adam. Sauf qu’elle est sauvée in extremis par elle-même sans le savoir, qui téléphone à sa mère pour qu’elle vienne la sauver – et réparer le mal qu’elle a fait, en toute bonne conscience. Un séjour en hôpital psychiatrique lui permettra de rencontrer une psy qui la fera révéler « la » vérité (la seule valable, l’unique qui rend compte des faits réels) et ainsi se préserver de « la honte » et de la horde. Je ne vous raconte pas ces faits réels, ils sont le sel de cette histoire d’imbéciles attisés par les mauvaises mœurs de l’impunité en réseau. La foule est bête, la foule féministe est vengeresse, la foule en réseaux fait justice elle-même en aveugle.
De quoi se poser des questions, si possibles les bonnes questions, avant qu’il ne soit trop tard et que les accusations gratuites n’aboutissent à des meurtres en série. Car, quitte à prendre trente ans de tôle, autant se venger réellement des accusatrices sans fondement !
Il faut noter pour l’ambiance d’époque – la nôtre – que le manuscrit de cette autrice ayant été refusé par les maisons d’éditions (avec le courage reconnu qu’on leur connaît!), bien qu’elles aient déjà publié d’elle une vingtaine de romans, Valérie Gans a créé sa propre maison pour contrer la Cancel « culture » : Une autre voix. Celle de la liberté de penser, de dire et d’écrire. Valérie Gans n’est pas n’importe qui : maîtrise de finance et d’économie de Paris-Dauphine en 1987, elle a travaillé dix ans dans la publicité et chronique depuis 2004 des livres pour Madame Figaro. Ce qu’elle dit doit nous interpeller. Son roman se lit d’une traite, bien qu’elle abuse des retours à la ligne.
Valérie Gans, La question interdite, 2023, éditions Une autre voix, 208 pages, €31,00, e-book €12,50 (mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com
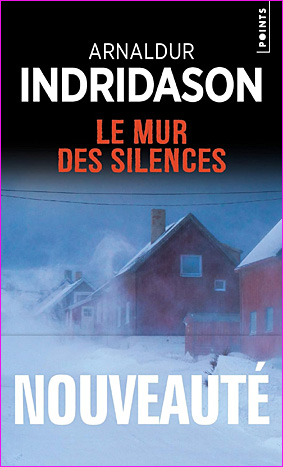


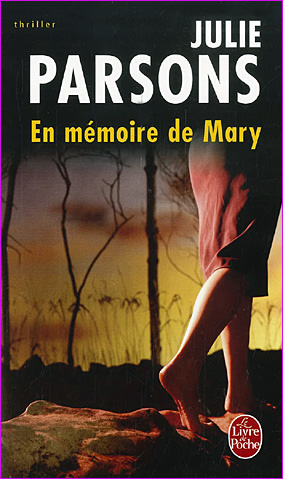










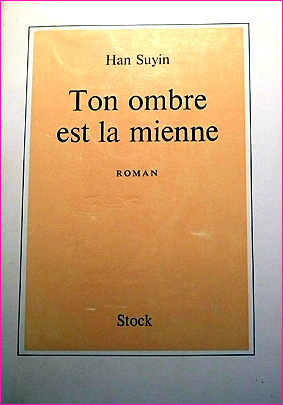
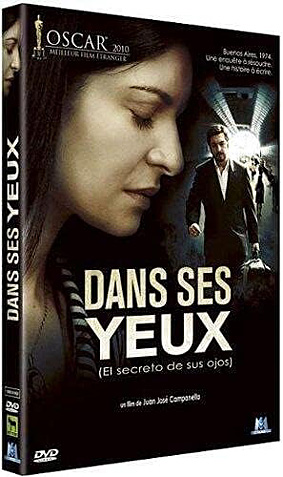









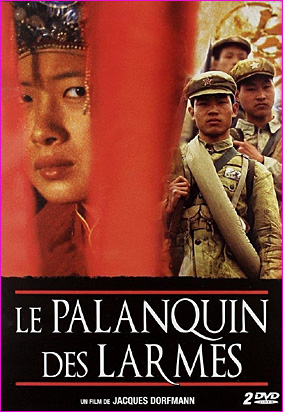
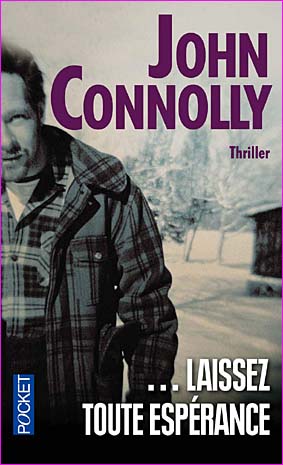
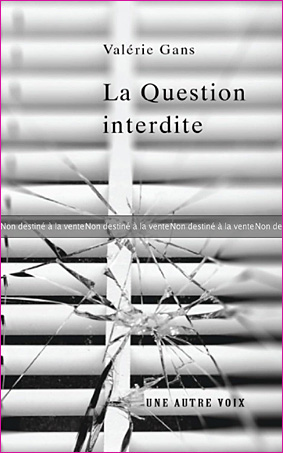
















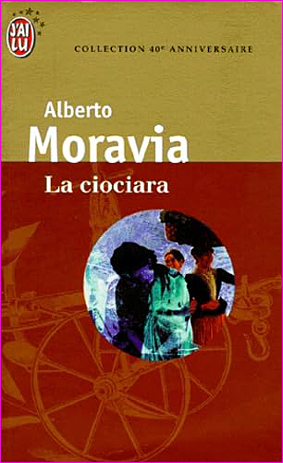

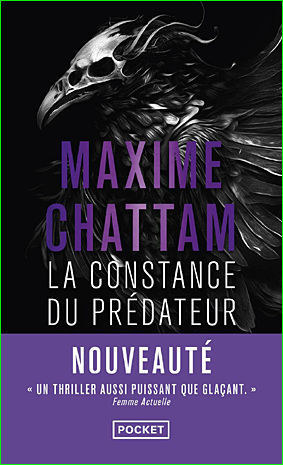

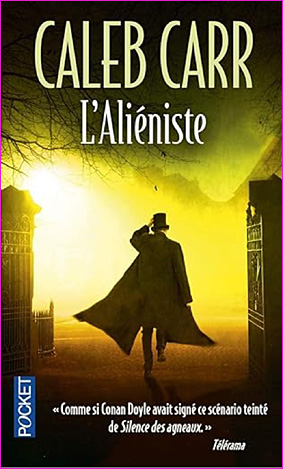
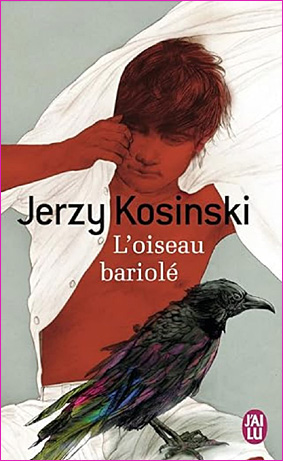
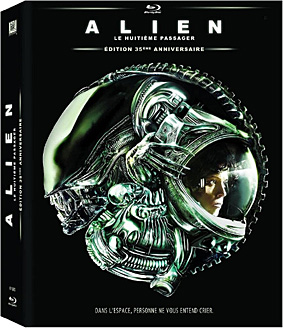










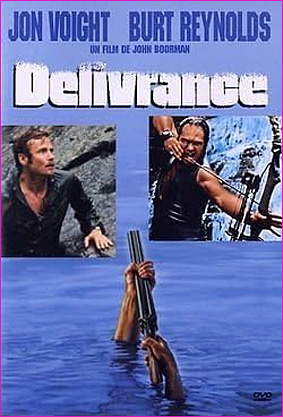























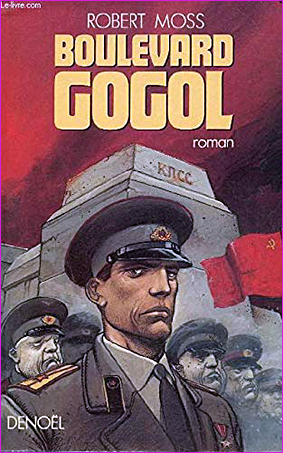
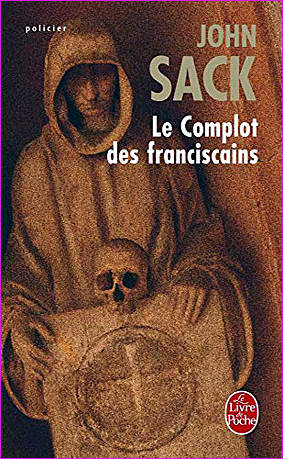

Commentaires récents