
Un livre étrange, proliférant, récit qui est roman, fausse confession qui est vérité – en bref, la quintessence du Juif qu’est l’auteur, vue par l’auteur. Il y a trop de pages, trop de délires, un bon tiers aurait pu être supprimé. Mais chaque face du personnage expose ses vues jusqu’au bout, en miroir des autres. L’origine en est le double : Philip Roth, aux États-Unis, apprend d’un de ses correspondants à Jérusalem qu’un certain Philip Roth promeut dans la presse une théorie nouvelle, le « diasporisme », et qu’il a rencontré Lech Walesa.
A Jérusalem, où il se rend en 1988 pour interviewer un auteur, se tient le procès de John Demjanjuk, un Ukrainien suspecté d’être Ivan le Terrible, bourreau de Treblinka. Philip Roth s’y intéresse et veut assister au procès. Il s’étonne que le jeune fils de Demjanjuk ne soit pas protégé, à la merci d’un survivant de l’Holocauste qui voudrait se venger du père en torturant son enfant – est-ce cela la justice ? Il s’étonne de constater que les témoignages à charge sont inconsistants, plus dans la volonté de croire que dans l’établissement des faits. Le vrai bourreau de Treblinka, celui qui enfournait les Juifs nus pour les gazer avant de les faire brûler en plein air, les femmes et les enfants dessous pour mieux attiser le brasier, est mort en 1945. Mais les survivants jurent que celui qu’ils ont devant eux est le vrai. Même si c’est faux (Demjanjuk sera acquitté en juillet 1993). Tout est ainsi masques et faux-semblants, la foi submerge les faits à chaque instant, chacun s’accrochant à sa propre vérité sans rien écouter de celles des autres.
Le faux Roth a créé les Antisémites Anonymes, dont sa pulpeuse maîtresse infirmière, polonaise catholique, est la première antisémite repentie. Le vrai Roth retrouve son ami palestinien George, chrétien égyptien étudiant avec lui à New York, qui roule pour l’OLP. Un vieux du Mossad, le sémillant handicapé Smilesburger (un faux nom) lui donne un chèque d’un million de dollars pour la cause palestinienne, à charge pour lui de débusquer à Athènes (la cité de la Raison) les Juifs de la diaspora favorables aux Palestiniens et qui financent l’OLP d’Arafat. Philip Roth sait ce qu’il ne doit surtout pas faire, mais ne peut s’empêcher de le faire – ce qui est irrationnel et profondément juif. Il se trouve embringué par les services secrets du Mossad sans le vouloir, mais en consentant. Tout est contradictions en lui, comme en chacun, mais peut-être plus en tout Juif. Pour le mythe, le Juif éternel de la culture est Shylock, le personnage du Marchand de Venise de Shakespeare, dont les premiers mots sont pour réclamer de l’argent : « trois mille ducats ». Dans cette fameuse « opération » des services secrets, il s’agit d’acheter la collaboration d’ennemis de l’État. Le Juif, Israël, restent des requins d’affaires, des usuriers du monde.
L’écrivain juif américain est « libéral », au sens yankee du terme, c’est-à-dire « de gauche et progressiste », selon la traduction politicienne française. Il est pour la paix, pour la justice, pour un État palestinien, en bref pour toutes ces sortes de choses. Le roman a été publié en 1993, alors qu’Israël est confronté à la première Intifada et que les accords d’Oslo se profilent. Ce n’est pas encore l’Israël réactionnaire et borné d’aujourd’hui, mais déjà l’autoritarisme colonial s’y fait jour. Si Roth est juif, il n’est pas sioniste. Son double, imposteur homonyme, propose une alya à l’envers, le retour des Juifs d’Israël dans les pays d’Europe d’où ils sont partis, maintenant que l’histoire a débarrassé les préjugés antisémites de leur culture. Pour le vrai Roth, « le Juif » n’est vraiment juif qu’assimilé dans un pays hôte. Ainsi lui est-il pleinement écrivain américain, bien que juif. Qu’a produit pour la culture mondiale l’État d’Israël, s’interroge Philip Roth ? Quasi rien : un seul prix Nobel de littérature en 1966, et quelques prix d’économie et de chimie.. dus aux Juifs américains.
Philip Roth s’interroge donc en tant que juif sur sa judéité. « Individuellement, chaque juif est lui aussi divisé. Existe-t-il au monde un personnage plus multiple ? Je ne veux pas dire divisé. Divisé, ce n’est rien. Même les goyim sont des êtres divisés. Mais dans chaque Juif, il y a une foule de Juifs. Le bon Juif, le mauvais Juif. Le nouveau Juif, le Juif de toujours. Celui qui aime les Juifs, celui qui hait les Juifs. L’ami du goy, l’ennemi du goy. Le Juif arrogant, le Juif blessé. Le Juif pieux, le Juif mécréant. Le Juif grossier, le Juif doux. Le Juif insolent, le Juif diplomate. Le Juif juif, le Juif désenjuivé. Dois-je continuer ? » Chacun est fragment et reflet. « Est-ce étonnant que le juif conteste toujours tout ? Il est la contestation incarnée ! » p.338.
Il s’interroge aussi sur Israël. « Ce que nous avons fait aux Palestiniens est mal. Nous les avons déplacés et opprimés. Nous les avons expulsés, battus, torturés et tués. Depuis son origine, l’État juif s’est employé à faire disparaître la présence palestinienne de la terre historique de Palestine et à exproprier un peuple indigène. Les Palestiniens ont été chassés, dispersés et asservis par les Juifs. Pour construire un État juif, nous avons trahi notre histoire – nous avons fait aux Palestiniens ce que les chrétiens nous ont fait : nous les avons systématiquement transformés en un Autre haï, les privant ainsi de leur statut d’êtres humains » p.355.
Le propos est dur, « antisémite » selon les critères de mauvaise foi qui prévalent aujourd’hui, où toute critique de Netanyahou, de ses ministres sectaires, de son gouvernement, de l’État d’Israël et de ses bombardements, est assimilée à une critique raciste contre les Juifs en tant qu’ethnie. Mais ce n’est pas Philip Roth qui parle, ou du moins pas entièrement parce que c’est bien lui l’écrit : c’est l’un de ses multiples doubles : le faux Roth qu’il appelle Pipik, « petit nombril » (mais gros zizi), Smilesburger le Juif fonctionnaire de sécurité, George Ziad le Palestinien, le cousin Apter (sauvé à 9 ans d’un camp de transit par un officier SS qui l’a vendu à un bordel d’hommes), l’écrivain israélien Aharon Appelfeld. Il est écrivain, donc invente des histoires, mêle réalité et fiction, délire sur chaque personnage contradictoire, qui tous sont lui, mais pas entièrement lui – lui étant la somme de tous, et plus encore. Chacun est lui et non lui. Il possède « cet instinct de l’imposture qui m’avait jusque-là permis de transformer mes contradictions en actes et de leur donner vie dans le seul domaine de la fiction » p.362.
Est-ce de la paranoïa due à ce médicament, l’Halcion, réputé pour ses effets secondaires, où « aucune réalité ne sépare l’improbable du certain » p.368 ? Est-ce la propension de « la malice juive » qui fait que le raconteur d’histoires brode et dédramatise les choses – « qui transforme tout en farce qui banalise et superficialise tout – y compris nos souffrances en tant que Juifs » p.396 ? C’est un roman créatif, audacieux – ce qu’il a prévu se réalise trente ans après – kafkaïen, à l’humour absurde, juif.

A lire aujourd’hui, qu’il vient de paraître en Pléiade, pour se laver l’esprit de toutes les contrevérités, manipulations et mauvaise foi des uns et des autres au sujet d’Israël, de la Palestine, et de l’antisémitisme.
Philip Roth, Opération Shylock – une confession, 1993, Folio 1997, 656 pages, €11,90
Philip Roth, Romans 1993-2007 : Opération Shylock, Le théâtre de Sabbath, Le complot contre l’Amérique, Exit le fantôme, Gallimard Pléiade, édition Philippe Jaworski, 2025, 1609 pages, €70,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)











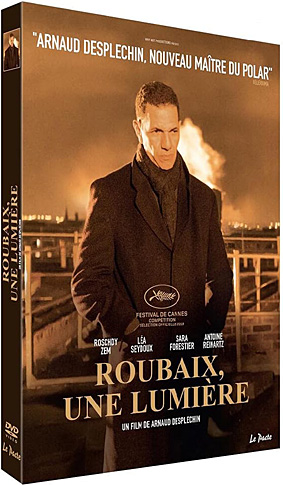



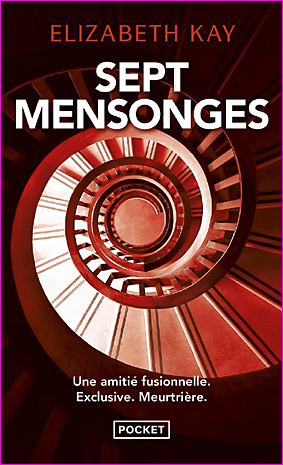

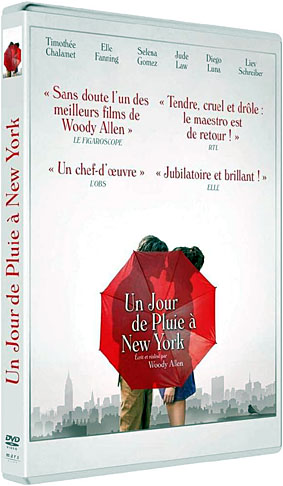












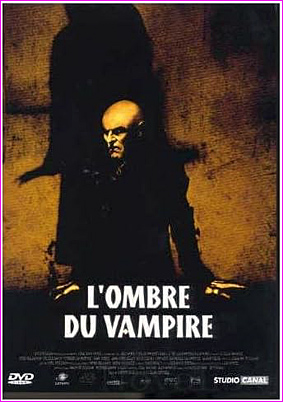








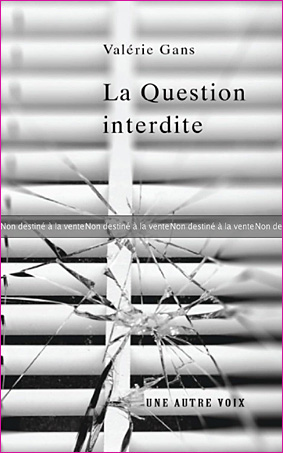


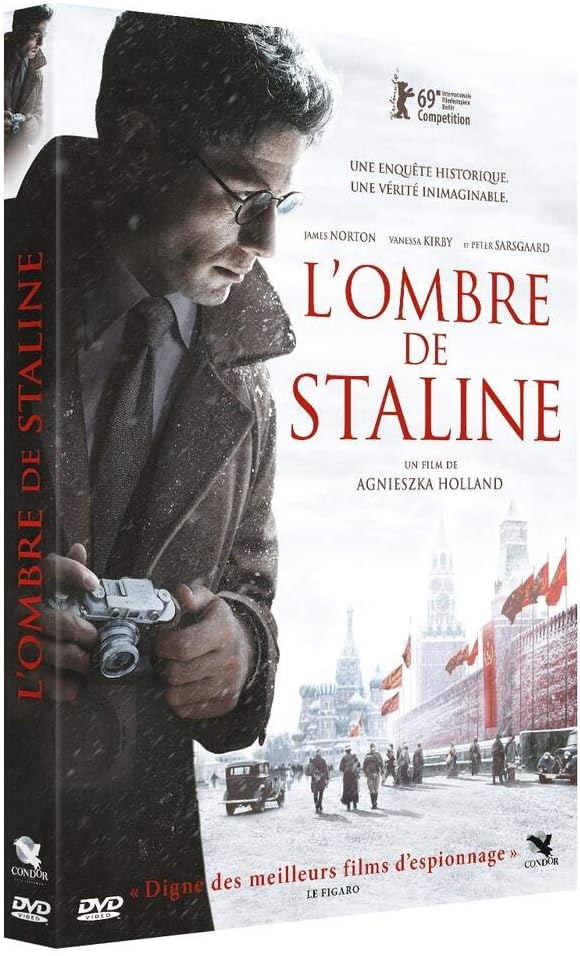
























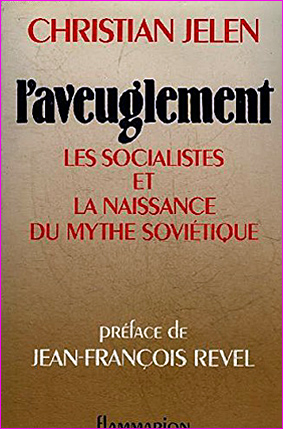

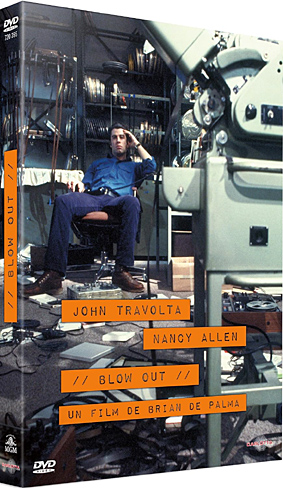








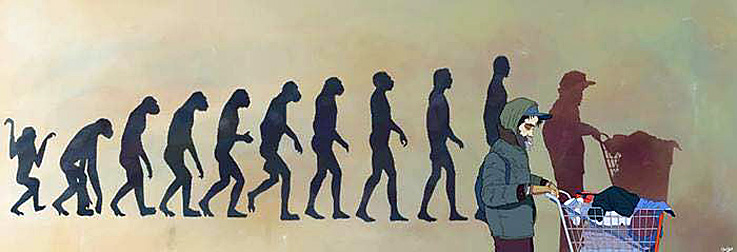




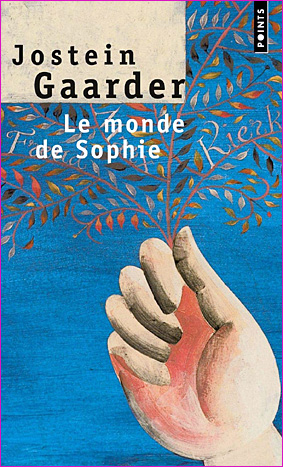
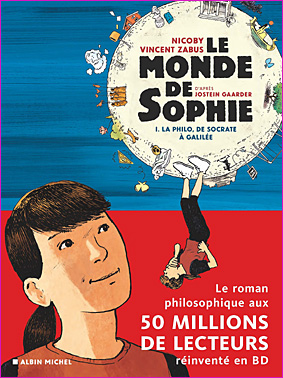













Commentaires récents