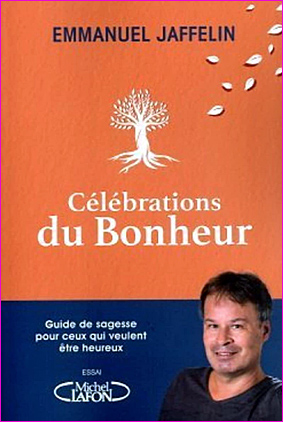
Un court essai philosophique sur le bonheur, écrit de manière très accessible avec nombre d’exemples pris dans l’actualité, la littérature, le cinéma. Trois parties ponctuent l’ouvrage : 1. Le malheur, 2. L’heur, 3. Le bonheur. L’heur est un terme qui veut dire « chance ». Il peut être mauvais (malheur) ou bon (bonheur). L’heur, du latin augurium (présage), est ce qui nous arrive, à nous de le considérer positivement ou négativement.
Car – et c’est là le message du livre – » l’intelligence consiste à anticiper les événements qui vont t’arriver, non à les ignorer. Dans le premier cas, ta tristesse est moindre puisque tu avais prévu l’événement ; dans le second cas, ta tristesse est renforcée par ta naïveté te faisant croire que cela aurait dû ne pas se produire et par ta mauvaise foi affirmant, pour mieux te mentir à toi-même, que ce qui t’arrive est une injustice. » Autrement dit, il ne sert à rien de se prendre la tête pour ce qui nous arrive, si l’on n’y peut rien. C’est au contraire s’enfoncer dans le malheur que d’adopter le statut (à la mode) de victime. Il s’agit plutôt de rester positif et de poursuivre sa vie en acceptant ce qui s’est passé comme un fait auquel on ne peut rien changer.
Vaste programme pour les mentalités effrayées, panurgiques et limitées de nos contemporains !
Le malheur vient de ne pas accepter le réel et de s’illusionner sur le « comme si » d’une Justice immanente. « Osons cette hypothèse : la manie de l’être humain post-moderne de se vivre comme un Ego n’est-elle pas responsable de son malheur ? » La réponse est OUI.
La faute en est, outre aux personnalités affaiblies par l’éducation indigente, la mode inepte et les soucis quotidiens, aux faux espoirs fournis par la science et par la technique depuis le XIXe siècle. » La science mit l’humanité en confiance : elle produisit régulièrement de nouvelles découvertes et développa des applications techniques modifiant le quotidien de l’être humain ». D’où l’utopie du transhumanisme et la cryogénisation des corps au cas où. Mais toute découverte a son revers car nous ne serons JAMAIS dans un monde parfait, ce Paradis des mythes du Livre. L’énergie nucléaire a fourni de l’électricité plutôt propre et pas chère – mais aussi des bombes, des accidents et des déchets. La médecine a accru l’espérance de vie – mais aussi les années de vie dépendante, indignes et souffrantes (d’autant que le droit de mourir volontairement n’est toujours pas accordé en France aux personnes conscientes qui en manifestent la volonté, sur l’inertie des interdits catholiques !). Notons que l’auteur cède à cette confusion courante entre « espérance de vie » (à la naissance) et durée de vie moyenne ! Contrairement au mythe, les hommes préhistoriques ne mouraient guère plus jeunes qu’il y a un siècle ! Seuls les progrès de la médecine depuis quelques décennies ont amélioré la fin de vie et fait reculer les décès des bébés ou des femmes en couche.
« Ce qui est bizarre chez les citoyens actuels ne vient pas du progrès de leur espérance de vie : il provient de leur angoisse de mourir ». Plus la science et la médecine reculent l’âge probable du décès, plus l’angoisse croît, ce qui ne fait pas le bonheur des gens. D’où probablement cette crispation sur « l’âge de la retraite » que le gouvernement voudrait (rationnellement) augmenter, à l’image des pays voisins, mais que les salariés refusent (irrationnellement), par crainte de ne pouvoir « en profiter ». Cette « angoisse de la mort est bien plus forte que lorsque les religions régnaient et nourrissaient les âmes », note avec raison l’auteur. Comme s’il fallait « croire » pour mieux vivre, en méthode Coué pour l’élan vital. Après tout, il existe bien un effet placebo des l’homéopathie et des « miracles » de Lourdes…
Mais les humains (des trois sexes +) sont peu armés pour la logique. « Lorsque tu fondes la mort de ton enfant ou de ton conjoint sur la maladie, tu cherches une cause à la mort, voire un responsable ; tu refuses au fond d’être toi-même res-ponsable, c’est-à-dire capable de répondre de la mort de ce proche. Attention : être responsable ne veut nullement dire « coupable ». La responsabilité signifie ici que tu comprends et acceptes les événements qui arrivent parce que tu les as anticipés. Tu réponds donc des événements avant qu’ils arrivent et, lorsqu’ils arrivent, tu les accueilles. « Trouver une cause, un coupable, mandater un bouc émissaire de tous les péchés, est un réflexe atavique – mais inutile et vain. Condamner un « méchant » ne fera pas revenir l’assassiné, ni accuser « le gouvernement » de ne pas vacciner, puis de trop vacciner, puis d’obliger à la vaccination lors d’une pandémie sur laquelle personne ne sait grand-chose. C’est se défouler pour se faire plaisir, et se dédouaner de ses propres responsabilités.
« Le mal est un « possible » et non une exception. En considérant cet acte criminel comme une exception, la victime se trompe logiquement : elle prend ce qui arrive comme une anomalie. Or le vol, le viol et le crime sont aussi normaux que l’accident, la maladie et la mort de vieillesse. En les déclarant normaux, ces événements ne sont nullement valorisés : ils sont seulement considérés comme des réalités que nous devons anticiper. » La norme veut dire que cela arrive souvent. Le malheur est culturel : notre société moderne refuse la mort, l’accident, le viol et les ennuis, tout simplement parce que la mathématisation du monde des savants et des technocrates lui a assuré que tout était calculable, donc prévisible, donc évitable. Mais le malheur survient et « la douleur morale n’est pas une souffrance dans la mesure où elle ne provient pas du corps, mais de l’âme : elle est l’effet de notre imagination qui considère qu’un événement aurait dû ne pas arriver. »
Dès lors, écrit l’auteur sagement, « pour essayer de ramener les citoyens dans la réalité, il convient de distinguer le méchant et le malheur. Le premier pratique le mal et finit, la plupart du temps, beaucoup plus mal qu’il a commencé. Le second, en revanche, n’est pas une réalité : il est une interprétation de ce qui nous arrive et dont nous attribuons la responsabilité à un méchant ou à la nature. »
Si le livre n’en parle pas (pour ne pas fâcher les élèves dans l’Education nationale et les classes du prof ?), le terrorisme est ici clairement visé. Il profite de l’interprétation que les Occidentaux font de ce qui leur arrive, il veut les sidérer, les angoisser – en bref les terroriser pour mieux imposer sa loi arbitraire et étroitement religieuse. Mais, « si le méchant réalise que nous sommes au-dessus de ce qu’il a fait, il ne comprendra bien sûr pas notre force, mais il finira par constater sa faiblesse face à l’indifférence que nous éprouvons pour lui. » Survivre et poursuivre dans nos pratiques, nos coutumes et nos valeurs est le meilleur antidote au terrorisme (sans parler bien-sûr de la traque policière et des représailles militaires si besoin est).
Le sage accompagne la réalité avec intelligence. « Inversement, celui qui est rivé à ses désirs ne voit rien arriver et ignore, au fond, qui il est : il n’est ni un moi, ni un ça, ni un surmoi. Il est un non-sage. » Autrement dit étourdi ou crétin ; c’est-à-dire un fétu de paille au vent, qui se laisse ballotter par la mode, les dominants qui passent et les circonstances qui viennent. Donc un con – un connard ou une connasse pour suivre la pente genrée de l’auteur.
Contrairement aux croyances les mieux ancrées, ni l’amour, ni l’argent, ni la santé ne font le bonheur. L’amour est un mot-valise qui comprend le désir, l’affection, la tendresse, la charité ; seul le don permet le bonheur, mais ni l’envie, ni la jalousie, ni la possession, ni le fusionnel. Combien se sont suicidés par amour déçu ? L’argent révèle la nature humaine, cupidité et égoïsme – au cœur de sa famille, de son conjoint et de ses amis. « La générosité par l’argent n’a pas d’odeur et ne sent pas l’amour. » Combien se sont suicidés parce que la richesse éloigne des gens et ne « paye » pas l’amour ? « Pourquoi les riches ne sont pas mécaniquement heureux et les pauvres mécaniquement malheureux ? La réponse est bien sûr liée au bonheur qui découle de l’esprit, d’un équilibre intérieur de la personnalité, autrement dit d’une force de l’âme. Dès lors, si un riche est heureux, il doit son bonheur à sa richesse spirituelle, non à sa richesse matérielle. «
Les apparences ne sont pas la réalité, pas plus que l’habit ne fait le moine. « Ce que tu prenais pour des biens – gloire, richesse et santé – ne sont que des préférables et qu’il est nécessaire que tu t’intéresses à la liberté si tu veux sortir de l’indifférence pour atteindre le Bonheur. «
Le bonheur, justement. Citant le film Quatre mariages et un enterrement, l’auteur conclut : « Contrairement aux coups de foudre, le bonheur est à la fois capable de s’adapter au réel et de résister au temps et aux difficultés. « Le bonheur n’est pas un but mais une récompense de ses actes.
Le désir est une excitation, une tension qu’il faut résoudre en la déchargeant. Il n’est pas un état de bonheur mais une libération du désir pour retrouver, le calme, l’équilibre ». « Les buts raisonnables et sensés que tu atteins génèrent du bonheur là où les buts irrationnels et excités engendrent plaisirs ponctuels et conséquences négatives ». Baiser ne fait pas plus le bonheur que devenir riche.
Les stoïciens avaient avancé dans la voie de la sagesse, Montaigne les a repris, et de nos jours entre autres André Comte-Sponville et Clément Rosset. « Marc-Aurèle était empereur, Sénèque était sénateur et Epictète était esclave. Mais ce qui les rendait heureux, tenait moins à leur situation sociale qu’à leur sagesse. » Le stoïcisme, étudié jadis dans les classes, est aujourd’hui vulgarisé sous forme de bouddhisme à l’usage des bobos et bobotes dans les « stages » de méditation et de « développement personnel ». Ils apprennent, avec l’exotisme du storytelling marketing de la sauce mercantile yankee, ce qu’est le bonheur acheté en kit. Selon l’auteur, qui ne les cite pas, « il y a dans la liberté (stoïcienne) une capacité à anticiper les événements te permettant de les accueillir sans pour autant penser que tu en serais la cause. Lect-rice/eur, tu sculptes ta liberté en mettant en œuvre ton pouvoir d’accepter ce qui arrive. « A noter l’écriture inclusive adoptée sans raison par Emmanuel Jaffelin ; elle est très agaçante à l’usage, n’apporte absolument RIEN au propos et ne montre aucun respect pour le lecteur dont elle limite les sexes à deux seulement ! C’est une fausse galanterie qui gêne l’œil pour obéir à une passion passive – celle de la mode – et se soumettre à une colonisation – celle des Etats-Unis.
Chacun est déterminé par ses gènes, sa famille, son milieu, sa religion, son pays et sa race. Nul n’est libre, pas même le plus puissant ou le plus riche. Même Trump ou Poutine n’ont pas fait ce qu’ils ont voulu, pas plus qu’Hitler ou Mao. Mais il y a un domaine dans lequel le destin n’intervient pas : la pensée de chacun. Il s’agit de « positiver » ! Par exemple, à propos de la mort d’un proche : « tu t’ouvres à nouveau sur la réalité pour voir son immensité et son infinité afin de raisonner et te dire que la vie de la personne qui vient de mourir était un miracle puisque tu aurais pu ne jamais la connaître. »
Ni maître et possesseur de la nature, ni pure Volonté de réaliser l’Histoire, mais la fin de la démesure et de l’orgueil de Fils de Dieu. « La personne qui renonce à maîtriser le monde, accepte en revanche de se maîtriser elle-même, ce qui donne lieu à une sagesse. En suivant ce but – la sagesse, Sophia – le sage a pour récompense le bonheur » – avis à ceux qui ont la prétention de « changer le monde » au lieu de le connaître. En général, ils aboutissent à des catastrophes…
Au fond, « trois moyens nourrissent la sagesse : d’abord bannir l’espérance (qui fait souffrir) ; ensuite, ne pas regretter le passé ; enfin vivre ici et maintenant. » C’est tout simple ! Cela veut dire bannir les illusions, qu’elles soient sur l’avenir ou le passé, et même au présent. « La vertu ne consiste donc pas à suivre un idéal hors du monde ou une réalité transcendante : elle est cette vue exacte que la raison a de la nature et de nous-mêmes. » La nature n’est pas celle des écolos mais le cosmos lui-même et son ordre, dont les mathématiques les plus poussées ne nous donnent encore qu’une vague idée. Cette nature « est une réalité dont nous ne sommes pas les maîtres, mais dont nous pouvons anticiper les phénomènes, non pour la transformer comme le fait superficiellement la technoscience, mais pour forger notre âme. » Sagement dit.
Mais qui touchera peu de monde, même s’il le faudrait : « dans la civilisation de l’égo, de l’égoïsme, de l’égotisme et du tout-à-l’égo qui caractérise notre civilisation au XXIe siècle, il est difficile d’expliquer à une personne que son MOI est une fiction et une invention de sa culture ». Je corrigerais en « sous »-culture, tant l’emprise de la mode et des mœurs anglosaxonnes imbibent les mentalités et les comportements, allant jusqu’à singer ce qui n’a rien à voir avec notre propre culture : Halloween, le puritanisme exacerbé, la haine entre hommes et femmes, la grande prosternation envers les cultures « dominées » et toutes les imbécilités à l’œuvre dans les universités américaines.
Un petit livre intelligent et sans jargon qui fait penser et dit sur le bonheur plus que des bibliothèques entières. Il remet les pendules à l’heure sur les mots, leur définition et ce qu’est véritablement le bonheur – qui ne résulte que de la sagesse.
Emmanuel Jaffelin, Célébrations du bonheur, 2020, Michel Lafon 2021, 176 pages, €12.00 e-book Kindle €9.99
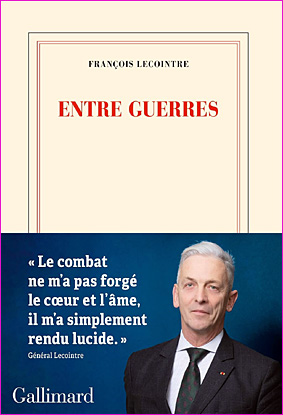

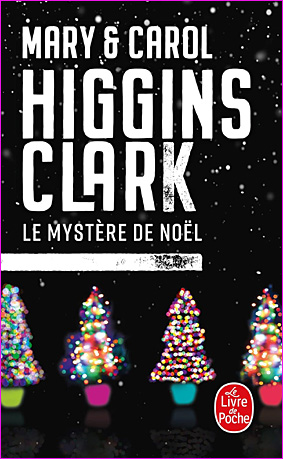
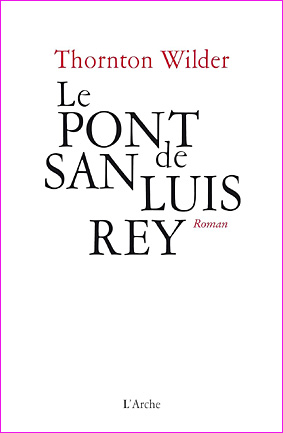

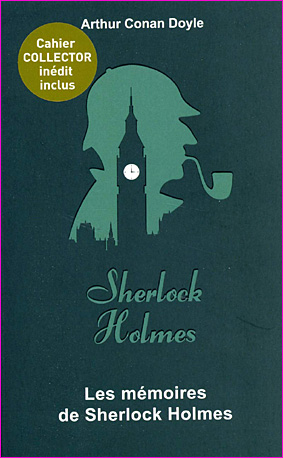




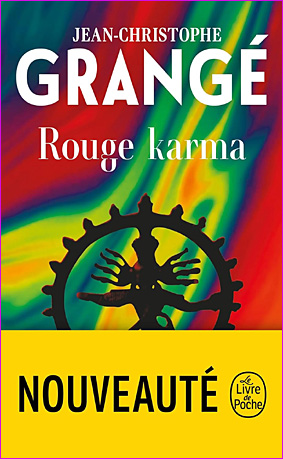





















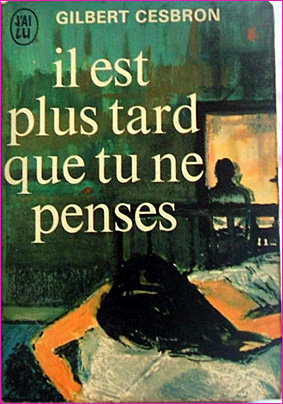



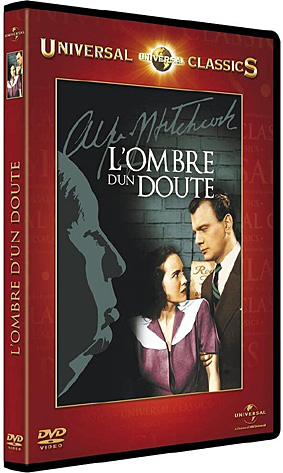
















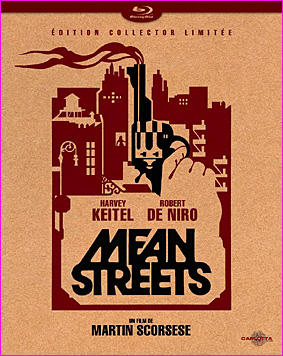













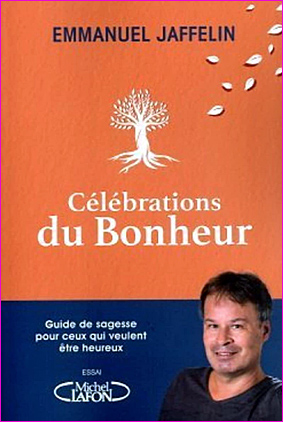












Commentaires récents