Suite du chapitre XIII du Livre III des Essais, l’ultime texte de Montaigne où il expose à la fin de sa vie sa vision du monde tirée « de l’expérience » (titre du chapitre). « Le jugement tient chez moi un siège magistral, au moins il s’en efforce soigneusement ; il laisse mes appétits aller leur train, et la haine et l’amitié, voire et celle que je me porte à moi-même, sans s’en altérer et corrompre. S’il ne peut réformer les autres parties selon soi, au moins ne se laisse-il pas déformer à elles : il fait son jeu à part. » Il faut savoir raison garder, même en ses instincts pulsionnels et ses passions affectives.
D’où le conseil d’Apollon, gravé au fronton de son temple de Delphes : Connais-toi. « L’avertissement à chacun de se connaître doit être d’un important effet, puisque ce dieu de science et de lumière le fit planter au front de son temple, comme comprenant tout ce qu’il avait à nous conseiller. Platon dit aussi que prudence n’est autre chose que l’exécution de cette ordonnance, et Socrate le vérifie par le menu en Xénophon. » Sauf que ce n’est pas si simple, avoue Montaigne. « Encore faut-il quelque degré d’intelligence à pouvoir remarquer qu’on ignore », et chacun se croit toujours assez intelligent pour le croire. Mais est-ce le cas en vérité ? « D’où naît cette platonique subtilité que, ni ceux qui savent n’ont à s’enquérir, d’autant qu’ils savent, ni ceux qui ne savent, d’autant que pour s’enquérir il faut savoir de quoi on s’enquiert. Ainsi en celle-ci de se connaître soi-même, ce que chacun se voit si résolu et satisfait, ce que chacun y pense être suffisamment entendu, signifie que chacun n’y entend rien du tout. » Montaigne prend plaisir à jargonner en logique pour dire une chose bien claire : que la seule chose que l’on doit savoir, c’est qu’on ne sait rien.

Montaigne se juge à cette aune. Il se sait faible, ce qui le rend modeste, obéissant aux croyances prescrites (sans forcément y croire), « à une constante froideur et modération d’opinions » (qui lui permet de juger sans passion) – et surtout « la haine à cette arrogance importune et querelleuse, se croyant et fiant tout à soi, ennemie capitale de discipline et de vérité. Ecoutez-les régenter : les premières sottises qu’ils mettent en avant, c’est au style qu’on établit les religions et les lois. » Autrement dit, ils assènent d’autorité comme des dieux, ce qui leur permet de se passer d’étudier et de savoir. Combien de « spécialistes » mettent-ils en avant leur autorité de pontes pour affirmer sans preuve, qui que l’hydroxychloroquine soigne le Covid, qui que la terre est plate, qui que l’humain n’est pour rien dans le réchauffement climatique, qui que les vaccins ne servent à rien, et ainsi de suite. « C’est par mon humaine expérience que j’accuse l’humanité d’ignorance », affirme Montaigne au soir de sa vie. « L’affirmation et l’opiniâtreté sont signes de bêtise », assène-t-il. Ce qui se vérifie tous les jours.
C’est, dit-il parce que « dès mon enfance, [je me suis] dressé à mirer ma vie dans celle d’autrui ». Il étudie tout, ce qu’il faut fuir, ce qu’il faut suivre. Ainsi a-t-il le jugement assez sûr sur ses amis, ce qui les étonne.
Quel bilan tire-t-il de cette masse d’essais écrits au fil du temps ? « Toute cette fricassée que je barbouille ici n’est qu’un registre des essais de ma vie, qui est, pour l’interne santé, exemplaire assez, à prendre l’instruction à contrepoil. Mais quant à la santé corporelle, personne ne peut fournir d’expérience plus utile que moi, qui la présente pure, nullement corrompue et altérée par art et par opination . L’expérience est proprement sur son fumier au sujet de la médecine, où la raison lui quitte toute la place. » Pour être en bonne santé, « même lit, même heures, même viandes, et même breuvage. Je n’y ajoute du tout rien, que la modération », dit Montaigne. Les habitudes, c’est le secret des centenaires, interrogés depuis par les journalistes. « Ma santé, c’est maintenir sans trouble mon état accoutumé », résume Montaigne.
Pour le reste, « il faut apprendre à souffrir ce qu’on ne peut éviter », dit encore le philosophe périgourdin. Imaginer, c’est périr avant même d’être touché. Et de s’étendre à pleines pages sur ses maladies. Avant de donner un conseil à la jeunesse : « Il n’est rien qu’on doive en recommander à la jeunesse que l’activité et la vigilance. Notre vie n’est que mouvement. » Lui dort beaucoup – huit ou neuf heures par nuit – n’est pas impétueux mais a de la résistance, il marche longtemps et n’apprécie rien, depuis l’enfance, qu’être à cheval. « Il n’est occupation plaisante comme la militaire, occupation noble en exécution (car la plus forte, généreuse et superbe de toutes les vertus est la vaillance), et noble en sa cause ; il n’est point d’utilité ni plus juste, ni plus universelle que la protection du repos et grandeur de son pays. La compagnie de tant d’hommes vous plaît, nobles, jeunes, actifs, la vue ordinaire de tant de spectacles tragiques, la liberté de cette conversation sans art, et une façon de vivre mâle et sans cérémonie, la variété de mille actions diverses, cette courageuse harmonie de la musique guerrière qui vous entretient et échauffe et les oreilles et l’âme, l’honneur de cet exercice, son âpreté même et sa difficulté… » N’en jetez plus. Montaigne aime son état de noble, donc guerrier au service, entouré de jeunesse et vivant simplement, tout dans l’action et l’observation de ce qui survient.
Après moult gloses sur les antiques et leurs prescriptions de vie saine, vient la phrase qui résume Montaigne en sa personne. « Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; voire et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. » Si l’on traduit en termes contemporains, nul doute qu’il ne faut vivre qu’au présent, sans lâcher son imagination ailleurs ni plus loin. C’est cela le bonheur, l’accord de soi et du monde, au temps présent. Carpe diem : cueille le jour présent. La vie, dit Montaigne : « il y a de l’art à la jouir : je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d’application que nous y prêtons. »
Quelques maximes, ciselées pour la fin, dans ce chapitre ultime des Essais :
« Pour moi donc, j’aime la vie et la cultive telle qu’il a plu à Dieu nous l’octroyer. »
« Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et juste. »
« C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. (…) Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. »
Et la toute dernière phrase : « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance. » Autrement dit vivre en humain, pleinement humain, est la beauté même : c’est accomplir pleinement notre destinée. Suit une dernière remarque sur la vieillesse, puis une citation d’Horace, poète romain épicurien et stoïcien, né en 65 avant, qui plaisait fort à Montaigne, qui résume tout : santé, facultés, vieillesse pas avilissante, écriture.
C’est ainsi que nous avons chroniqué l’intégralité des essais de Montaigne, depuis 2011.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
(Mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Montaigne sur ce blog


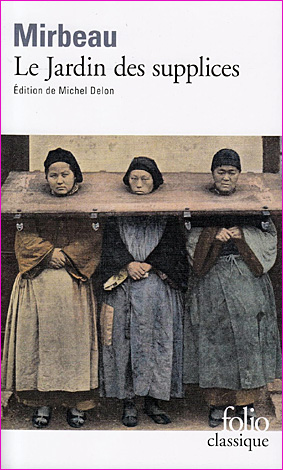

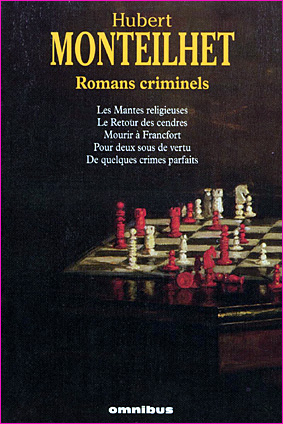





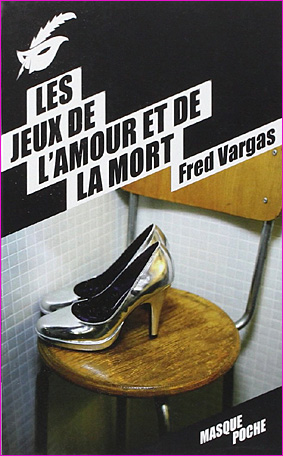
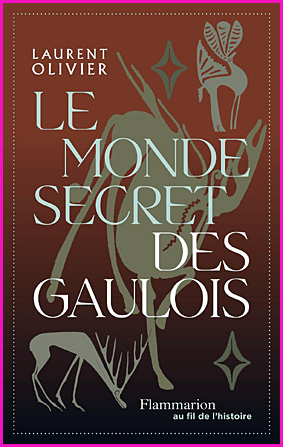


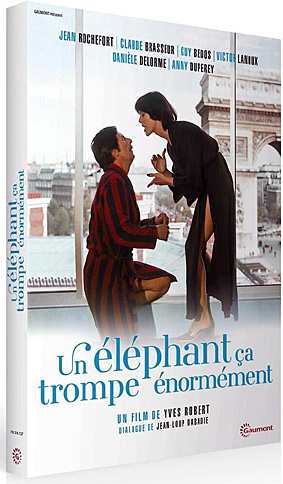








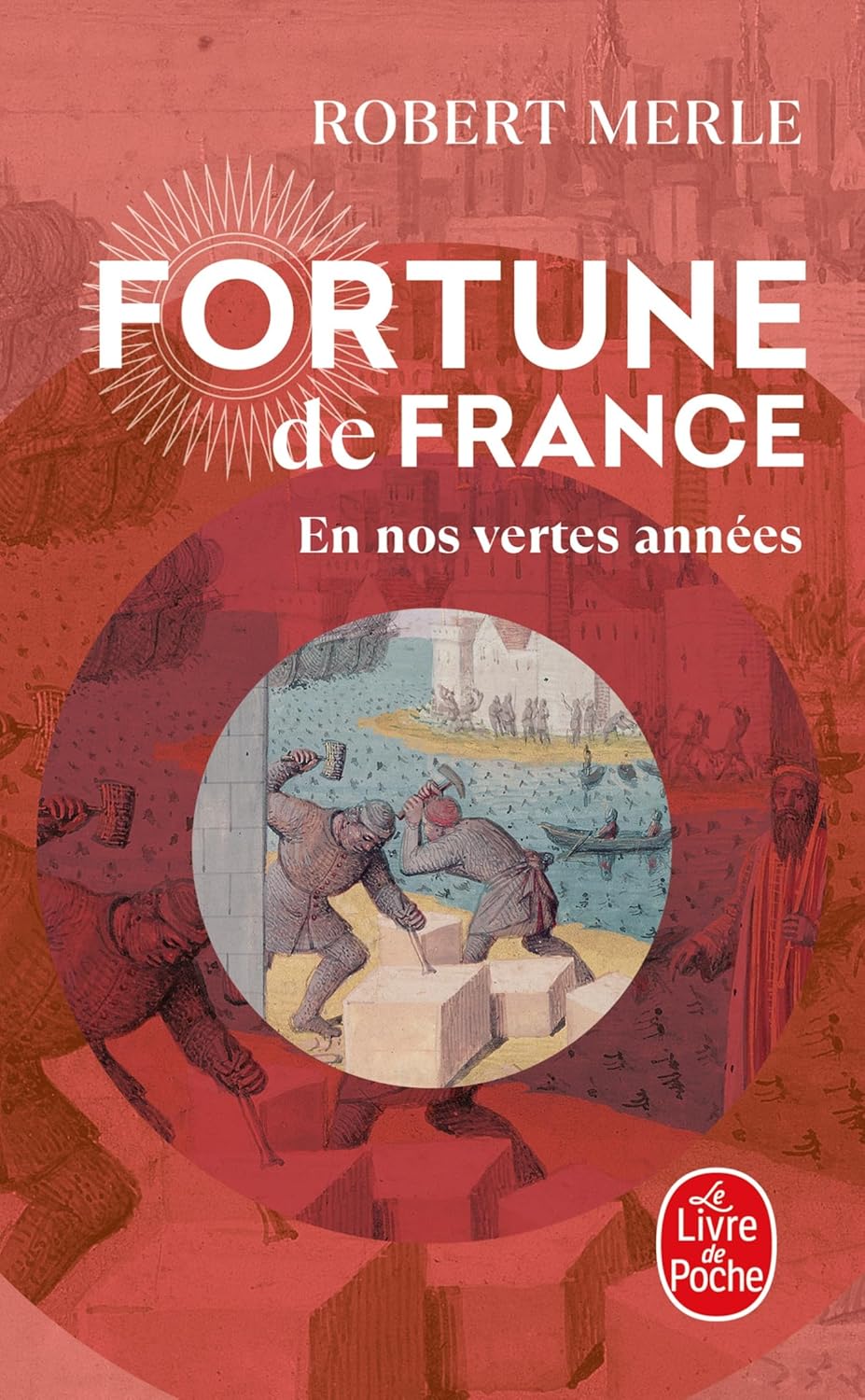
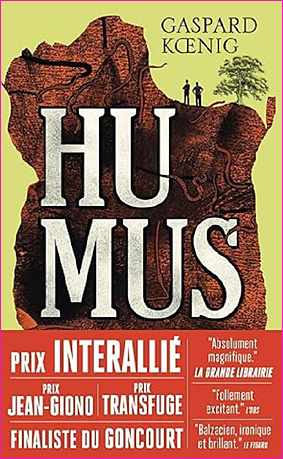
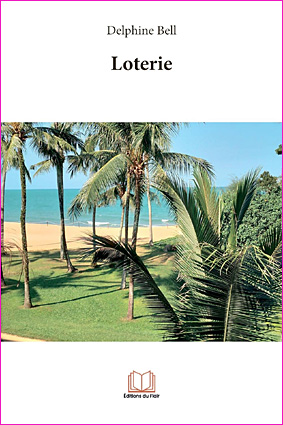

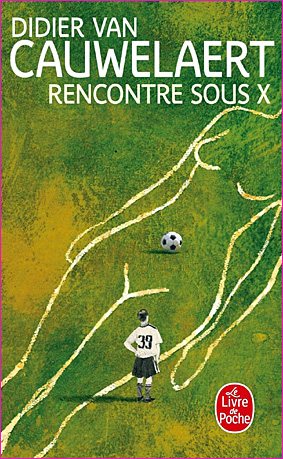

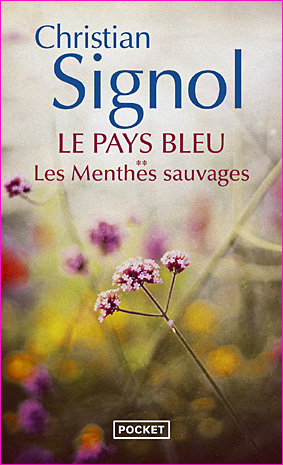
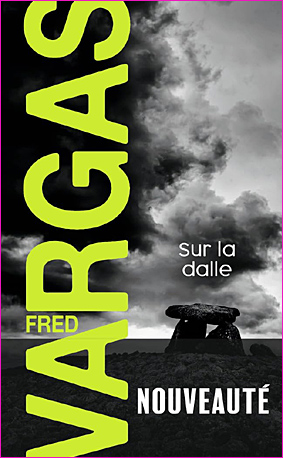
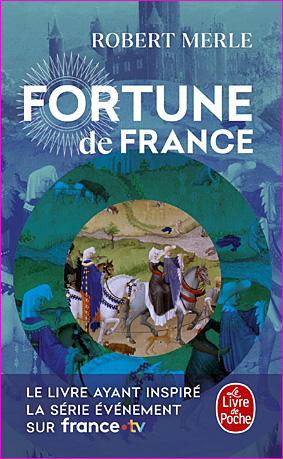







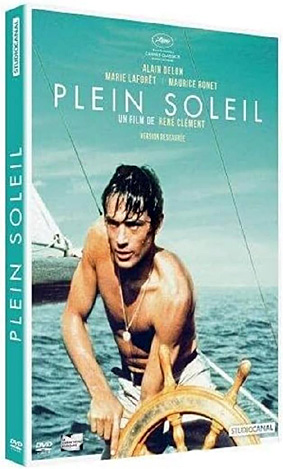















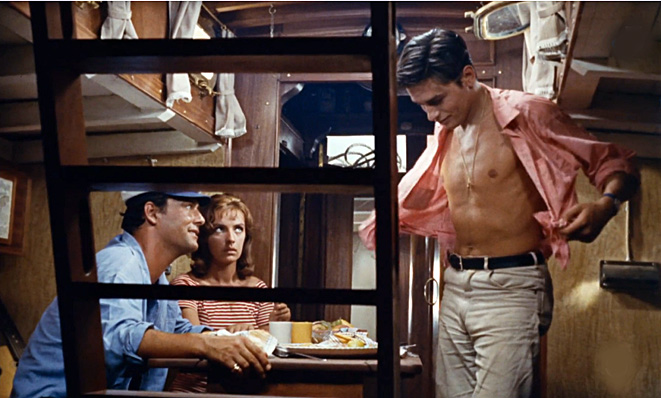

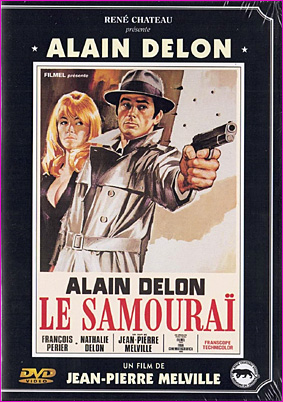










Commentaires récents