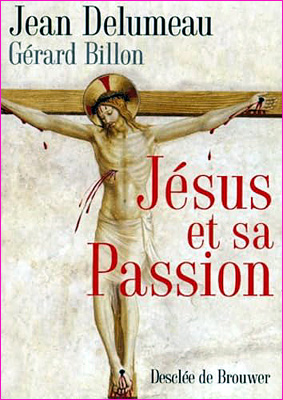
Jean Delumeau était historien breton et catholique, spécialiste des mentalités religieuses au Collège de France, membre de l’Institut ; il est décédé à Brest en 2020 à 96 ans. Le père Gérard Billon, bibliste, est à la tête de l’Alliance biblique française ; à 73 ans, il dirige le Service biblique catholique Évangile et Vie et la revue Cahiers Évangile. C’est dire si leur livre en commun est irrigué avant tout par l’érudition scientifique, la foi venant par surcroît.
Gérard Billon rappelle en première partie l’histoire de la Passion du Christ. L’évangile de Luc est le plus complet sur les circonstances de la Passion et de la mort de Jésus, mais les autres récits évangéliques de la Passion, ceux de Matthieu, Marc et Jean sont donnés en annexe.
Le prêtre historien note l’originalité du christianisme sur les autres religions : les Évangiles ne sont pas une transcription littérale de la Parole de Dieu mais des témoignages humains sujets à variations et à embellissements. « Nous avons entendu les quatre voix se mêler, se superposer parfois, se distinguer de temps à autre. Des accords sont apparus mais aussi des dissonances et des motifs singuliers. Il y a là une originalité qui distingue la Bible d’autres livres sacrés : il n’y a pas une voix unique que le lecteur serait tenté d’absolutiser. Si, pour la foi chrétienne, Jésus le Christ est Parole de Dieu, cette parole unique s’atteint à travers quatre récits particuliers » p.36. Une incitation à penser par soi-même plutôt qu’à se soumettre aveuglément à un Verbe.
La Passion est un « événement » qui fait sens symbolique pour les croyants chrétiens, tout comme l’Exode pour les Juifs. La mort humaine dans la souffrance laissera place à la Résurrection et à la joie de la vie éternelle, espérance de la foi. La Passion de Jésus a lieu à la Pâque, substitut de l’agneau ancien du sacrifice. « Scandale pour les Juifs, folie pour les païens », résume Paul p.42. Des sources externes évoquent la mise à mort de Jésus : Tacite, Flavius Josèphe, le Talmud. Les quatre évangiles canoniques donnent un ordre vraisemblable à la trame des événements et aux personnages attestés historiquement. Celui de Jean est le plus long et le plus précis, peut-être parce qu’il évoque « le disciple bien-aimé » du dernier repas : « il est couché sur la poitrine de Jésus » (Jean 13,21), rappelle Billon. « Cette proximité signifie plus qu’une simple présence physique. À l’instant où le seigneur transmet son testament, le disciple vit une communion profonde avec son maître. On le retrouve au pied de la croix (Jn 19), devant le tombeau vide (Jn 20), sur la mer de Tibériade (Jn 21), à tous les moments importants du mystère de Pâques » p.81. Il double Pierre comme un témoin spirituel, le Simon appelé par Jésus à bâtir son église. Mais on ne connaît pas le nom de ce disciple bien-aimé, que la tradition a nommé Jean – dont le nom signifie le plus jeune (Giovanni en italien, par exemple).
Pourquoi condamner et tuer Jésus ? Si les Romains s’en lavent les mains, ne voyant pas en Jésus un trublion politique, les prêtres juifs le condamnent pour blasphème, ce pourquoi sa mort est réclamée à l’occupant. « Par son action et ses propos, Jésus se manifeste comme autre prophète. (…) « Pour l’homme de Nazareth, la proximité du Royaume impliquait une urgence de l’amour, devant laquelle la Torah rituelle devait plier » (D. Margerat). Tout cela ne pouvait attirer à Jésus la bienveillance de personne, ni des chefs religieux, ni du peuple très attaché justement au temple, reflet de la société et promoteur des signes identitaires. On peut donc comprendre que le grand prêtre ait jugé plus prudent d’arrêter le dangereux prophète » p.60.
Jean Delumeau, dans une seconde partie, resitue la Passion dans l’histoire, notamment celle de l’art, miroir de la croyance des époques.
Dans l’art chrétien des premiers siècles, pas de souffrances du Christ. On évoque plutôt le bon Pasteur, le Messie baptisé, la Sagesse divine, le Pantocrator de l’énergie divine, le Sauveur de la Résurrection qui descend aux enfers. « La Passion ne prend tout son sens que dans la Résurrection » p.93. Cette façon de voir dure jusqu’au XIIe siècle.
C’est alors que saint François d’Assise donne au christianisme un ton doloriste orienté vers la pitié, ce qui culminera au XVIe siècle avec le Christ en croix de Mathias Grünewald « tordu de douleurs, la chevelure collée de sueur, les muscles et les veines saillantes » (cahier photo). De l’empathie de pitié au sadisme de la souffrance et au masochisme du pécheur, la voie était libre. On se complaît, dans les martyrologies de saints, à détailler les tortures variées des corps, à humilier l’humain, à le rendre pire qu’ordure. Les reclus se répandent en cilices et punitions. « Ces conduites dépassent l’ascétisme, analyse Jean Delumeau. A partir du moment où l’on entre dans une attitude d’expiation, la dérive guette. C’est pourquoi il est très important de conserver une sorte de bon sens en ce domaine. Je dirais : un bon sens chrétien » p.101.
Cette façon masochiste de vivre la foi durera jusqu’à Vatican II, deuxième concile œcuménique ouvert le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII jusqu’au 8 décembre 1965 sous Paul VI. Auparavant, « La Rédemption était présentée, dans les traités, les prêches ou les catéchismes, comme un rachat, devenu indispensable pour que la justice de Dieu le Père soit apaisée après la faute de nos premiers parents [Adam et Eve]. Et, comme la faute avait été énorme, il fallait aussi que le supplice et la mort fussent terribles » p.103. La réflexion théologique a été déviée en Occident vers la surévaluation du péché, ce qui ne fut pas le cas dans le monde orthodoxe orienté vers la joie du Sauveur. Ce dolorisme masochiste et sadique a détourné nombres de chrétiens occidentaux de la foi. Encore une déviance de saint Paul… « La doctrine, que l’on désigne par le terme technique de ‘justification’, vient de saint Paul à travers l’interprétation qu’en a donné saint Augustin et la systématisation qu’en a faite saint Anselme », résume Jean Delumeau p.105.
Ce christianisme tordu sur la Passion a engendré nombre de méfaits, physiques, psychologiques, sociaux, identitaires. « Le chemin de croix n’a de sens que parce qu’il conduit vers Pâques ; c’est-à-dire vers l’espérance. Au contraire, l’insistance sadique sur la souffrance est psychologiquement malsaine et, s’ajoutant à la doctrine de la ‘dette à payer’, provoque à chercher les responsables d’un crime aussi épouvantable. Ces responsables seront alors ou bien nous-mêmes (nous n’aurons jamais fini d’acquitter la dette de nos péchés) ou bien des individus monstrueux que l’on peut nommer, en l’occurrence, ici, les Juifs ou les païens (les Romains) » p.111. D’où les punitions des collèges religieux, les austérités monacales, les châtiments d’expiation des pulsions, l’antisémitisme d’Eglise, l’Inquisition des déviances.
Il y a eu des résistances catholiques, au XIXe, et la mièvrerie sulpicienne en est une. Saint Alphonse de Ligori a apporté des adoucissements aux mortifications. Mais ce n’est que Vatican II en 1965 (il n’y a que soixante ans seulement !) qui a rejeté le sadisme masochiste de cette exaltation de la souffrance. Le « rachat » est une libération (sens du verbe arracher), pas une rançon de tourments à payer, a-t-il sévèrement jugé.
Un livre d’historiens bien utile à lire pour comprendre les méandres de la foi catholique, ses déviations (durables) et ses repentirs (tardifs). Que l’on soit croyant ou non, il éclaire.
Jean Delumeau et Gérard Billon, Jésus et sa Passion, 2004, Desclée de Brouwer, 161 pages, occasion €3,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)


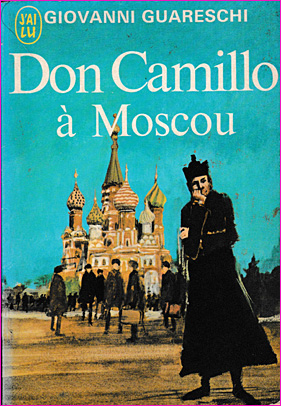

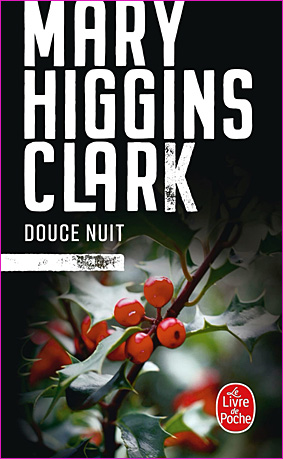
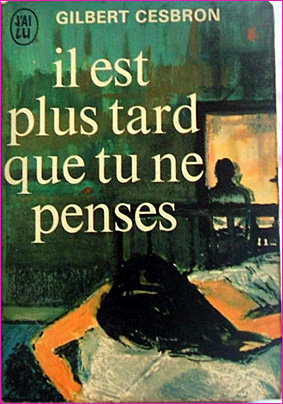





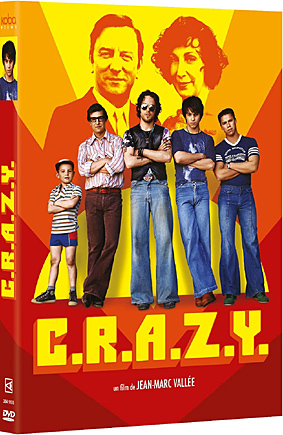

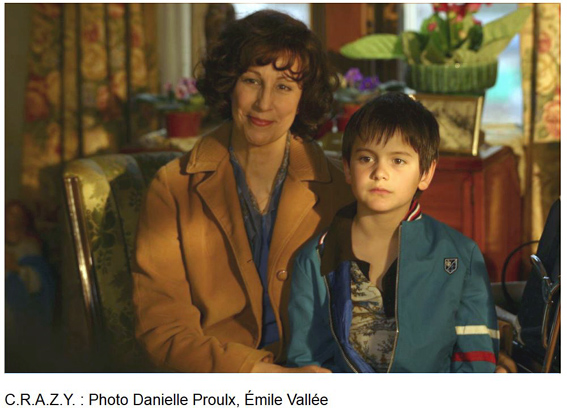










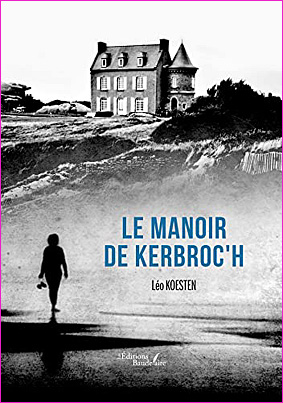
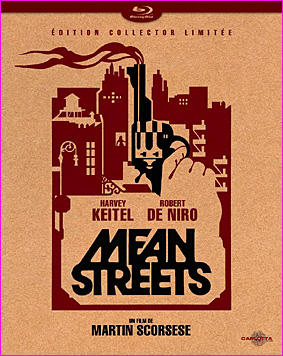












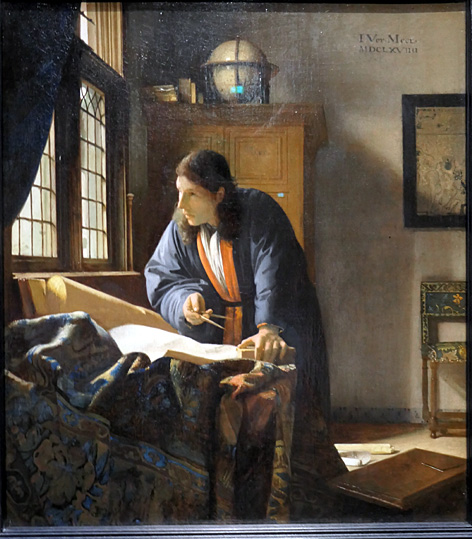





















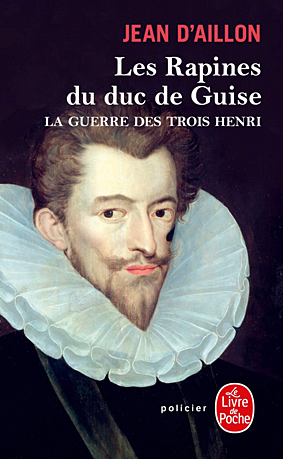



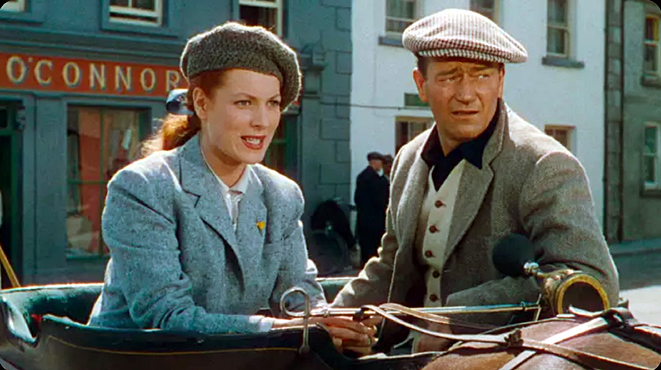

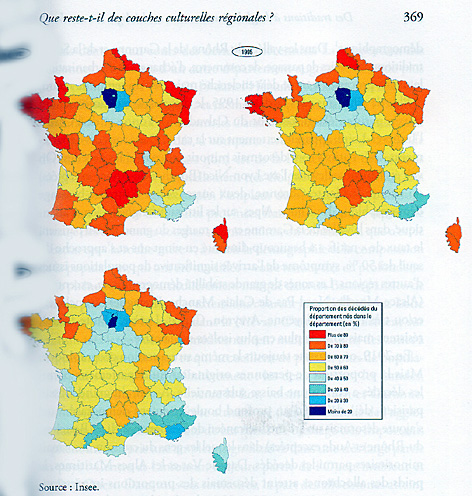
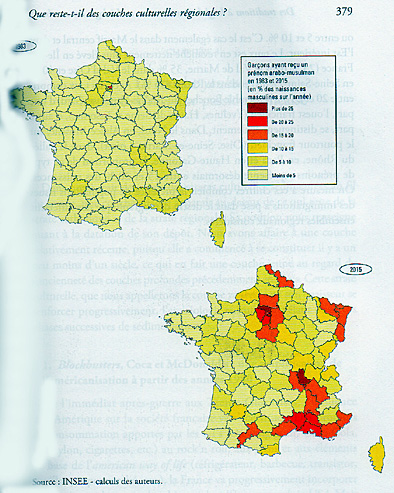
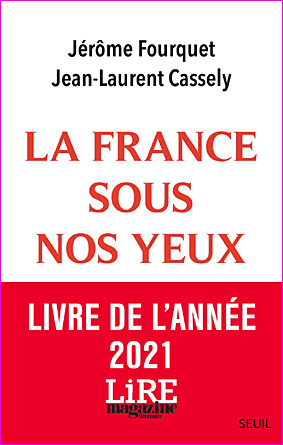
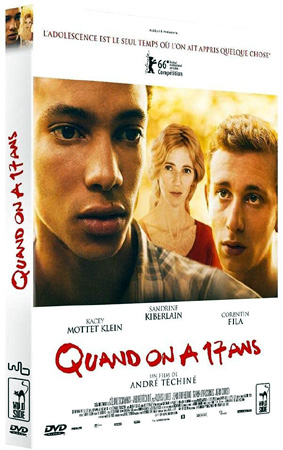




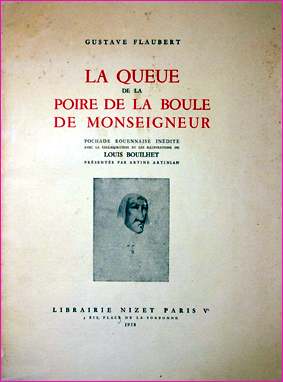

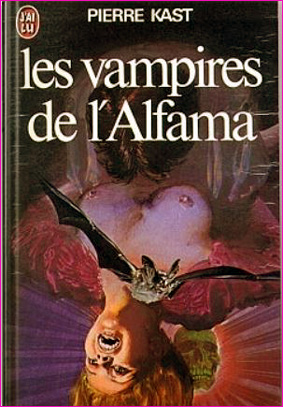



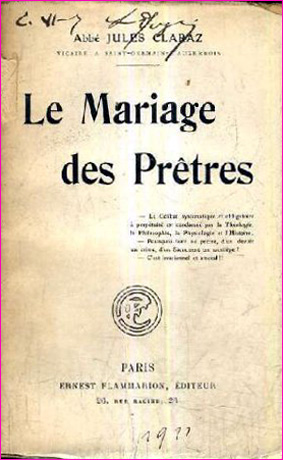














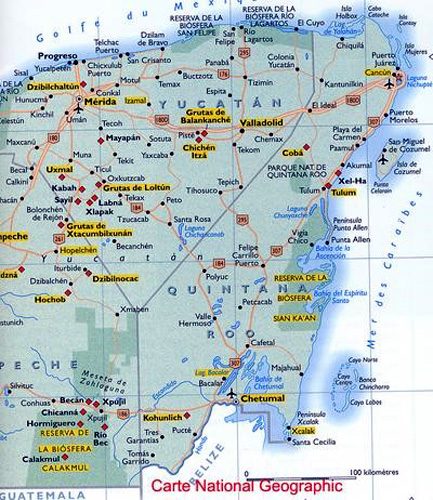







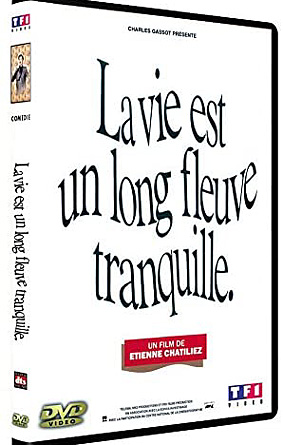


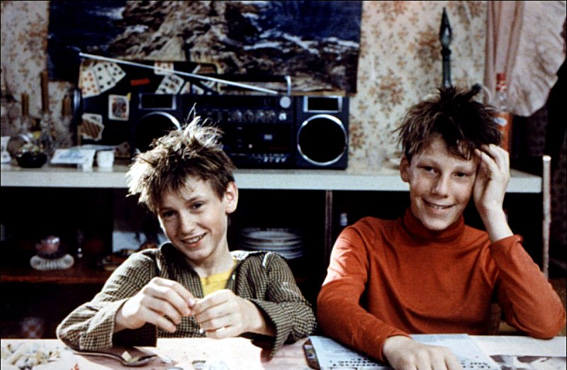




























Commentaires récents