Voici que notre philosophe arrive à son chapitre XX du premier livre de ses Essais. Il est assez assuré désormais pour penser loin, bien qu’il s’assure par de nombreuses citations le soutien des grands auteurs antiques. Il cite surtout Horace et Lucrèce, mais aussi Cicéron (à qui il emprunte le titre de son chapitre), Claudien, Properce, Virgile, Ovide, Carulle et quelques autres. Pas moins de 38 citations, si mon décompte est bon.
« Que philosopher, c’est apprendre à mourir » : chaque mot compte dans cette phrase. La philosophie est l’amour et la recherche de la sagesse pour mener une vie bonne avec le bonheur en bien suprême ; apprendre car il s’agit d’un effort et d’un chemin, une voie comme le zen ou celle de Lao Tse, une progression personnelle ; mourir car la mort est inéluctable et il faut s’y tenir prêt, tout instant pouvant être le dernier.

La mort est pour Montaigne la justification même de la philosophie. Car si philosopher c’est apprendre à mourir, cela signifie qu’une vie bonne est une vie bien remplie, quelle que soit sa durée. « Toute la sagesse et discours du monde se résout enfin à ce point, de nous apprendre à ne craindre point à mourir », écrit-il d’emblée. Et il ajoute : « De vrai, ou la raison se moque, ou elle ne doit viser qu’à notre contentement, et tout son travail tendre en somme à nous faire bien vivre, et à notre aise, comme dit la Sainte Ecriture ». Montaigne va donc contre les austérités chrétiennes prônées par certains protestants de son temps, dont les Puritains, et que certains catholiques parmi les plus intégristes apprécient volontiers. « Quoiqu’ils disent, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c’est la volupté ». Eh oui, n’ayons pas peur des mots comme s’ils étaient le diable ! « Il me plaît de battre leurs oreilles de ce mot qui leur est si fort à contrecœur ». Vivre, c’est bien vivre, donc jouir à satisfaction.
Ce qui ne veut pas dire céder à tous les vices : « Et s’il signifie quelque suprême plaisir et excessif contentement, il est mieux dû à l’assistance de la vertu qu’à nulle autre assistance ». Car la vertu est un plaisir suprême, la tempérance une jouissance distillée, tout comme le chemin procure plus de plaisir que le but ou l’aventure que le trésor. « Cette volupté, pour être plus gaillarde, nerveuse, robuste, virile, n’en est que plus sérieusement voluptueuse », dit Montaigne. Il joue de l’ambiguïté en parlant de la vertu comme chacun parle du sexe. Mais la jouissance sexuelle est une « volupté plus basse », explique le philosophe, « outre que son goût est plus momentané, fluide et caduc, elle a ses veillées, ses jeûnes et ses travaux et la sueur et le sang ; et en outre particulièrement ses passions poignantes de tant de sortes, et à son côté une satiété si lourde qu’elle équivaut à pénitence ». A l’inverse, les suites de la vertu « ennoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir divin et parfait qu’elle nous procure », assure Montaigne, digne des classiques.
La philosophie (antique) nous enseigne la vertu et la vertu nous enseigne « le mépris de la mort » car si l’on peut vivre longtemps la plupart sans pauvreté ni douleurs insupportables, « au pis-aller la mort peut mettre fin, quand il nous plaira, et couper court à tous autres inconvénients ». Si rien n’est pire que vivre, mettre fin à sa vie est une liberté que nous avons partout et en tous lieux, disaient les stoïciens. Mais il y a mieux : « la mort, elle est inévitable ». Autant ne pas en avoir peur car ce n’est point vivre que craindre mourir à tout instant. Y penser toujours, n’y céder jamais – telle est la sagesse. « Le but de notre carrière, c’est la mort, c’est l’objet nécessaire de notre visée : si elle nous effraie, comment est-il possible d’aller un pas avant sans fièvre ? »
Montaigne n’est pas vieux lorsqu’il écrit cela. « Il n’y a justement que quinze jours que j’ai franchi 39 ans », écrit-il après nous avoir rappelé être né « entre onze heures et midi, le dernier jour de février 1535 » du nouveau calendrier de 1564 (l’année auparavant commençait à Pâques). Est-ce assez ? « Il m’en faut pour le moins encore autant », dit Montaigne (il mourra vingt ans plus tard en 1592), « mais quoi, les jeunes et les vieux laissent la vie de même condition ». Ce qui importe avant tout est de vivre sa propre vie selon l’exemple d’Alexandre le Grand et du Christ, tous deux morts à 33 ans. Leur existence courte en fut-elle moins belle ? À tout moment chacun peut mourir, et Montaigne de citer outre la guerre, les accidents, les fausses routes, les gangrènes, les coups et les jeux violents, les ardeurs excessives « entre les cuisses des femmes ». À tout moment la mort nous guette mais il n’en faut point se donner de peine : « il me suffit de passer le temps à mon aise ; et le meilleur jeu que je me puisse donner, je le prends », dit Montaigne.
Il faut en revanche s’y accoutumer, « à tout instant représentons-là à notre imagination et en tous visages ». Car « la préméditation de la mort est préméditation de la liberté », explique Montaigne dans les pas de son ami La Boétie. « Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte ». Ce pourquoi je « me rechante sans cesse : Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd’hui ». Si nul ne peut être sûr du lendemain, « ce que j’ai à faire avant de mourir, pour l’achever tout loisir me semble court, fût-ce d’une heure ». Mettre ses affaires en ordre, apaiser ses querelles, assurer ceux qu’on aime, « il faut être toujours botté et prêt à partir »…
Nous sommes nés pour agir et « je veux qu’on agisse (…) que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait ». Nous humains ne sommes pas des dieux et n’avons nulle éternité devant nous ; le simple fait d’être né implique qu’il nous faudra mourir. N’en ayons pas peur : « si c’est une mort courte et violente, nous n’avons pas loisir de la craindre ; si elle est autre, je m’aperçois qu’à mesure que je m’engage dans la maladie, j’entre naturellement en quelque dédain de la vie », pense Montaigne. Et ce n’est pas faux si l’on y réfléchit ; la vieillesse extrême rend las de l’existence qui n’est plus celle vigoureuse de sa jeunesse. L’imagination grossit les choses, la mort comme les autres ; il ne faut pas nous en faire un monde.
En attendant l’instant fatal, « la vie n’est de soi ni bien ni mal : c’est la place du bien et du mal selon que vous la leur faites. Et si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à tous les jours ». A chacun d’y mettre ce qu’il peut, si possible le meilleur et « nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n’est non plus vôtre que celui qui s’est passé avant votre naissance ». Vivre, c’est bien vivre et en être heureux. « Où que votre vie finisse, elle y est toute. L’utilité du vivre n’est pas en l’espace, elle est en l’usage : tel a vécu longtemps qui a peu vécu (…). Il gît en votre volonté, non au nombre des ans, que vous ayez assez vécu ». Il faut remplir sa vie, à sa satisfaction, même enfant ou sans grade : « Un petit homme est homme entier, comme un grand ».
Mourir est un destin qui ne doit pas nous inquiéter, il viendra lorsqu’il viendra. Il faut plutôt se préoccuper de vivre, et cela est philosophie : puisque notre temps est court et incertain, vivons chaque jour comme s’il était le dernier, remplissons notre vie d’action et de voluptés – dont la vertu est la meilleure. Ainsi vivrons-nous en sage, et mourrons de même.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog


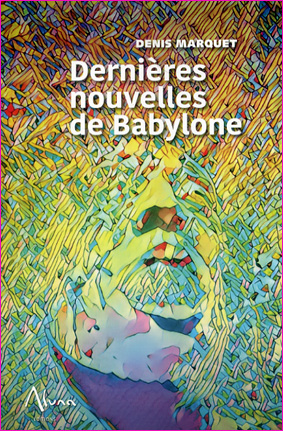

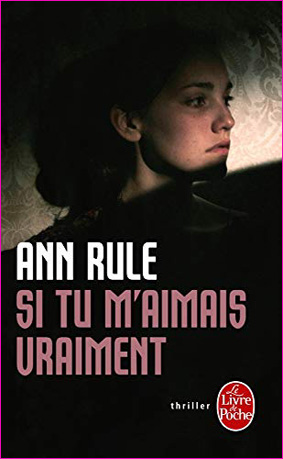









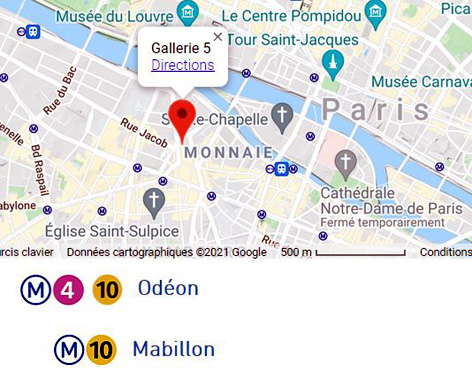
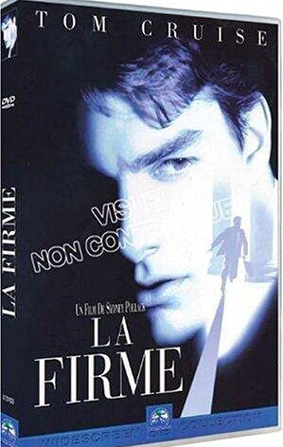











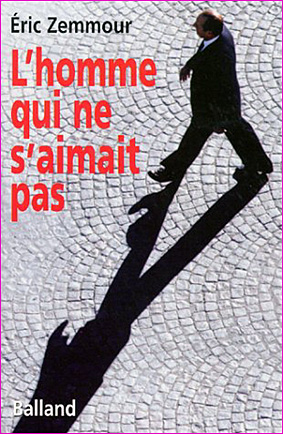





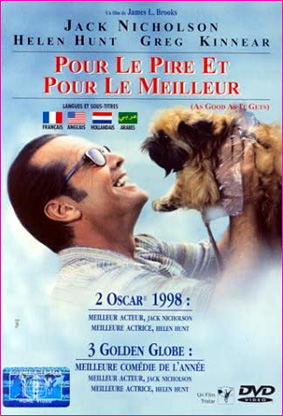







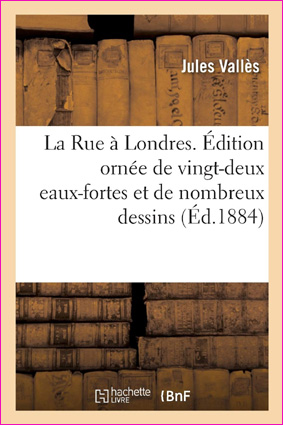


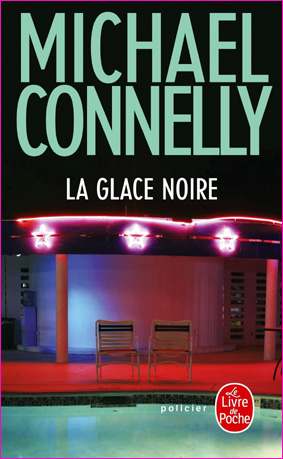

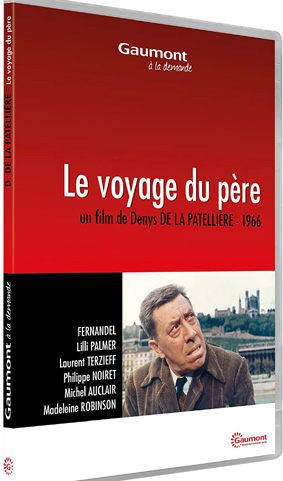














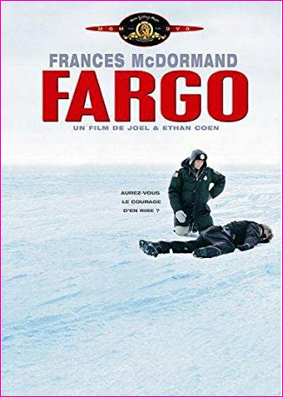







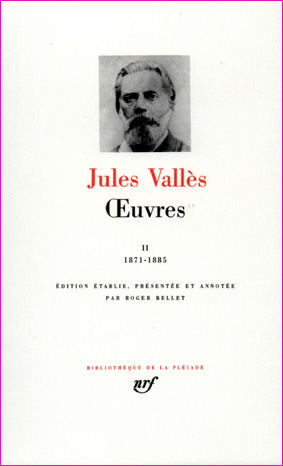
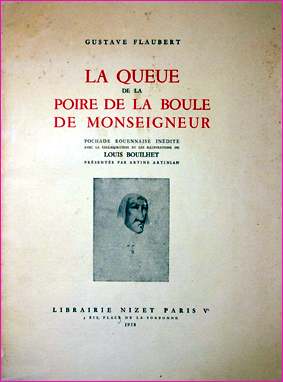

Commentaires récents