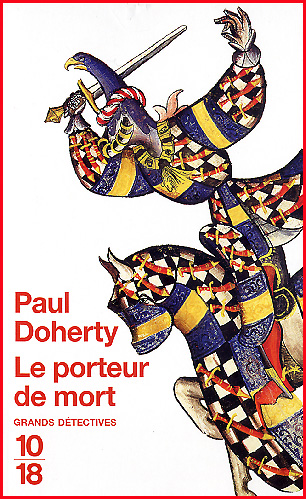
Nous sommes en 1304 dans l’Essex. Saint-Jean d’Acre – dernier bastion chrétien en Terre sainte – est tombée aux mains des musulmans quelques années plus tôt. Le donjon des Templiers a résisté le dernier avant que les survivants soient tous massacrés, sauf les jeunes filles et les enfants de moins de 15 ans, voués aux plaisirs et en vente avec profit sur le marché aux esclaves. A Mistelham dans l’Essex, en ce mois de janvier glacial, le seigneur du lieu s’appelle Scrope ; il est l’un des rares à avoir échappé à la prise d’Acre. Il s’est servi dans le trésor templier avant de s’évader en barque avec ses compagnons dont Claypole, son fils bâtard et un novice du Temple.
Mais justement, il a volé le Sanguinis Christi, une croix en or massif ornée de rubis enfermant le sang de la Passion enchâssée dans du bois de la vraie Croix, dit-on. Les Templiers veulent récupérer ce bien tandis que Scrope l’a promis au roi Edouard 1er d’Angleterre qui l’a fait baron et bien marié. Or voici que des menaces voilées sont proférées par rollet contre Scrope tandis qu’une bande d’errants messianiques établis sur ses terres pratiquent l’hérésie et la luxure. Le roi, dont le trésor de Westminster a été pillé par une bande de malfrats particulièrement habiles (fait historique !), ne veut pas que le Sanguinis Christi lui échappe.
Il mande donc sir Hugh Corbett, chancelier à la cour, pour enquêter et juger sur place au nom du roi. Il sera accompagné de Chanson, palefrenier, et de Ranulf, formé au combat des rues par sa jeunesse en guenilles et que Corbett a sauvé jadis de la potence. Le trio débarque donc au manoir de Scrope, muni des pleins pouvoirs de la justice royale. Lord Scrope est sans pitié, il aime le sang ; sa femme Lady Hawisa, frustrée, qu’il méprise ; sa sœur Marguerite, abbesse du couvent voisin ; son chapelain maître Benedict ; Henry Claypole, orfèvre et bailli de la ville, qui est son bâtard dévoué ; le père Thomas, curé de la paroisse et ancien guerrier ; frère Gratian, dominicain attaché au manoir.
Qui sont ces Frères du Libre Esprit, que Scrope a fait passer par les armes un matin, pour complot et hérésie, dans les bois de son domaine ? Une bande d’errants hippies rêvant de religion libérée de toute structure et hiérarchie, adeptes de l’amour libre et de la propriété communiste ? Artistes habiles à la fresque et à chanter ? Pourquoi donc aiguisaient-ils des armes sur la pierre tombale d’un cimetière abandonné ? Pourquoi s’entraînaient-ils au long arc gallois dont les flèches sont mortelles à plus de 200 m ? Depuis quelques mois, un mystérieux Sagittaire tue d’une flèche galloise un peu au hasard dans le pays, après avoir sonné trois fois la trompe. Qui donc est-il ? De quelle vilenie veut-il se venger ?
Ce seizième opus de la série Corbett est très achevé. L’intrigue est complexe à souhait, comprenant comme il se doit un meurtre opéré dans une pièce entièrement close sur une île entourée d’un lac profond sans autre accès que par une barque bien gardée. Il y a du sang, beaucoup de sang ; un passé qui ne passe pas, des péchés commis qui poursuivent les vivants ; des instincts qui commandent aux âmes, aiguillonnés par Satan. Nous sommes entre James Bond et Hercule Poirot, entre l’action et l’intrigue, la dague et le poison. Nightshade, c’est l’ombre de la nuit, la noirceur des âmes mais aussi le petit nom de la belladone, cette plante mortelle ingérée à bonne dose.
Whodunit ? Qui l’a fait ? C’est à cette éternelle question des romans policiers que Corbett doit répondre, aussi habile à démêler les passions humaines qu’à agiter ses petites cellules grises.
Paul Doherty, Le porteur de mort (Nightshade), 2008, poche 10/18 janvier 2011, 345 pages, €8.80



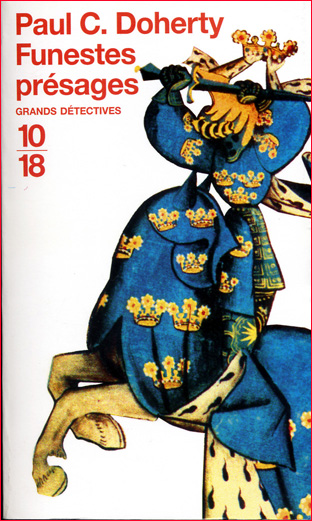
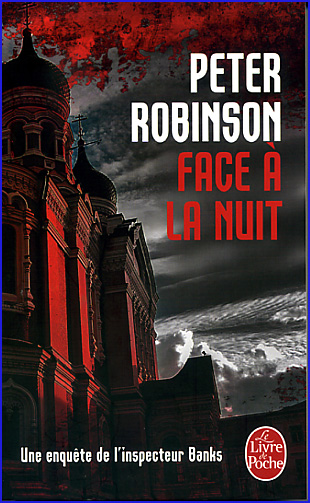

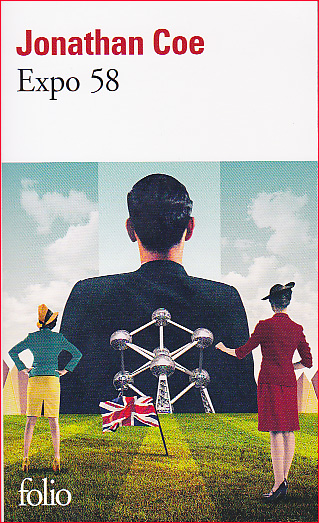


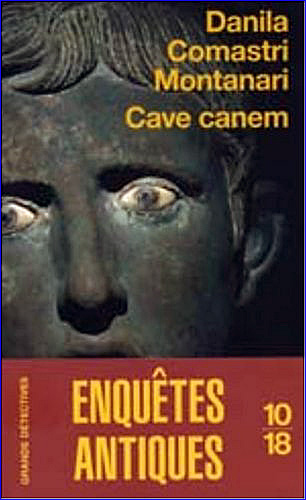


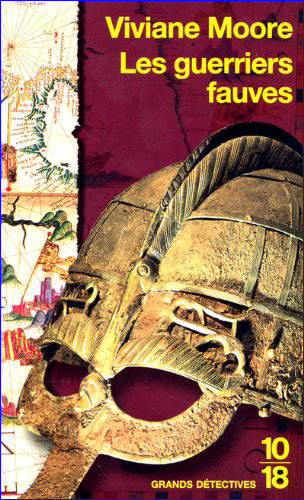
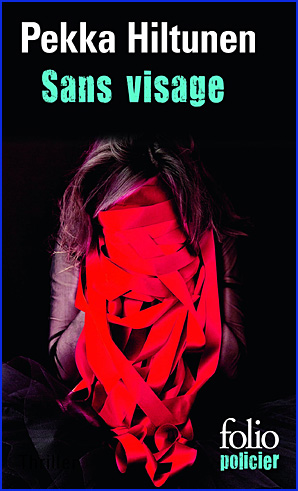

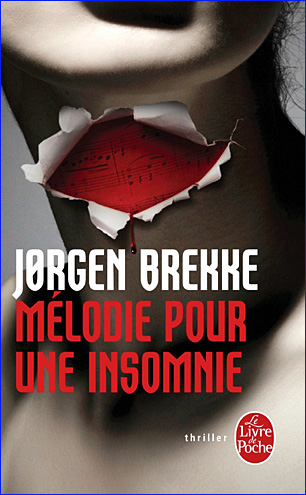


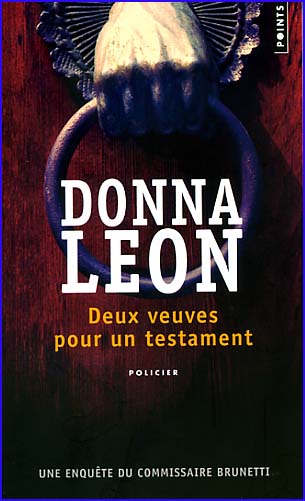
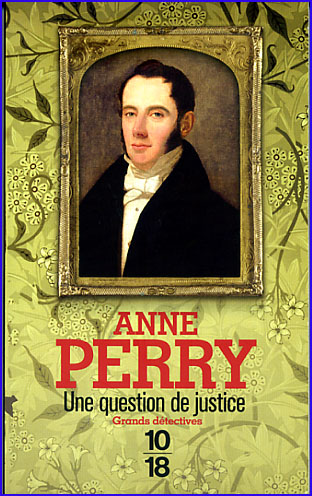

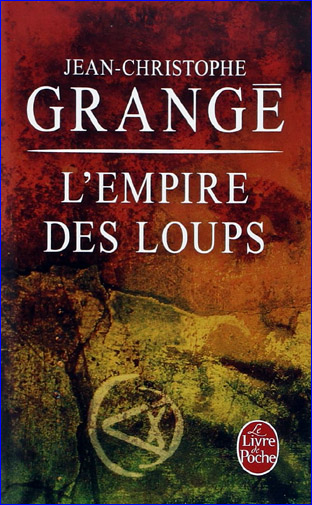
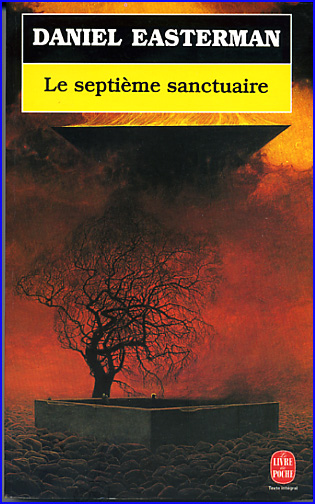


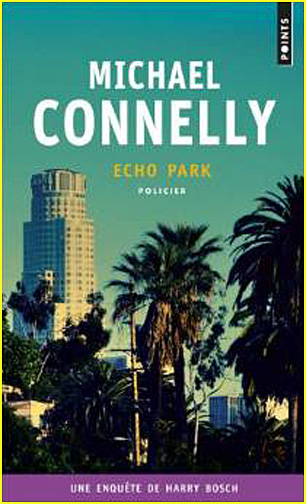



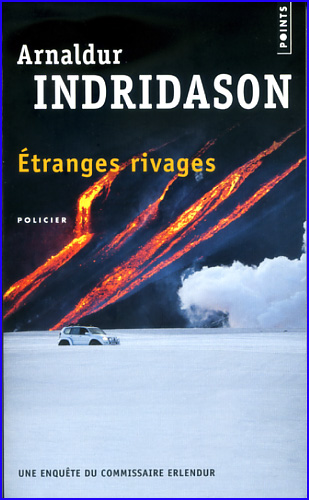


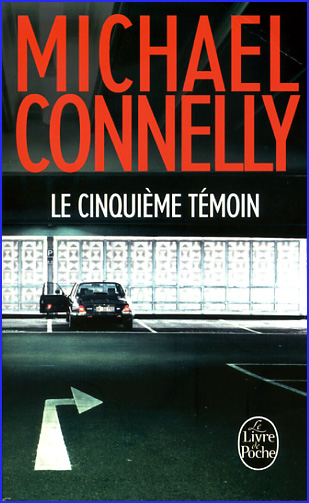



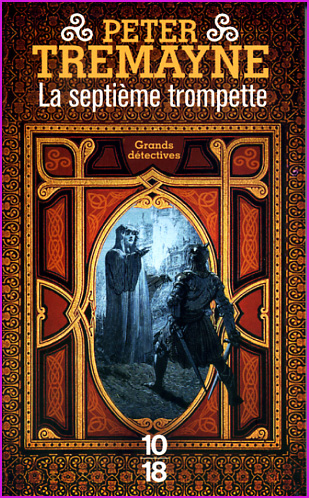
Commentaires récents