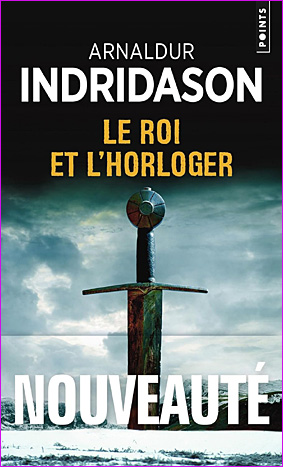
L’écrivain islandais Indridason nous livre ici un roman historique, pas un roman policier comme il en a l’habitude. L’occasion d’évoquer son pays, l’Islande, colonie du Danemark au XVIIIe siècle.
Il met pour cela en scène Jon, un humble horloger islandais qui a eu une vie difficile avant d’émigrer à Copenhague pour se faire artisan, et le roi fou écarté du pouvoir Christian VII (1749-1808). Un jour, Jon Sivertsen est convoqué au palais de Christianborg pour réparer une pendule. Il découvre dans une remise un butin de guerre oublié, une autre pendule ancienne, en ruines. Ce chef-d’œuvre avait été fabriqué en 1592 par Isaac Habrecht, un Suisse qui avait créé la grande horloge de la cathédrale de Strasbourg en 1574. La pendule de Copenhague indiquait les heures, les dates, les mois, le défilé des planètes. Les Rois mages en sortaient chaque heure pour aller se prosterner devant la statue de la Vierge et chantaient un psaume… islandais.
Le vieux roi déboule un soir que Jon travaillait à comprendre les mécanismes de l’horloge ; il est en robe de chambre, une bouteille de Madère à la main, il s’ennuie. Il se fait expliquer la présence d’un tel artisan en son palais, l’intérêt de l’horloge, et pourquoi un Islandais est ici au Danemark plutôt que sur son île perdue dans le froid parmi les moutons.
Jon, en bon conteur islandais, commence alors à dérouler son histoire personnelle. Son père a été condamné à mort par le père du roi actuel, Frédéric V, non seulement pour avoir fauté hors mariage, mais surtout pour avoir engrossé la mère du fils de son fils. Sauf que son fils n’était pas son vrai fils, seulement un enfant de sa femme défunte reconnu, ce que le père biologique ne veut pas reconnaître, par rancœur contre ceux qui l’ont évincé de son amour… Vous suivez ? Sigurdur demande donc à un voisin, contre forte rémunération, de se faire passer pour le véritable père de l’enfant. Ce fut là son erreur, car tout finit par se savoir dans une petite société où tout le monde épie tout le monde.
Les relations en Islande au XVIIIe siècle étaient compliquées en raison du faible nombre de la population. Les désirs se portaient souvent sur des cousines ou des belle-mères, voire des demi-sœurs. Sans toujours le savoir, car les gens mentaient, comme partout. D’où ce code nommé le Jugement suprême qui réglementait les relations sexuelles. Une infamie dénoncée en vers chantés par ce Psaume de la Passion de Hallgrimur Pétursson, reproduit en clochettes dans l’horloge. Fornication et usurpation de paternité ont suffit à faire condamner Sigurdur au billot et sa gouvernante Gudrun à la noyade dans l’eau d’une rivière pour la « laver de tous les péchés ».
Pourquoi le roi Christian VII est-il fasciné par l’histoire de Jon, l’un des fils légitimes de Sigurdur ? L’horloger naïf l’apprend, bien que trop tard pour en tenir compte : Louise-Augusta, la dernière fille de Christian VII, est soupçonnée n’être pas de lui mais de son médecin allemand Struensee, surpris en train de forniquer avec la reine Caroline-Mathilde que le roi délaissait. On lui aurait demandé, pour la bienséance, de reconnaître le bébé, en usurpation de paternité. Ce qui est permis à un roi ne l’est pas à un fermier, voilà l’injustice qui tourmente le cœur de Christian VII. D’autant qu’enfant sensible, il a été fouetté régulièrement par son père, l’impitoyable Frédéric V qui a signé la condamnation à mort de Sigurdur et de Gudrun. Christian hait ce père qui ne l’a jamais aimé ; il a perdu sa mère trop tôt et s’est lancé dès l’adolescence dans la quête effrénée du plaisir, satyre des jeunes femmes et, dit-on des jeunes hommes ses compagnons, puis dans l’alcoolisme avant d’être atteint de démence (ou de la simuler).
Effervescence à la cour, où les escapades du roi auprès de l’horloger se savent – tout se sait en milieu fermé : le palais est comme l’île d’Islande. Jon alimenterait-il la folie du roi en colportant les rumeurs les plus sordides ? Chassé du palais, puis rappelé car il apaise le roi par ses récits, Jon finira par raconter toute son histoire, et avec elle celle de l’Islande, tout en remontant pièce à pièce l’horloge compliquée du Suisse. Le roi l’en remerciera, non sans une dernière crise qui remet tout en question.
C’est que le récit de Jon est comme une psychanalyse pour Christian VII ; il découvre ses blocages et leurs origines : le piétisme, la rigueur de son père. Toujours ce délire d’être plus pieux que son voisin, meilleur que les autres, se valoriser soi au détriment des autres. Ainsi le Jugement suprême islandais qui sanctionnait par la mort des situations somme toute banales. Jon démonte l’esprit de Christian sans le vouloir, comme il démonte les rouages de l’horloge. Le fondement est le temps, qui est compté et peut être démonté et remonté pour en saisir les rouages. D’une histoire simple, Indridason réussit au final une réflexion philosophique sur le temps, sur les vertus de la parole d’artisan pour ceux dont l’esprit a ses rouages dérangés, et un rappel historique des conditions de vie en Islande vers 1750. Un exploit qui se lit bien.
Arnaldur Indridason, Le roi et l’horloger, 2021, Points Seuil 2024, 345 pages, €8,95, e-book Kindle €5,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

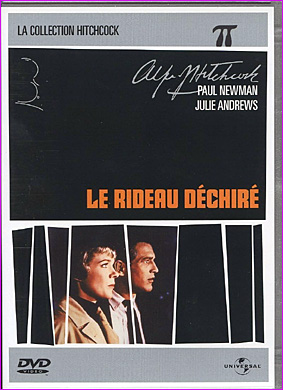








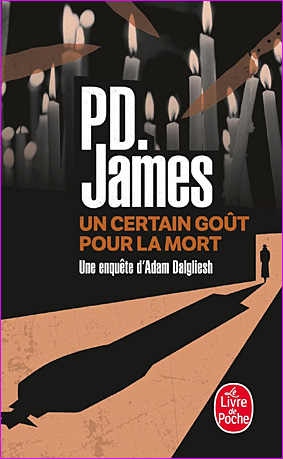
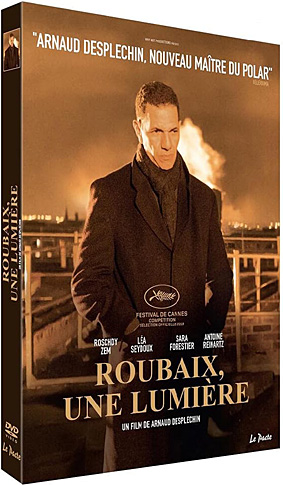



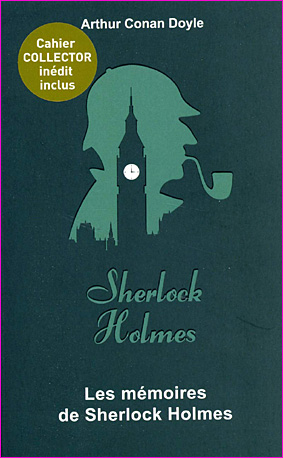
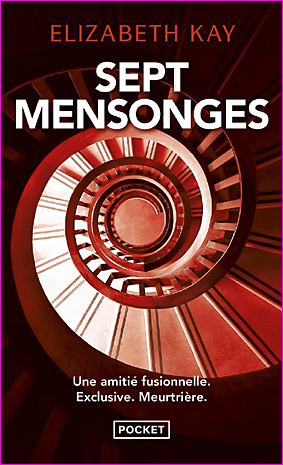
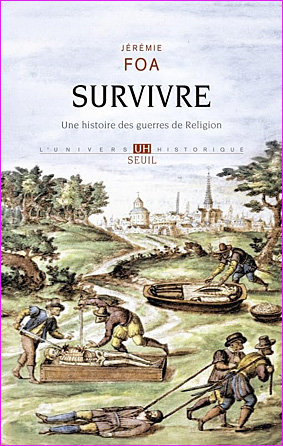

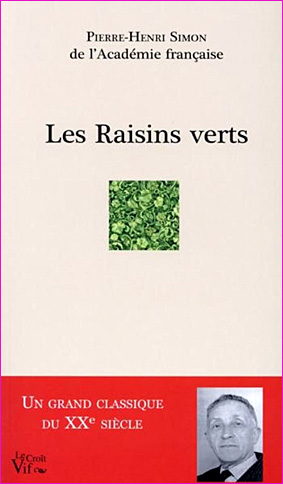
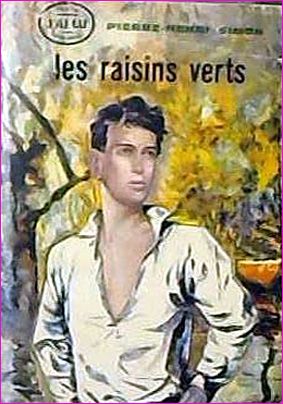
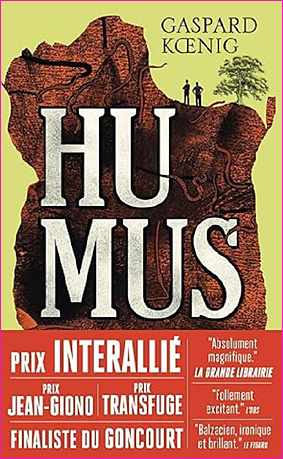



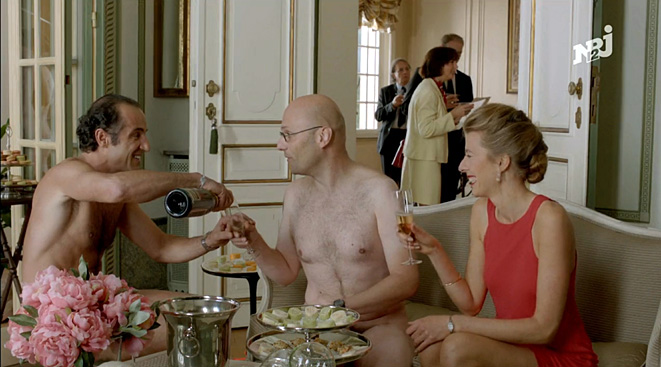


























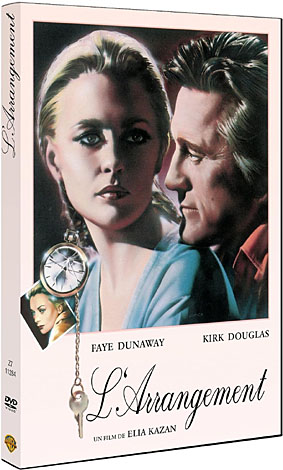









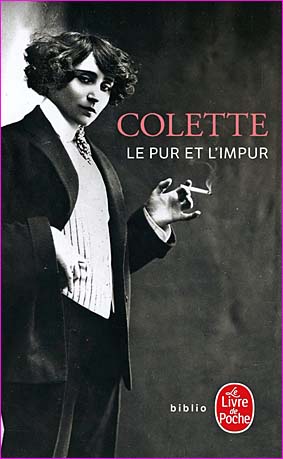
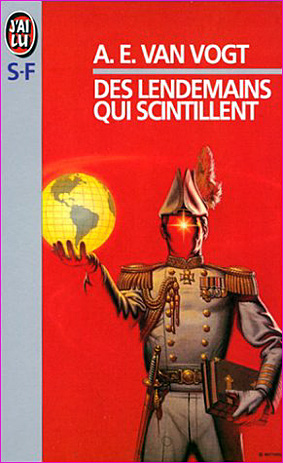









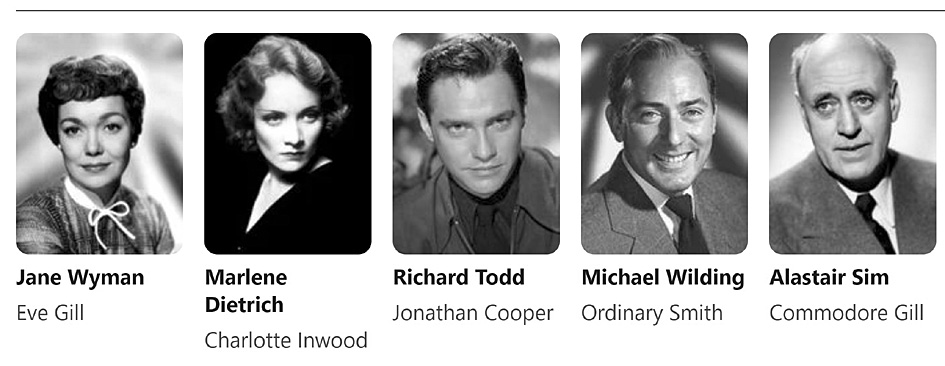






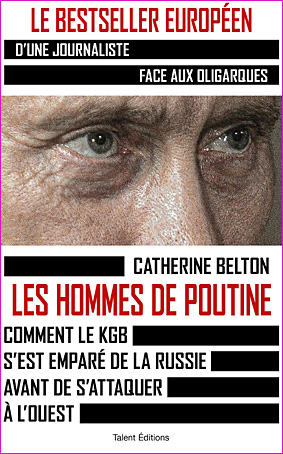
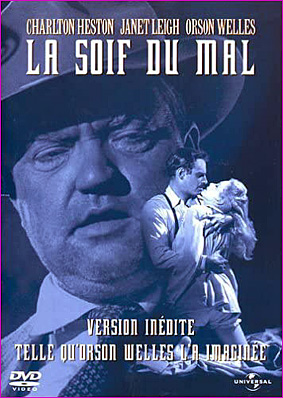









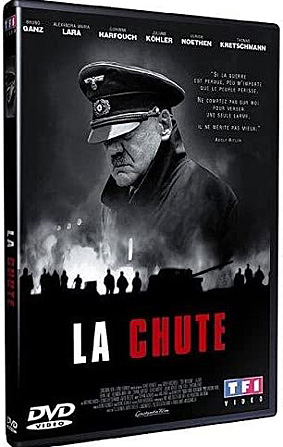












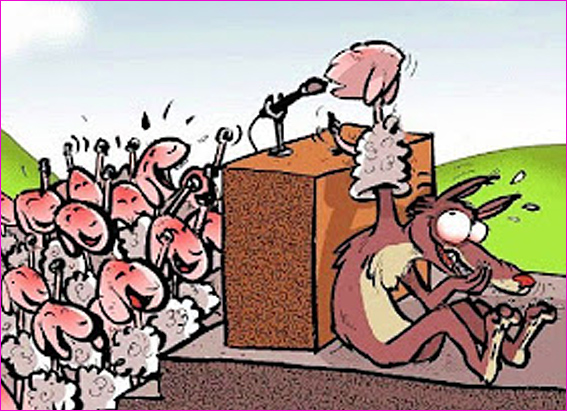
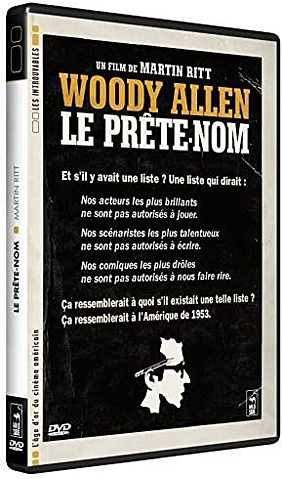



Commentaires récents