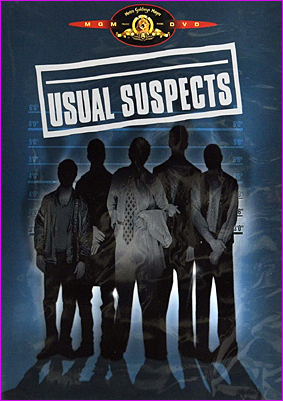
Un navire amarré au port de San Pedro en Californie est incendié, et 27 personnes tuées lors d’un massacre. Seulement deux survivants, un Hongrois à l’hôpital (Morgan Hunter), gravement brûlé, qui se fait appeler Koskoskoskos, et Roger « Verbal » Kint (Kevin Spacey), petit escroc handicapé. L’agent des douanes Dave Kujan (Chazz Palminteri) vient de New York pour l’interroger à propos d’une supposée cargaison de drogue dans le bateau pour 91 millions de dollars.
Verbal, dont le surnom vient de ce qu’il parle beaucoup, mais sans « balancer », raconte. Ils étaient cinq, Keaton (Gabriel Byrne) et lui, aux côtés de Michael McManus (Stephen Baldwin), Fred Fenster l’extravagant à chemise ouverte et verbe haut (Benicio del Toro) et Todd Hockney (Kevin Pollak), présentés à un tapissage. Ils ont été arrêtés comme suspects habituels pour détournement de camion auquel ils nient avoir participé. « Ça ne s’arrêtera jamais ! » s’exclame Keaton qui s’est rangé des voitures sous le métier de financier – une autre façon d’escroc, plus respectable au pays de l’Oncle Sam. Relâchés grâce à l’avocate Edie (Suzy Amis), petite-amie de Keaton, McManus propose de se venger de la PD de New York en braquant l’une de leurs voitures qui sert de taxi à des trafiquants d’émeraudes, avec pot-de-vin à une cinquantaine de flics corrompus. Ils vont ensuite se mettre au vert en Californie, où un certain Redfoot (Peter Greene), qui refourgue les cailloux verts, leur propose un autre deal. Keaton est réticent, mais finit par accepter, poussé par la bande.



Dans le parking en sous-sol d’un hôtel, ils braquent le bijoutier censé détenir une fortune dans sa valise, mais celui-ci refuse de la remettre ; il est descendu. Puis les gardes du corps pour éviter les témoins. Las ! Dans la valise, point de bijoux, mais de l’héroïne. Ce n’était pas le deal. Après une altercation avec Redfoot, celui-ci révèle qu’il s’agissait d’un test organisé par un avocat du nom de Kobayashi (Pete Postlethwaite), qui prétend être un représentant de Keyser Söze, un chef de bande turc émigré aux USA qui épouvante tout le monde du crime. La légende prétend qu’il a lui-même tué toute sa famille devant une bande de Hongrois venue lui faire renoncer à son territoire, sa femme et ses enfants dont son petit garçon, par orgueil de ne rien céder. Puis, implacable, il a descendu tous les Hongrois, leur famille avec femmes et enfants, leurs amis, mis le feu à leurs entrepôts, magasins et cafés, en bref la terreur. C’est ce que raconte Verbal Kint à l’enquêteur des douanes. « C’est le diable ! » conclut-il, en ajoutant, finaud en citant sans le savoir Baudelaire, « la plus belle ruse du Diable est de vous faire croire qu’il n’existe pas ». Ce n’était pas si bien dire, Kujan s’en apercevra trop tard. La police a un dossier sur ce Söze, mais il est insaisissable et la rumeur dans le Milieu veut qu’il s’abrite derrière une brochette de subalternes qui travaillent pour lui souvent sans le savoir.
Kobayashi déclare à Keaton et sa bande qu’ils ont, sans le vouloir, volé son argent par leurs braquages précédents et que, pour se racheter, il leur faut détruire une cargaison de drogue de 91 millions de dollars dans le port de San Pedro pour se venger des Hongrois. La came détruite avec le bateau et la bande qui le convoie, les dollars du paiement seront à eux et ils seront quitte. Keaton ne le croit pas, Fenster fuit et Kobayashi le tue avant d’être menacé à son tour d’être éliminé, jusqu’à ce qu’il les emmène à son bureau. L’avocate petite-amie Edie discute d’un arrangement d’extradition ; elle sera otage jusqu’à leur mission accomplie.


Ils sont donc forcé de le faire. Pas simple, le bateau est gardé par toute un clan d’Argentins passeurs de drogue et de Hongrois acheteurs. Chacun son rôle dans la bande de Keaton, le tireur d’élite et ceux qui s’avancent vers l’équipage avant de monter à bord. Le fusil à lunette fait plop, les fusils-mitrailleurs crachent, les pistolets aboient. Les hommes du bateau sont un à un descendus. Mais « pas de coke à bord ! » s’exclame Keaton. Seulement un prisonnier : les Argentins avaient l’intention de vendre Arturo Marquez aux Hongrois, un passeur qui a échappé aux poursuites en prétendant qu’il pouvait identifier Söze. Verbal, parce qu’handicapé, reste sur le quai en vigie ; Keaton lui ordonne de prévenir Edie si tout tourne mal. A lui aussi de piloter le van contenant les 91 millions. Verbal déclare avoir vu un assaillant invisible tuer Hockney, McManus, Keaton et entendu descendre un prisonnier dans une cabine. L’homme en contre-jour, à long manteau et chapeau, met alors le feu au cargo. C’est toujours Verbal qui raconte.
Kujan en déduit que Keaton était en fait Keyser Söze et qu’il a organisé l’attaque du bateau pour assassiner Marquez et simuler sa mort afin de changer de vie, avec le seul Verbal comme témoin. Il ne sera ainsi plus le suspect habituel qu’on arrête quand se passe un casse. Même sa petite-amie Edie a été tuée, reflet des mœurs du Turc implacable. Mais Söze veut dire « trop parler » en turc, autrement dit Verbal. Celui-ci a finalement avoué que Keaton était derrière tout, allant dans le sens de Kujan. Il lui a dit ce qu’il voulait entendre – c’est ainsi que le storytelling (la belle histoire) est crue par ceux qu’elle manipule. Les fausses vérités deviennent des vérités « alternatives » parce qu’on a envie d’y croire, et Trompe poussera la tromperie jusqu’à des sommets. L’Amérique y est déjà préparée par le monde d’illusions qu’elle ne cesse de créer, de la fausse liberté qui n’est que celle du fric à la fausse consommation qui n’est que malbouffe et mode éphémère, à la fausse générosité humanitaire qui n’est qu’impérialisme préparant la prédation des ressources.


Verbal refuse de témoigner au tribunal et est libéré sous caution. Kujan, en laissant errer son regard sur le panneau d’affichage encombré de notes et d’images du sergent qui lui a prêté le bureau, s’aperçoit que tous les noms cités par Verbal étaient sous ses yeux. Kobayashi était par exemple le fabricant de la tasse à café… Il comprend qu’il s’est laisser prendre par la « belle histoire » et qu’il a été intégralement enfumé. Il se précipite dehors pour rattraper l’handicapé, mais celui-ci a repris une marche normale et son complice, le faux Kobayashi, le prend en Jaguar pour l’emmener vers sa nouvelle vie. Pendant ce temps, un fax parvient à la brigade, représentant le portrait-robot de « Söze » tracé par les descriptions du Hongrois brûlé à l’hôpital : c’est… Suspense !
Tout en retours en arrière tissés par la narration de Verbal, le film permet de découvrir à mesure les couches de tromperie et de fake news, révélées dans la violence, avant le retournement final en beauté. Qui, ailleurs qu’au pays de l’arnaque, aurait pu réaliser un meilleur film sur l’arnaque ? C’était le film préféré de François Hollande, expert en manipulations socialistes, ainsi qu’il l’a déclaré à Nantes le 20 juin 2019 au festival SoFilm SummerCamp.
DVD Usual Suspects, Bryan Singer, 1995, avec Chazz Palminteri, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite, Stephen Baldwin, MGM United Artists 2020, vo anglais doublé français, 1h42, €9,99, Blu-ray vo anglais sous-titré français ou néeerlandais, 20th Century Fox 2007, €19,66
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

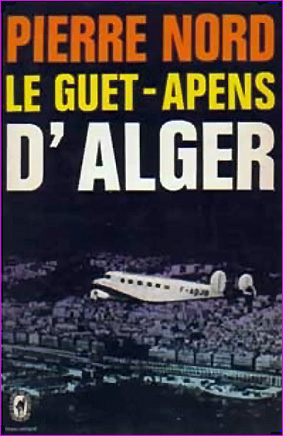
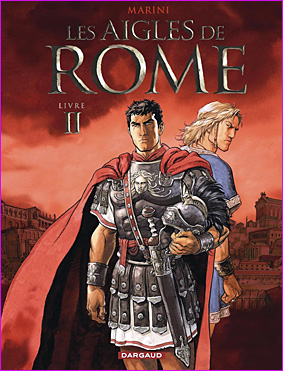
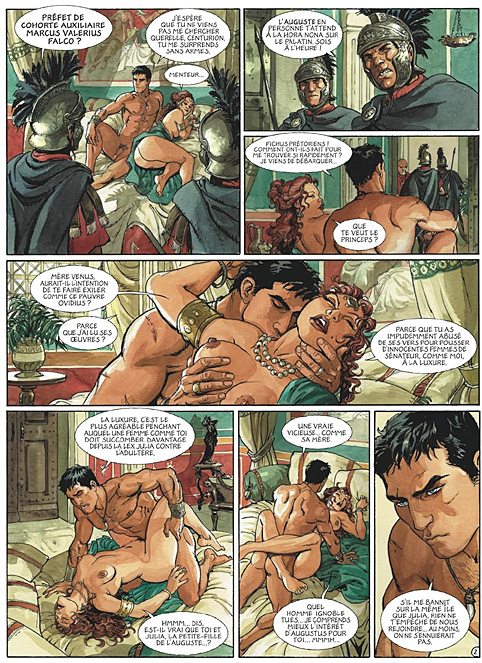
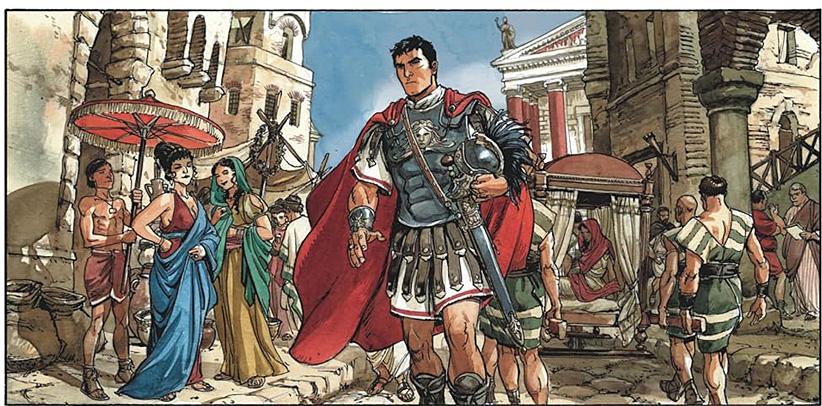

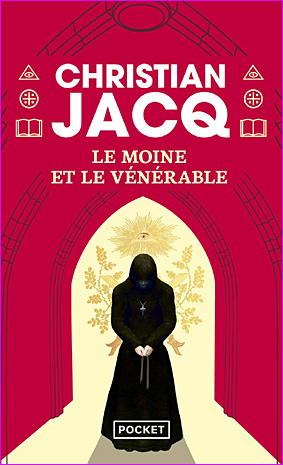

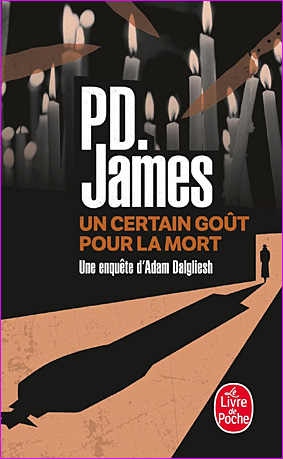
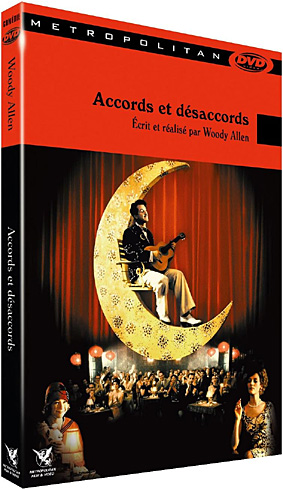









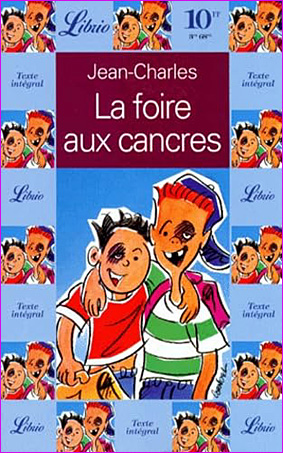



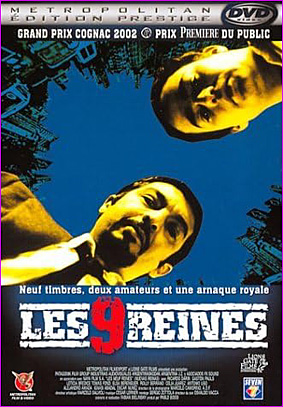







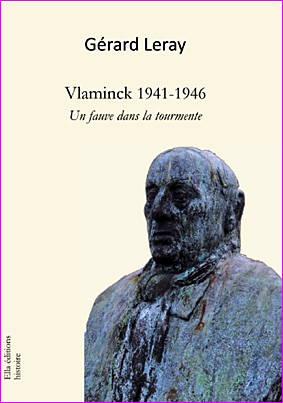





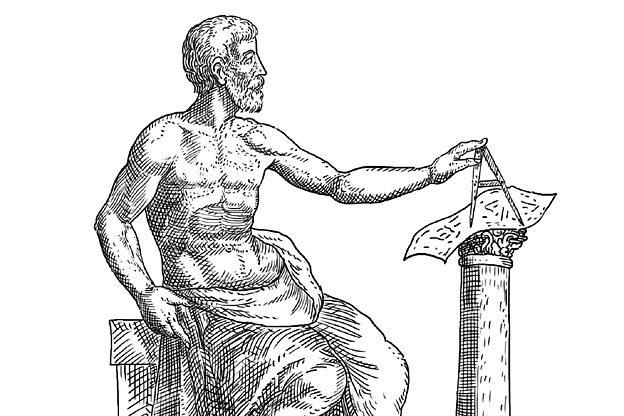
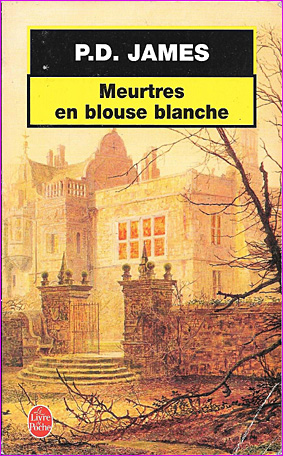











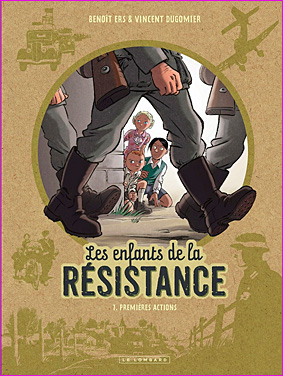
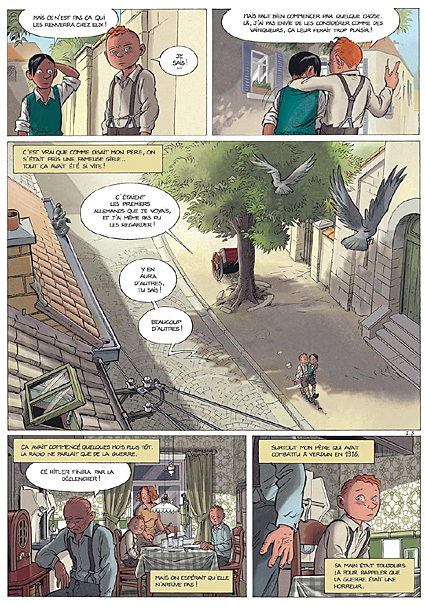
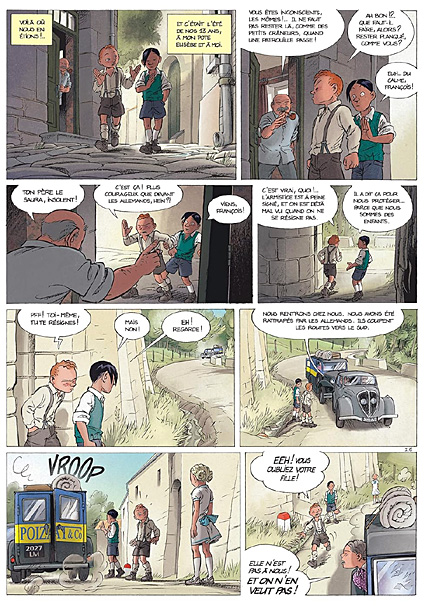
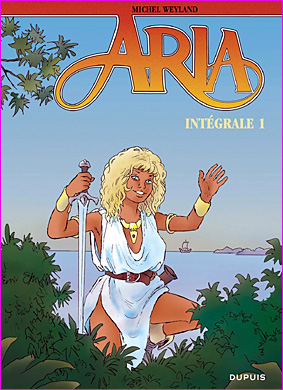
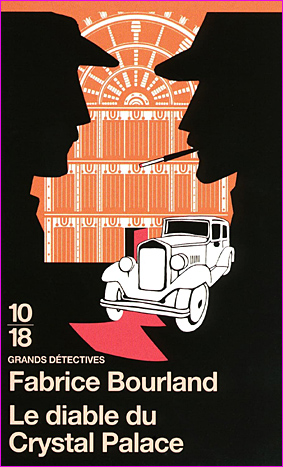
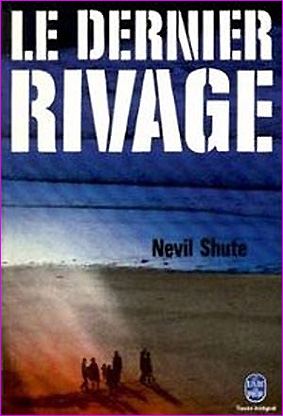







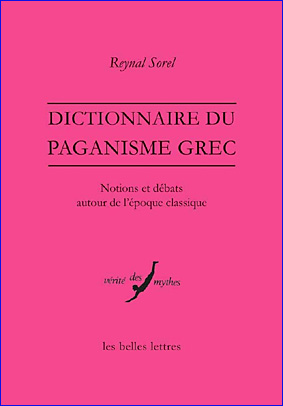
Commentaires récents