 Tempête et passion (Sturm und Drang), tels sont les ingrédients de ce beau premier roman d’un auteur flamand. Il dit la rencontre d’un garçon blond de 12 ans avec une comtesse allemande, dans les prés de Courtrai, combien il lui rappelle son fils, tué avec son père lors d’un accident d’avion. Alex le beau vivant devient le double d’Axel, celui qui est mort. Elle l’apprivoise, l’encourage et l’élève à la grandeur. Celle de l’amour, la révolte des sentiments sur l’abstraction du devoir, la vérité de l’être contre les principes inadéquats de la morale.
Tempête et passion (Sturm und Drang), tels sont les ingrédients de ce beau premier roman d’un auteur flamand. Il dit la rencontre d’un garçon blond de 12 ans avec une comtesse allemande, dans les prés de Courtrai, combien il lui rappelle son fils, tué avec son père lors d’un accident d’avion. Alex le beau vivant devient le double d’Axel, celui qui est mort. Elle l’apprivoise, l’encourage et l’élève à la grandeur. Celle de l’amour, la révolte des sentiments sur l’abstraction du devoir, la vérité de l’être contre les principes inadéquats de la morale.
La passion est mal vue en ces années étriquées. Morale rigide, toute contrainte d’église et de surveillance voisinière. Si nos collèges laïcs fabriquent du crétin, les collèges religieux des années 1940 fabriquaient du chrétien ; les nôtres sortent pour une bonne part illettrés, les leurs sortaient pour la plupart névrosés. Comment ne pas l’être lorsqu’on vous terrorise par les flammes de l’enfer vous grillant pour l’éternité… parce qu’on a montré à 5 ans son zizi à un copain ? Comment ne pas l’être lorsqu’à 13 ans, on croit toujours que les bébés naissent dans les choux ? Mais qu’est-ce donc que « le fruit de vos entrailles » qu’on ânonne à la messe dans le ‘Je vous salue Marie’ ? Rien qu’à côtoyer une veuve riche, les mauvaises langues se mettent en branle, alléchées de péché. Un jars blanc de 13 ans ne serait-il pas capable de tous les vices ? Il y a une bêtise crasse dans la bourgeoisie des petites villes ; Simenon ne s’y est pas trompé, qui les croquera férocement juste après la guerre.
Oh, autant vous prévenir : il ne se passe rien d’ouvertement sexuel entre cette femme de 37 ans et ce garçon de 13. Ni pages torrides ni écarts physiques. Les deux ont beau se tenir les épaules et dormir parfois la tête de l’un sur le ventre de l’autre, ou ramer en slip sur une rivière des Ardennes, l’adolescent est trop sensible pour être forcé, trop candide pour agir en adulte. Elle l’aime avec un cœur de mère, il l’aime comme telle, ayant manqué de la sienne en bas âge. Ce Jean-Jacques a trouvé sa maman de Warens. Elle l’écoute, le suit, le guide. Il pédale 14 km en vélo chaque semaine pour apprendre le cheval, le jardin, la musique. Il travaille tel Sébastien parmi les hommes (célèbre feuilleton TV des années 60) comme palefrenier occasionnel dans son domaine. Il devient bon au collège, puis au piano. Tout le roman est sous le signe de Rousseau : la passion, la nature, l’élan de la musique, l’amour d’une mère. L’éducation qui mûrit, grandit, le cœur empli juste comme il faut.
 L’éclosion de l’adolescent est décrite de façon réaliste et pudique : « L’âme pure et candide d’Alex, son esprit vif et curieux, cette soif et cette faim jamais assouvie d’apprendre, de connaître toujours davantage, était comme un sol fertile qui attendait qu’elle y sème les semences de sa formation supérieure d’artiste et de psychologue, de mère et de pédagogue… » p.86. Quiconque s’intéresse à ses enfants ou aux proches qui ont cet âge privilégié reconnaîtront sans peine le portrait sensible.
L’éclosion de l’adolescent est décrite de façon réaliste et pudique : « L’âme pure et candide d’Alex, son esprit vif et curieux, cette soif et cette faim jamais assouvie d’apprendre, de connaître toujours davantage, était comme un sol fertile qui attendait qu’elle y sème les semences de sa formation supérieure d’artiste et de psychologue, de mère et de pédagogue… » p.86. Quiconque s’intéresse à ses enfants ou aux proches qui ont cet âge privilégié reconnaîtront sans peine le portrait sensible.
La tempête, c’est le décor de la Seconde guerre mondiale faite par les nazis à l’humanité entière. Des bombes tombent sur la ville et enterrent vifs toute une famille dont les cinq enfants étaient au collège d’Alex. La Gestapo traque tous les Juifs pour les déporter avant que la guerre finisse. Justement, la comtesse est née de grand-mère juive, dont elle a hérité les cheveux noirs et les yeux sombres. Un ami de son mari, colonel versé dans la SS, la prévient de s’enfuir.
Il est dommage que l’auteur soit fâché avec la concordance des temps, et que l’éditeur ait failli à son devoir de correcteur. De telles erreurs mettent mal à l’aise la littérature : « Elle fit pivoter le tabouret. Ses mains restaient… [restèrent serait plus correct] » p.31 ; « les deux semaines qui suivirent étaient [furent] longues et monotones » p.37 ; « de temps en temps, Tristan s’arrêta [s’arrêtait] de manger… » p.38 ; et tant d’autres : « comme il est dommage que tu ne peux [puisses] pas m’écrire » p.141…
Le roman est bon, écrit d’une traite, en quinze jours semble-t-il, dans la fièvre d’une réminiscence autobiographique. Le meilleur s’écrit toujours dans la fièvre – sauf que, comme pour forger une épée, il ne faut pas oublier de plonger l’ouvrage dans le froid de la correction rigoureuse !
Mais que cela ne vous rebute pas : j’ai beaucoup aimé ce roman et je vous en conseille vivement la lecture. Vous comprendrez probablement mieux vos adolescents, et l’être humain tout entier.
Andreas Rosseel, Judith von K., septembre 2012, éditions Baudelaire, 165 pages, €15.20
L’auteur : Andreas Rosseel est né le 26 août 1930 à Courtrai, en Flandre, dans un milieu catholique et bourgeois. Diplômé régent en Langues Germaniques à l’Institut St Thomas de Bruxelles, il a ensuite obtenu sa Licence et son Agrégation en Philologie romane à l’Université Officielle du Congo (où il a également enseigné) et à l’Université Libre de Bruxelles. Il a consacré toute sa vie à l’enseignement, notamment en littérature française.
















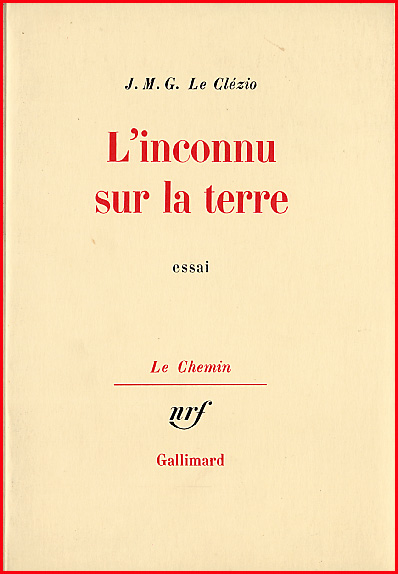

















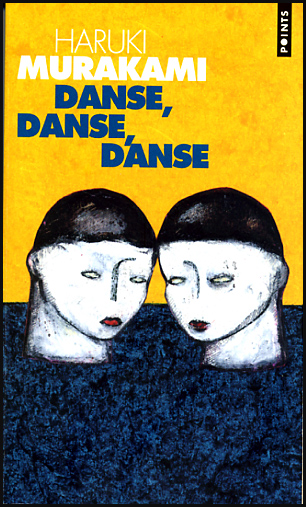












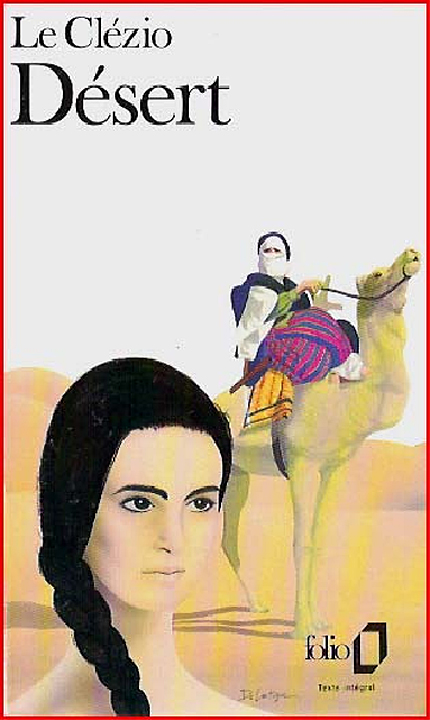

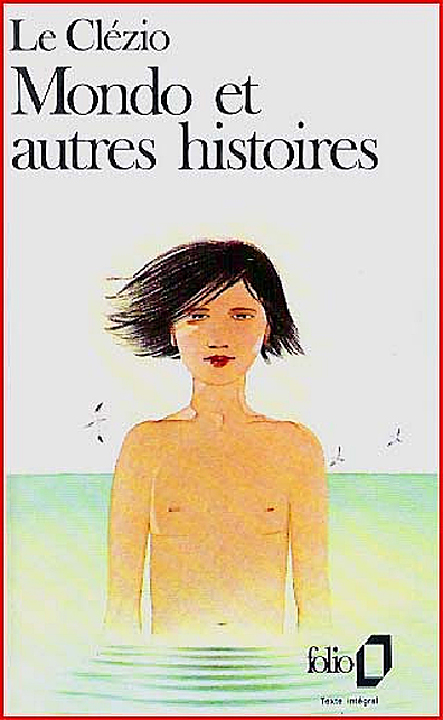
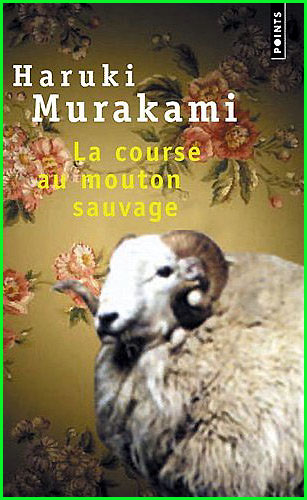





Commentaires récents