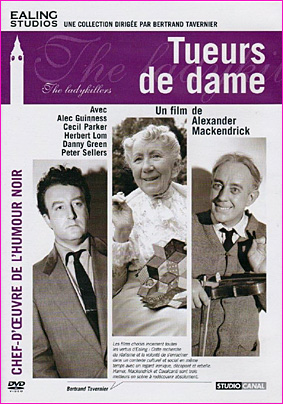
Humour anglais, absolument délicieux. Le film croque les déboires de grands gamins qui tentent un casse d’adulte, mais qui font tout foirer, soit par trop de sophistication intello, soit par trop d’épaisse bêtise. La morale sociale est donnée par une petite vieille sortie tout droit d’un cottage d’Agatha Christie, avec thé à cinq heures et napperons de dentelle, qui habite dans la ville une bicoque au-dessus des voies de chemin de fer. Tchou ! Tchou ! La fumée des locomotives à vapeur jouera un rôle dans l’histoire, comme les limbes entre la vie et la mort éternelle.
Madame Wilberforce (Katie Johnson, 76 ans) est veuve et a hérité d’un officier mort durant la guerre – mais de la marine marchande, tué par un banal typhon. Humour typiquement anglais sur le décalage entre les apparences et la réalité. L’une de ses amies de thé a cru avoir vu atterrir de petits hommes verts d’une soucoupe volante, et Madame Wilberforce a été le dire à la police – les soucoupes étaient monnaie courante à l’époque de la guerre froide, où USA et URSS testaient de nouveaux engins d’espionnage. Humour typiquement anglais sur le décalage entre l’insignifiance des divagations et la vertu d’en informer la police. Au début de l’histoire, Madame Wilberforce revient justement au poste de police pour dire que son amie a reconnu s’être trompée, et que c’est de son devoir d’en informer dûment les autorités.


C’est alors qu’une ombre menaçante à chapeau plane sur la rue, et qu’une silhouette patibulaire commence à suivre la vieille dame. Laquelle s’enfile dans une boutique où elle évoque son intention de louer deux chambres de sa maison pour conforter sa maigre pension ; mais non, personne n’a encore répondu à l’annonce en vitrine. Revenue chez elle, elle commence à nourrir le Général, l’un des trois perroquets laissés par son défunt mari, et à faire le thé, en devant taper au maillet sur la tuyauterie qui ne laisserait pas couler l’eau autrement. Humour typiquement anglais sur le décalage entre la banale opération du thé, qui a lieu plusieurs fois par jour, et la procédure complexe due à la bureaucratie plombière.
A ce moment, coup de sonnette. L’ombre au chapeau est derrière la porte. Madame Wilberforce n’est pas impressionnée (elle devrait) et ouvre. C’est le « professeur » Marcus (Alec Guinness) qui vient louer la chambre pour, dit-il, air faux et mâchoire veule, répéter à loisir avec ses amis d’un quintette à cordes. Ils préparent en fait le vol d’un transfert de fonds à la gare voisine. Tout en discutant du plan entre eux, ils passent un disque à l’électrophone pour donner le change. Lorsque Madame Wilberforce, importune à force d’amabilité sociale, monte frapper à leur porte pour leur proposer l’éternel thé anglais, ils se précipitent pour saisir leurs instruments, arrêtent et cachent le disque. Bis repetita placent, comme on apprend dans les collèges anglais, ce ne sera pas la dernière fois qu’ils seront dérangés, et forcés à l’amabilité sociale. La plus drôle sera avec le perroquet vert, à qui la vieille veut donner une potion qu’il n’aime pas ; il ne se laissera pas attraper, mordra le doigt d’un des malfrats, en fera tomber un autre, obligera un troisième monter sur le toit… avant de se laisser cueillir dans la rue par le « professeur » qui revient et lui tend la main. Mais comment se fâcher avec une Madame Wilberforce ? Elle représente la dame anglaise dans toute sa splendeur : petite-bourgeoisie pauvre mais digne, garante de la morale et des mœurs, une mamie qui réprimande tout écart à la norme.


Le casse se passe comme prévu, la fameuse logeuse Wilberforce jouant à son insu le rôle d’entremetteuse entre le butin et la maison. Les caisses de fric sont mises dans une malle, déposée à la consigne de la gare, et Madame Wilberforce est chargée par son locataire « professeur » d’aller la réceptionner pour lui ; elle est censée parvenir de Cambridge. Les convoyeurs ont été assommés, des témoins ont vu une voiture s’enfuir, poursuivie par les policemen à pied pour faire diversion. Pendant ce temps, un cab d’époque a chargé la malle et l’a déposée à la gare, ni vu ni connu. La police soupçonne que les bandits vont tenter de fuir par le train et demande une liste de tous les bagages entrés et sortis de la gare. Mais Madame Wilberforce, avec son ingénuité d’honnête veuve, récupère la malle et la fait porter en taxi jusqu’à sa demeure.
Évidemment, le retour ne se passe pas sans anicroche. Avisant un commerçant ambulant en primeurs (Frankie Howerd) qui se fâche contre un cheval qui le suit pour lui bouffer ses pommes, elle fait arrêter le taxi et s’insurge contre le mauvais traitement à animal, autre cause classique des vieilles gens britanniques. Tout dégénère et, humour anglais, l’écart entre l’incident mineur et les proportions qu’il prend engendre le rire. Madame Wilberforce en sort blanche comme neige, ayant pourtant déclenché la catastrophe, primeurs répandus dans la rue, taxi bousillé, commerçant et chauffeur en prison.


Les bandits ont eu des sueurs froides, mais le butin est chez eux ; ils montent la malle dans leur chambre et partagent les billets, qu’ils planquent dans les étuis des instruments de musique. Le lendemain, ils prennent congé. Tout s’est bien déroulé, bien que trop complexe pour éviter tous les pièges, mais ils ont eu de la chance. Jusqu’à ce que la bêtise du plus épais (Danny Green) ne gâche tout. En effet, en disant au revoir, et encore adieu, et toujours à bientôt, le plus gros qui porte un étui de violoncelle, coince une bride dans la porte. Au lieu de sonner pour la faire ouvrir et libérer l’attache, l’âne tire comme un forcené et, lorsque la digne Madame Wilberforce vient ouvrir, son étui s’ouvre en deux et répand les billets devant elle.
Shocking ! Cela ne se fait pas : de mentir en disant qu’on est musicien alors qu’on est malfrat, de berner une vieille dame qui ne leur a rien fait, d’avoir volé un argent qui ne leur appartient pas, de vouloir partir avec pour en profiter. Toutes les sonnettes de la morale se mettent à tinter et Madame Wilberforce est outrée. Tellement que le « professeur », finalement aussi benêt que les autres, revient pour lui expliquer, au lieu de fuir dans la voiture toute prête. Il a besoin de replacer son méfait dans une certaine norme, ce qui est inacceptable, mais il n’en peut mais. Toute une théorie de petites vieilles vêtues de couleurs pastel et portant des chapeaux ridicules déferlent chez Madame Wilberforce, qui les a invitées pour le thé. Elle aurait voulu que le quintette joue un morceau pour elles, mais ce n’est manifestement plus possible.

En tout cas, la vieille dame confisque les étuis de violon et violoncelle pour les rendre à la police. Les bandits se laissent faire. Ils complotent de tuer l’ancienne, mais personne ne s’y résout, et le plus bête est carrément contre ; elle lui rappelle sa grand-mère. Les cinq commencent à se chamailler et, comme dans les Dix petits nègres, les malfrats se zigouillent l’un après l’autre, presque par inadvertance. Chacun disparaît dans la fumée des locos, jetés par les pieds dans les wagons vides qui résonnent. Le dernier est assommé et jeté lui aussi, mais par un signal ferroviaire. Humour typiquement anglais qui fait intervenir le destin là où la succession des actes humains ne peut plus continuer.
Et Madame Wilberforce, comme le chat de la chanson allemande, est toujours vivante. Son moral et sa morale sont intacts. Les malfrats envolés, elle se rend au poste de police pour dire qu’elle a le fric, que les bandits se sont évanouis, qu’elle a été complice involontaire – mais on lui dit de fermer son clapet et d’oublier tout ça. Désormais riche, elle distribue les billets aux mendiants…
D’une histoire féroce, le réalisateur fait une bouffonnerie morale, où les choses les plus tarabiscotées tiennent droites par la rectitude d’une petite vieille, quintessence de la morale victorienne. Déjà la maison branlante, au bord du fossé du chemin de fer, ne tient que par miracle ; « depuis un bombardement », les murs ne sont plus droits ; elle a tout du manoir lugubre des films d’horreur mais la sérénité aveugle de la mamie anglaise, certaine de sa vertu, la fait tenir debout – comme l’empire, qui se déglingue en ces années cinquante. Un humour so british, que le remake américain inévitable des années 2000 ne parviendra pas à égaler avec ses grosses bottes hollywoodiennes.
DVD Tueurs de dames (The Ladykillers), Alexander Mackendrick, 1955, avec Alec Guiness, Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers, Danny Green, StudioCanal 2004, vo anglais doublé français ou st, 1h26, occasion €21,90, Blu-ray €19,51
DVD Alec Guinness 100ème Anniversaire : Tueurs de Dames, Noblesse oblige, L’homme au Complet Blanc, De l’or en Barres, StudioCanal 2014, vo anglais doublé français, 6h29, €57,38
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

















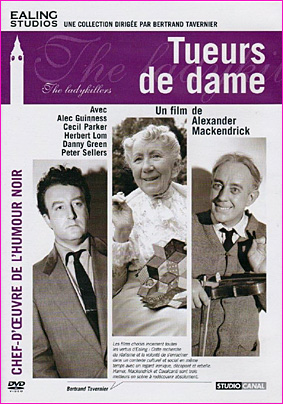


































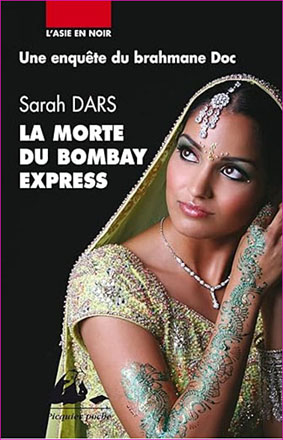

























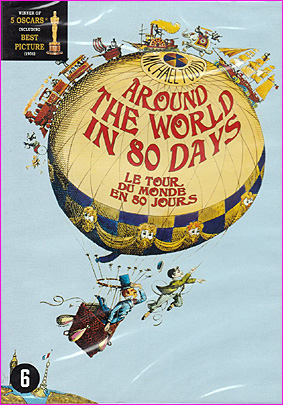















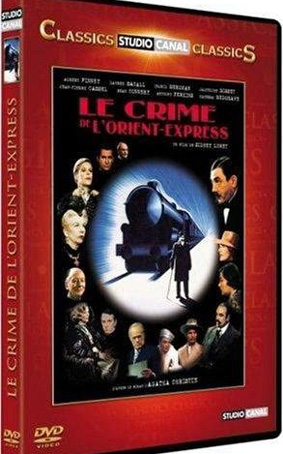














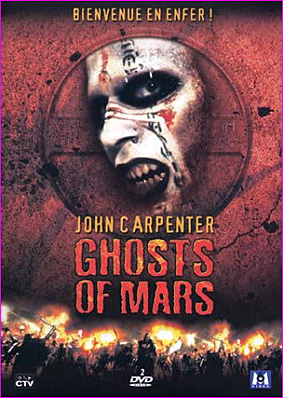










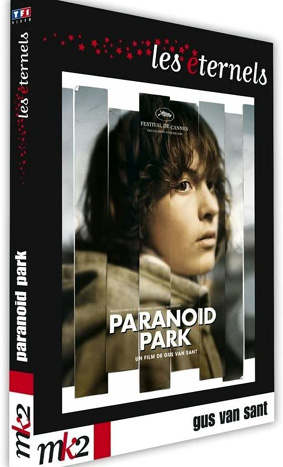





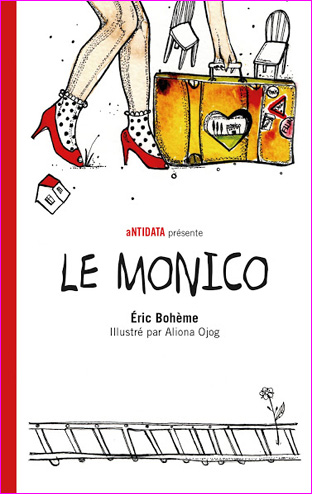
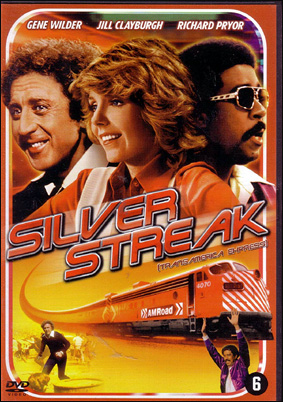




























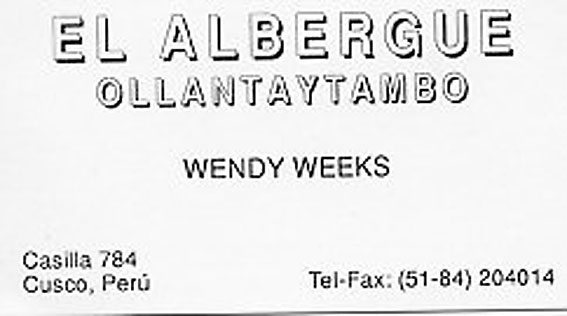












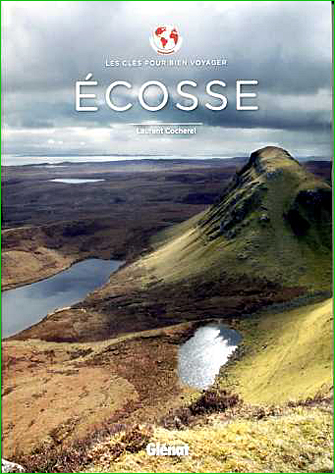
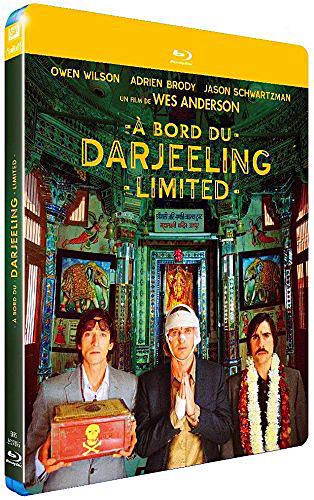


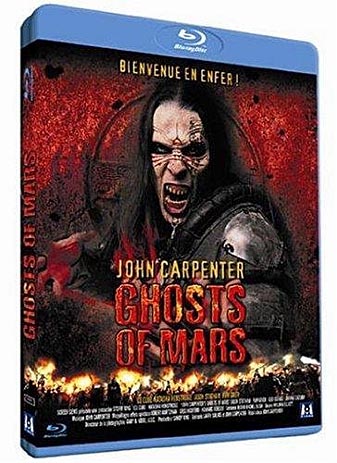














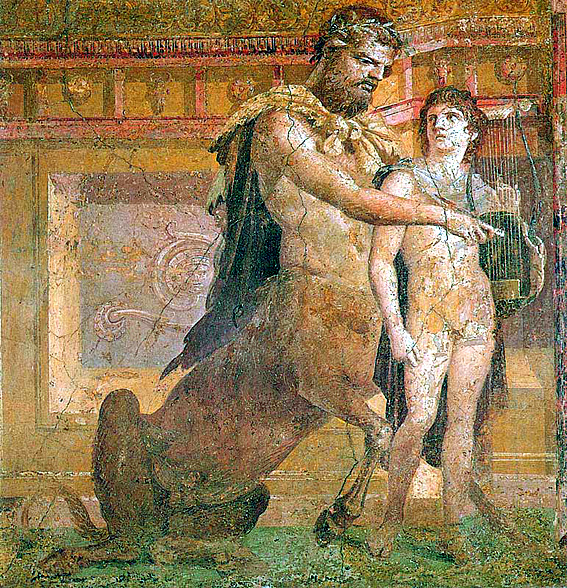



Commentaires récents