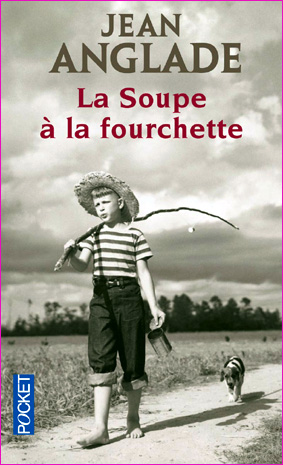
C’est un joli roman sur le monde avant le monde d’avant, que ceux nés après 1960 n’ont pu connaître. La France se repentait sous le maréchal ; elle avait péché par hédonisme et l’Allemagne plus jeune et plus énergique l’avait châtiée – tout comme l’échauffement climatique et la pandémie Covid châtient les hédonistes consommateurs aujourd’hui. La France alors se repliait sur la vie de famille paysanne, traditionnelle et moralement catholique ; tout était à sa place – immémoriale depuis les Gaulois.
La ferme autarcique fournissait tout ce qui était nécessaire pour se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, s’éclairer, élever les gamins. Sauf l’école et la poste, belles inventions modernes – remplacées aujourd’hui par le téléenseignement et Internet. Un rêve d’écolos, une nostalgie d’âge d’or, une stabilité d’équilibre environnemental. J’ai toujours vu ce qu’il y avait de profondément conservateur, antimoderne et réactionnaire dans l’idéologie écologiste. On a beau venir du gauchisme et prôner « l’égalité » et « le social », il n’en reste pas moins que la vie autarcique en milieu local où tout le monde se connait et se frotte l’un à l’autre en se défiant des nomades, est une régression d’âge d’or. D’ailleurs les hippies, aux origines du gauchisme contestataire des années 1960, prônaient le retour à la nature, au naturel, et vivaient à poil sans se laver. Faudra-t-il chanter à nouveau « Maréchal, nous voilà ! » devant Marion pour le rêve d’aujourd’hui ?
Même si l’on ne suit pas cette pente, il est toujours permis de rêver. Jean Anglade, écrivain régionaliste né en 1915 et mort à 102 ans nous y invite. Il est chantre du terroir – mais instituteur républicain. Il a du charme, il sait nous prendre par les émotions, même si cette histoire se termine de façon amère – comme si justement elle n’était qu’un rêve, pas un projet de vie.
La soupe à la fourchette existe, ce n’est pas un concept paradoxal inventé par un néo-cuisinier en mal de notoriété. C’est une soupe banale de légumes du coin (n’importe quel coin) qui trempe le pain (rassis, forcément rassis après une semaine de cuite) et dans laquelle on ajoute du fromage (celui du lieu). Lequel fond, ce qui permet de brasser le tout à la fourchette et d’en faire une purée… qui se mange (donc) à la fourchette. C’est épais, consistant, roboratif, un vrai plat de paysan qui a trimé toute la journée à 1500 m d’altitude dans les pâtis pentus à mener brouter les vaches ou sur les champs resserrés qu’il s’agit de labourer aux bœufs à joug.
L’histoire commence en juin 1943 sous l’Occupation allemande. Dans un village d’Auvergne, les paysans sont incités par le maréchal Pétain – et par le curé qui le relaie – à prendre en pension un enfant des villes où le rationnement dû aux réquisitions allemandes engendre de la malnutrition. La ferme du Cayrol au village d’Albepierre près de Murat nourrit déjà sept bouches : le Vieux et sa Vieille (ainsi disent-ils d’eux-mêmes Léonce Rouffiat et sa Rouffiate), leurs deux filles Amélie, célibataire à 22 ans, et Augustine dont le mari est prisonnier en Allemagne, son fils Adrien de 11 ans, enfin l’ouvrier agricole Jeff, un Irlandais neutre donc ni prisonnier ni mobilisé au STO, berger poète qui écrit « des récitations ». Le Vieux décide d’aider un gamin de la ville et l’enfant Adrien s’en réjouit : enfin un copain pour jouer !
C’est compter sans le sort, qui fait bien les choses mais parfois de façon détournée : à la foire aux gamins, les garçons sont les plus demandés pour aider aux travaux des fermes et les plus grands d’abord parce que déjà costauds. Ne restent au Rouffiat, du fait de l’ordre alphabétique, qu’un lot de filles. Ils ne veulent pas choisir ; le préposé du Secours National leur attribue d’office Zénaïde, une Marseillaise de 9 ans. Elle est bien « un peu trasse » et ne sait pas boire « de la gaspe » mais elle fera l’affaire. Anglade adore ces mots patois qui ancrent dans le vécu et rappellent les « langues régionales » tellement valorisées dans les années post-68 par les sociologues socialistes du retour à la terre. Trasse veut dire un brin rachitique et la gaspe est le petit-lait. Adrien est déçu, bientôt jaloux des attentions que les femmes portent à Zena, puis il s’apprivoise. Il tombera amoureux, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on est tout le temps ensemble, au pâturage ou à l’école, et que les hormones se diffusent avec l’âge. Il a 13 ans et Zéna 11 lorsqu’ils se quittent, à la Libération.
Sauf qu’à demeurer trop proches se nouent des relations fraternelles plutôt que sexuelles. Même à 18 ans lorsque Zéna revient en visite à la ferme, même à 20 ans lorsqu’Adrien va la voir chez elle à Marseille, rien ne se passera entre le garçon et la fille. Remobilisé comme sergent dans l’armée de terre envoyée pacifier l’Algérie par le socialiste Guy Mollet, il reviendra (entier) de ses dix-huit mois de guerre qui ne dit pas son nom. Il n’approuve pas ces opérations de « pacification de l’Algérie » qui réclame son indépendance, lui qui a été occupé aussi par une puissance étrangère. Son rêve de marier Zéna ne s’accomplira pas ; on n’épouse pas sa quasi sœur ni, campagnard, une citadine. Adrien entrera tout seul dans la modernité fermière de la FNSEA et passera du Moyen-Âge au siècle industriel en une décennie.
Ce roman nostalgique se lit bien, même s’il ne faut guère y chercher un « message ». Il est écrit en mémoire d’une époque révolue, celle d’avant 1960 où la France rurale vivait encore en Ancien régime sous la houlette d’un président pater familias à l’ancienne, mélange de roi débonnaire et de croisé retiré sur sa terre, qui se voulait hors du monde et de l’histoire.
Jean Anglade, La soupe à la fourchette, 1994, Pocket 1996, 337 pages, €6.50

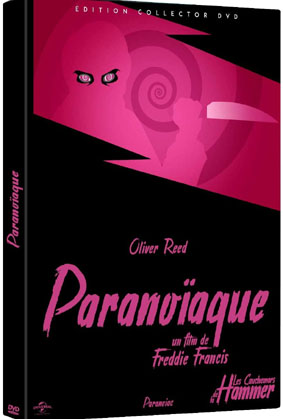










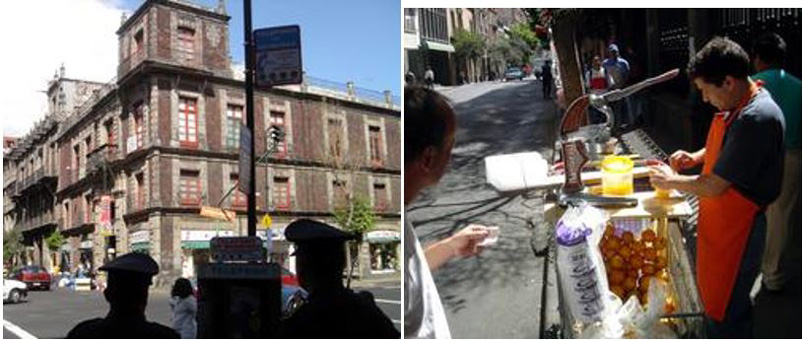




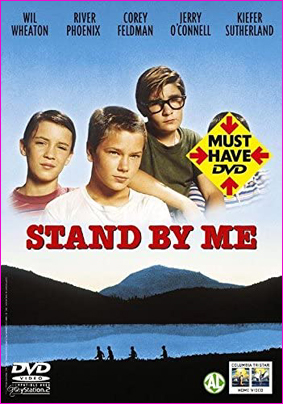

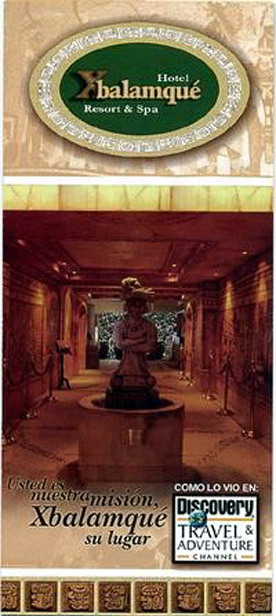


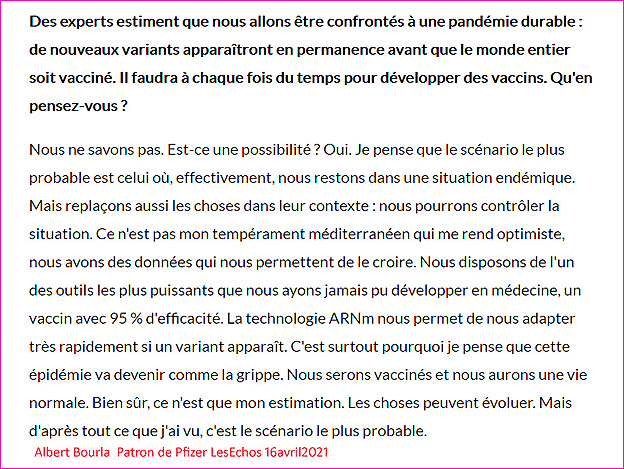






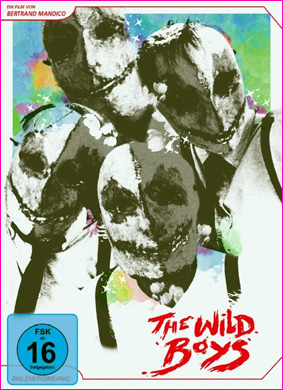

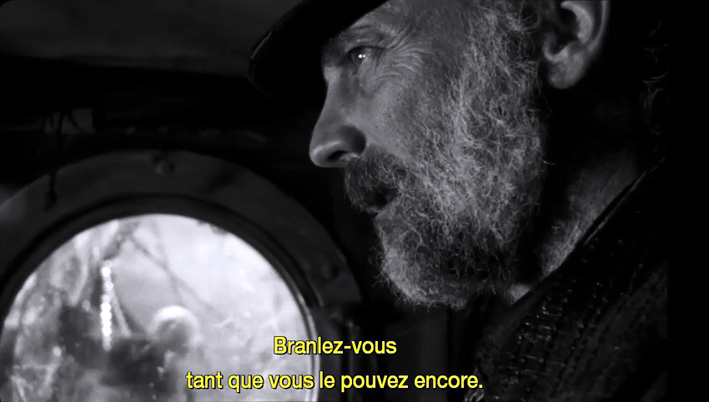







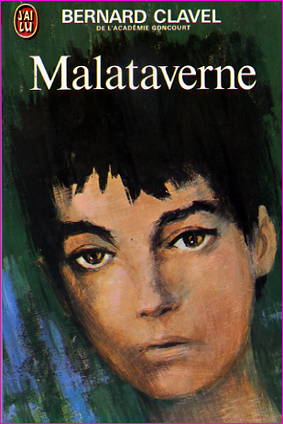











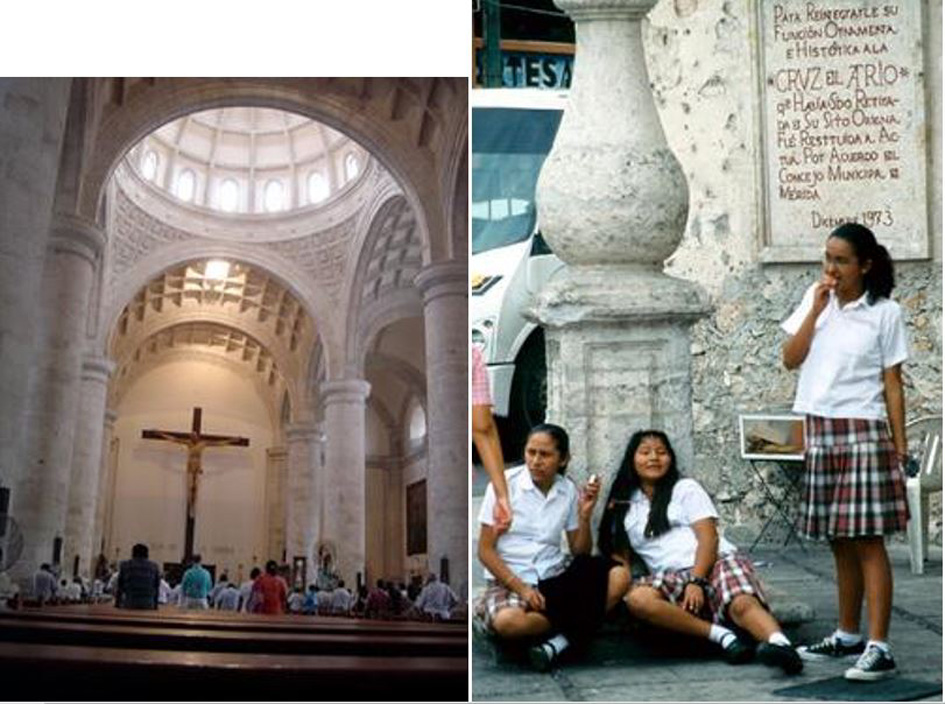













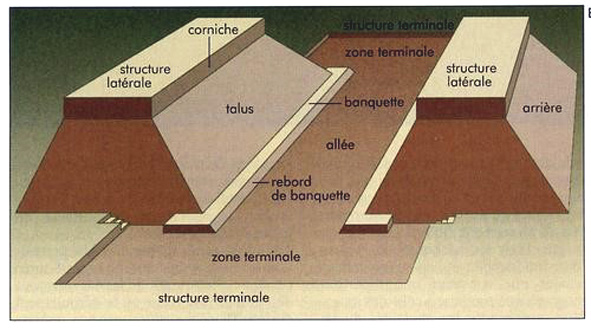



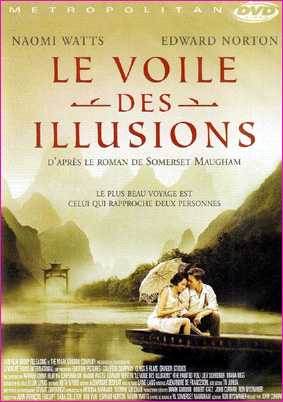








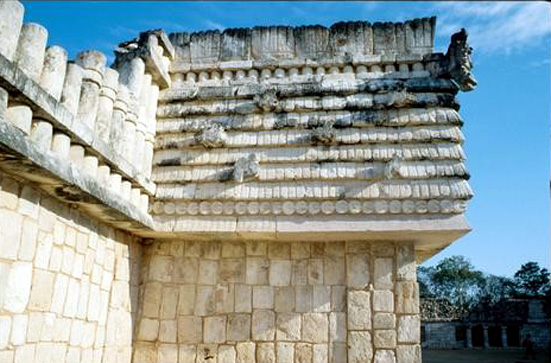












































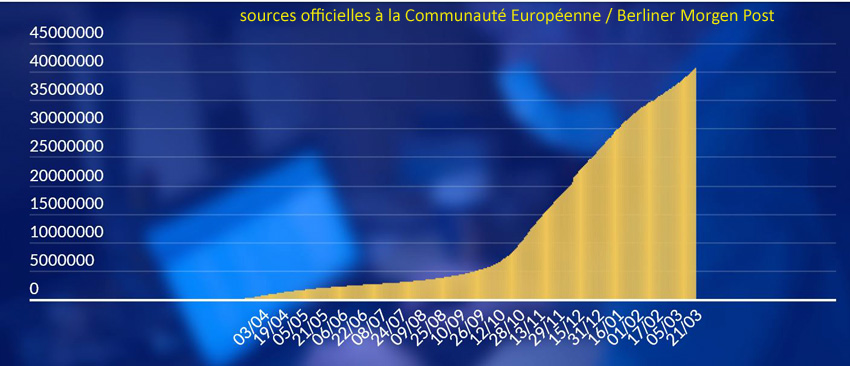







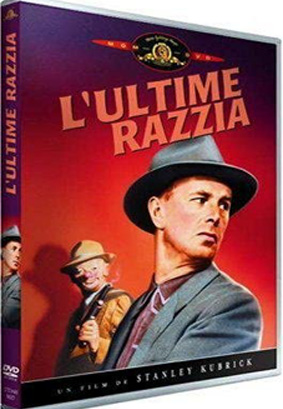



Commentaires récents