
Les lecteurs assidus de cette américaine spécialiste du Londres contemporain se souviennent que, lors d’un précédent roman de la série ‘Thomas Lynley l’aristo et Barbara Havers la prolo’, tous deux membres de Scotland Yard, la femme de Lynley se trouvait abattue par un minoritaire ethnique sur le pas de sa porte. Pour rien, juste parce qu’elle se trouvait là. L’auteur devait se trouver en panne sèche pour faire redémarrer la suite car elle a choisi, depuis deux romans, les chemins de traverse.
‘Anatomie d’un crime’ explore l’existence de la petite frappe qui a tiré, occasion de faire dans le social et de se plonger avec une certaine délectation professionnelle dans l’exploration intime des enfances malheureuses. Le titre anglais est très explicite : ‘Ce qui est arrivé avant qu’il la descende’.
Élisabeth George (pseudonyme), est née dans l’Ohio. Elle s’est intéressée à la littérature anglaise et à la psychopédagogie durant ses études. Enseignante durant 13 ans, elle connaît le monde ado. Choisir Londres et le roman de style policier lui permet le décalage nécessaire pour parler de ce qui l’intéresse sans braquer ses lecteurs américains et Noirs : l’origine sociale et ses conséquences. En ceci, elle est peu américaine au fond, prêtant beaucoup moins d’attention aux gènes et à la « nature » qu’on ne le fait aux États-Unis. Elle apparaît moins éthologue que behavioriste, pour parler jargon. Pour elle, les capacités innées existent, mais elles se révèlent si le milieu y consent, pas autrement.
C’est justement l’histoire de Joel, le tueur de 12 ans, qu’elle veut nous conter. Mélange ethnique de Noir, de Blanc et d’Asiatique (le politiquement correct ne peut pas l’accuser de stigmatiser une minorité…), le gamin « exhibait un visage couvert de taches de la taille d’une dragée qui ne mériteraient jamais le nom de taches de rousseur et qui trahissait la lutte ethnique et raciale dont son sang avait été le théâtre dès l’instant où il avait été conçu. (…) Il avait les cheveux impossibles qui partaient dans tous les sens et ressemblaient à un tampon à récurer couvert de rouille » p.16 Malgré la cruauté ironique du propos, Joel est présenté tout au long du livre comme un préado sympathique, protecteur de son petit frère, s’efforçant d’être responsable et qui fait ce qu’il peut. Mais à cet âge, comment lui demander d’assumer le rôle d’homme dans une famille déstructurée ?
Père drogué repenti, abattu par hasard parce qu’il avait pris le mauvais trottoir au mauvais moment ; mère psychotique qui a failli par deux fois « effacer » son petit dernier en tentant de le jeter du troisième étage, puis en poussant son landau sous un bus, aujourd’hui enfermée chez les fous ; grand-mère coureuse et lâche qui abandonne ses petits-enfants chez une autre de ses filles ; tante, travailleuse méritante mais qui ne peut avoir d’enfant, vite dépassée par une reconstruction trop tardive des mômes. Desdits mômes, Joel est le plus équilibré. Ce n’est que par une suite logique due à un raisonnement de base naïf, qu’il se fourre dans le pétrin. Mais, à cet âge, comment lui demander d’avoir la subtilité d’un adulte ?
Sa sœur de 15 ans, Ness, a été violée dès 10 ans par les copains soûlards de son grand-père ; depuis, « elle aime la bite » et aguiche à qui mieux mieux pour se faire considérer : « Si elle avait retiré sa veste, sa tenue l’aurait également fait remarquer : un petit top à paillettes qui laissait son ventre à nu et mettait en valeur ses seins voluptueux » p.16 Elle ne trouve rien de pire que de provoquer le caïd du quartier, dit « la Lame », expert ès deal en tout genre. Lui la prend, puis la jette comme ses pareilles quand ça lui chante. Dans l’ambiance locale, toutes les pouffes sont des trous putassiers qui ne demandent que protection et sniffe. Ness décide de le quitter, ce qui lance toute l’histoire…
Joel est en effet un petit mâle dont le seul exemple est celui de la rue. On n’y existe que parce qu’on y inspire « le respect ». Pour cela, il faut soit faire peur, soit faire allégeance. A 12 ans, on est à l’âge de l’entre deux, trop fier pour se soumettre et pas les couilles pour s’imposer. Le ressort de l’intrigue est là.
Elle se déploie sur plus de 750 pages qu’on lit avec passion. Ce n’est jamais ennuyeux ni racoleur. Après le décor planté, plutôt sordide, l’engrenage suit sa progression d’horloge, chaque événement entraînant par pente naturelle un second. Parce que sa sœur, pute mais pas soumise, ne suit pas les règles de la rue, le petit frère à moitié débile Toby se fait agresser par une bande de gamins, dont le chef, à peine plus âgé que Joel, voit comme un défi à sa virilité qu’il parle à sa copine dans la même école.
Tout s’enchaîne et Joel, 12 ans, qui ne se drogue pas, ne viole ni n’agresse personne par plaisir et n’est même pas tenté par le sexe, qui écrit dans une « activité » des poésies de rue où les mots se bousculent mais avec vérité, Joel est entraîné dans le maelström. Adultes impuissants à offrir des modèles positifs, protection sociale éclatée, flics débordés qui se contentent de contenir, pas de prévenir – comment un gamin baigné dans un tel milieu pourrait-il s’en sortir ?
Écrivant au scalpel, Élisabeth George ne manque pas d’ironie. Elle pointe les contradictions des gens. D’une musulmane voilée qui veut quand même travailler, et ce dans un pays qu’elle considère ‘impie’ : « Rand travaillait à la vitesse d’une tortue sous calmants, sa vue étant gênée par le stupide drap de lit noir qu’elle s’obstinait à porter, comme si Sayf al Din allait la violer sur le champ dès qu’il aurait la possibilité d’apercevoir son visage » p.549. Des chansons de rue que la démagogie médiatique présente comme de ‘l’art’ : « La radio sur le plan de travail ajoutait encore à la cacophonie ambiante. Du rap s’en échappait sous forme de grognements incompréhensibles émanant d’un chanteur que le DJ présenta comme Queue de Béton » p.658. D’une travailleuse sociale, pleine de bonnes intentions : « Elle était blanche, blonde, bien propre sur elle : ce n’étaient pas des défauts mais des handicaps. Elle se considérait comme un modèle au lieu de se voir comme ce qu’elle semblait être aux yeux de ses patients : une ennemie incapable de rien comprendre à leurs vies » p.652
Est-ce à dire que c’est à désespérer de tout et qu’il n’y a rien à faire pour ces minorités sinon, comme les flics, du ‘containment’ social ? Écrit l’année 2005 en pleine ère George W. Bush, ce roman ne le laisse pas penser. Le problème est énorme : immigration incontrôlée, sexe à tout va encouragé par la pub, naissances multiples non planifiées, système scolaire inadapté, mafias qu’on laisse se développer faute de moyens…
Mais les solutions existent. Le gamin, pas plus que sa sœur, n’est montré irrécupérable. Cette dernière a failli s’en sortir jusqu’à ce qu’une agression issue de ses actions passées ne la rattrape. « Joel a besoin d’un suivi psychologique tout comme Ness, mais il a besoin de plus que cela. Il a besoin d’une prise en charge sérieuse, d’un objectif, d’un centre d’intérêt sur lequel se focaliser, d’un exutoire et d’un modèle masculin auquel s’identifier. Il faut lui procurer tout cela ou alors envisager d’autres solutions » p.629. CQFD
Elisabeth George, Anatomie d’un crime (What came before he shot her), 2006, Pocket 2008, 764 pages, €7.98

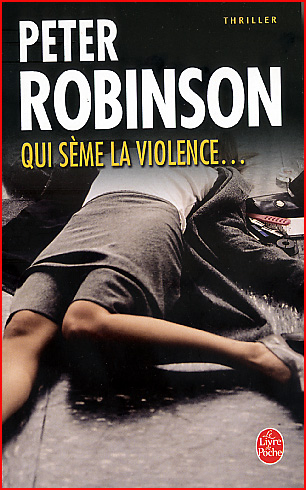
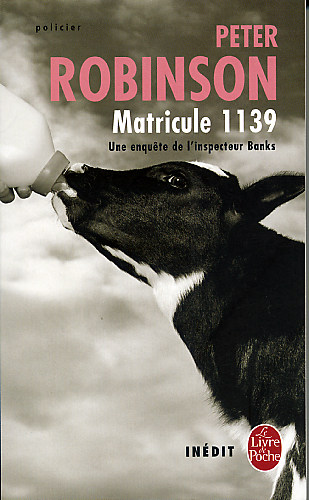

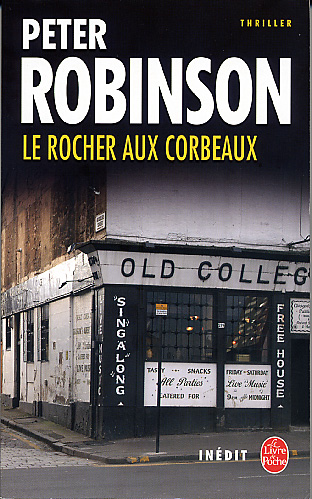



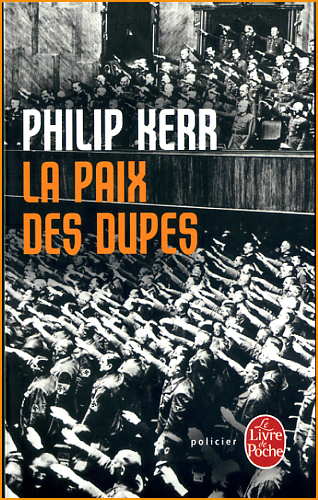
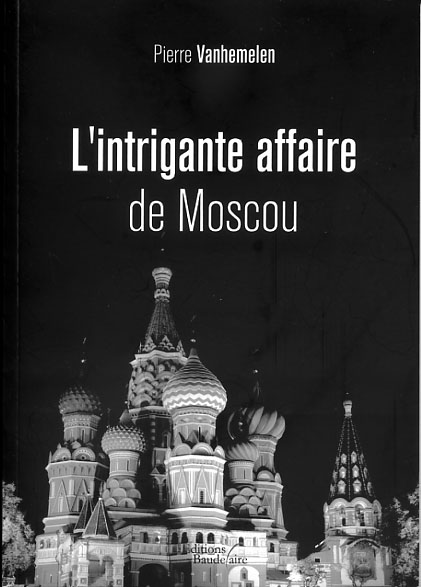
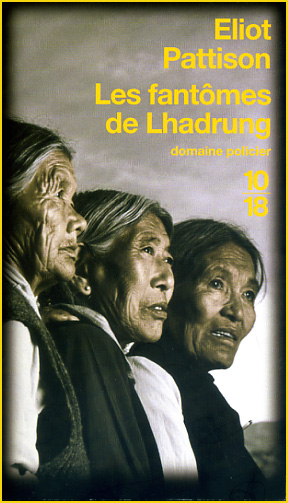

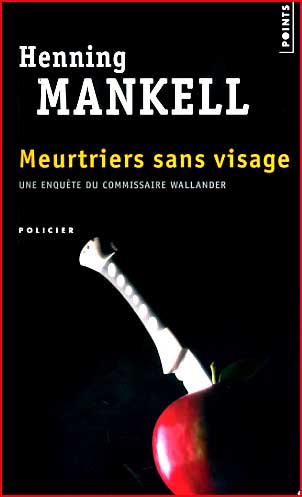


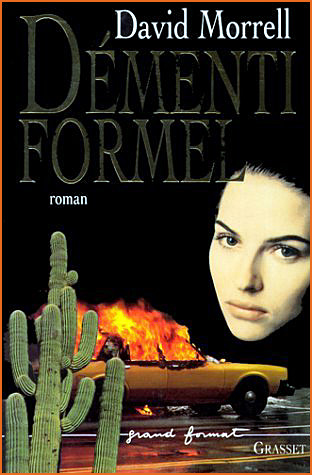
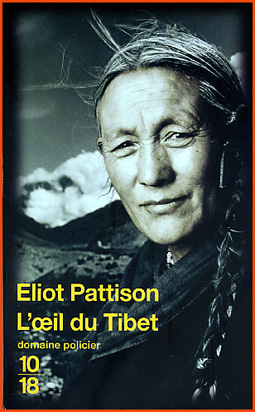


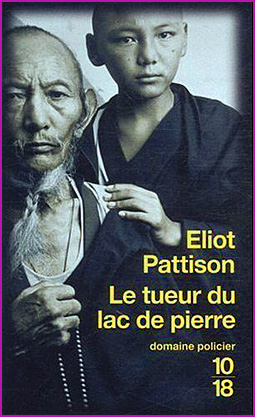


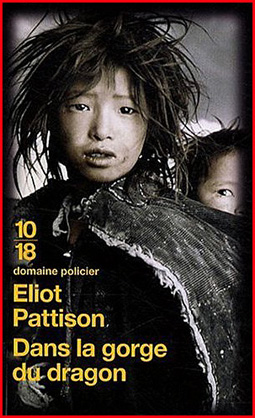



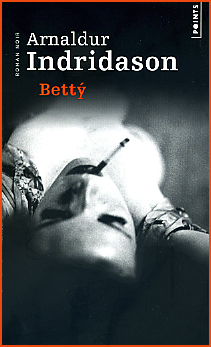
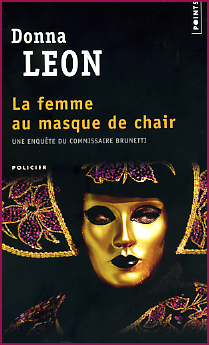


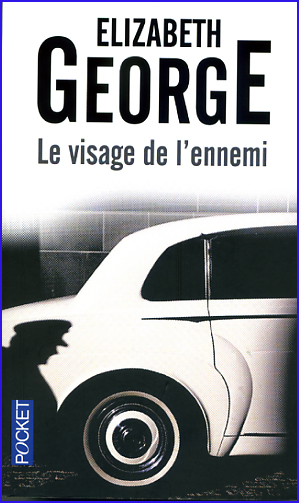



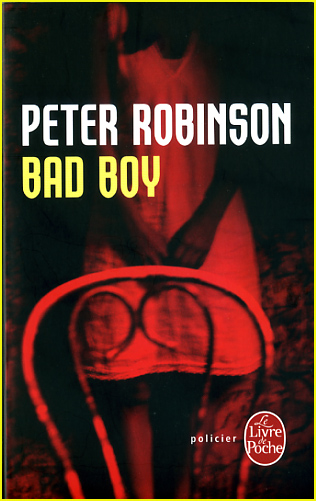


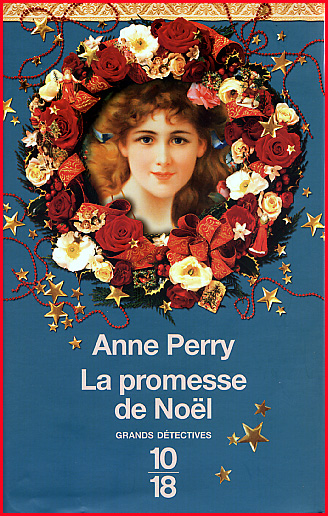

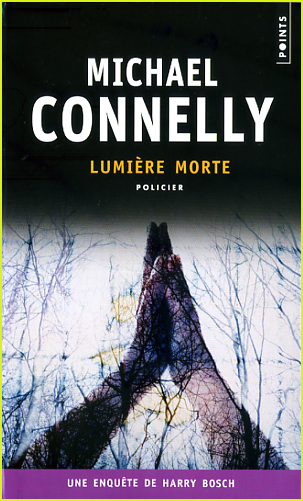
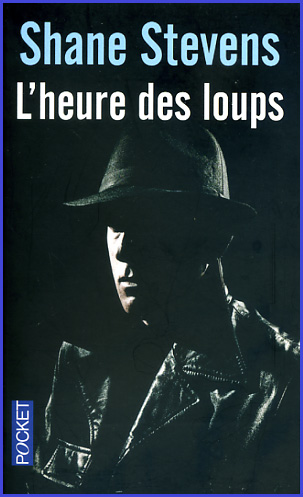
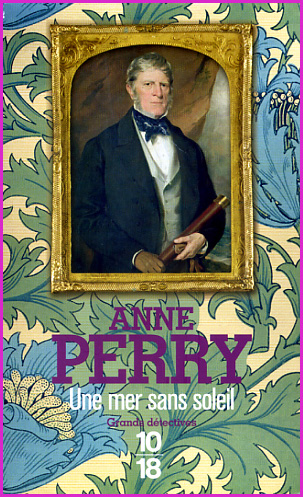
Commentaires récents