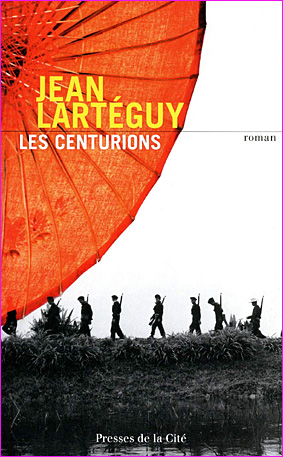
Un roman de journaliste sur le terrain qui a été militaire, comme ceux qu’il décrit. Roman de génération, des adolescents qui ont fait de la Résistance, se sont engagés par patriotisme dans l’armée de Leclerc, puis sont partis défendre l’empire contre le communisme en Indochine, avant de se retrouver piégés en Algérie, département français, où ils ont moins fait « la guerre » que participé à une « opération spéciale » que les politiciens n’ont jamais eu la volonté de gagner.
Le roman se divise en trois parties. La première au Vietnam, où les parachutistes sont confrontés au travail de fourmi du communisme, qui robotise les corps après avoir lavé les esprits. Ils subissent l’humiliante défaite de la cuvette de Dien Bien Phu, une position stratégique indéfendable, que les états-majors en chambre n’auraient jamais dû penser à occuper. Mais, comme en 40, les badernes qui gouvernent ne connaissent pas le terrain. Une fois prisonniers dans les camps de Ho Chi Minh, les officiers sont « rééduqués » par la propagande, et se convertissent fictivement au communisme pour obtenir des avantages, sans en penser pas moins.
Ils découvrent surtout la force du Vietminh : être dans la population comme un poisson dans l’eau. C’est moins « le matériel » (les profs diraient les moyens) que la force morale qui compte. Pour gagner une guerre, il faut faire adhérer la population à ce qu’on défend. Par exemple la perspective du développement, des libertés, voire l’indépendance. Impensable pour les politiciens de la IVe République, soumis aux lobbies coloniaux ou à la corruption du trafic de piastres. Les combattants qui croyaient à leur mission sont abandonnés à leur mouscaille, les familles locales qui leur avaient fait confiance laissées à leur sort maudit. De quoi être amer.
Lorsqu’ils rentrent d’Indochine, une fois la paix signée à Genève, ces officiers ne se reconnaissent pas dans la France consumériste, politicienne et affairiste de la fin des années cinquante. Ces mercenaires de retour d’Indochine et qui vont être envoyés pour rien en Algérie, sont des Réprouvés, comme ceux d’Ernst von Salomon après la défaite allemande de 1918, suivie du nihilisme politique. Raspéguy les décrit, ces camarades : « Je les sais maintenant naïfs et pitoyables, voulant être aimés et se complaisant dans le mépris de leur pays, capables d’énergie, de ténacité, de courage, mais aussi disposés à tout abandonner pour le sourire d’une fille ou la promesse d’une belle aventure. Ils se sont montrés à moi sous leur vrai jour : vaniteux et désintéressés, assoiffés de comprendre et répugnant à s’instruire, malades à en crever de ne pouvoir suivre un grand chef injuste et généreux et d’être obligé de chercher, parmi des théories politiques et économiques, une raison de combattre… qui remplaçât ce chef qu’ils n’ont pu trouver » III.5. Dans la France des années cinquante, les filles ne pensent qu’à jouir, les garçons qu’à faire la fête, et les adultes qu’à gagner toujours plus d’argent – au prix de toutes les compromissions.
Comme celles de soutenir le FLN en sous-main, pour garder des « intérêts » en Algérie quoi qu’il s’y passe, ou aider par idéal niaiseux des terroristes « cultivés », qui résistent eux aussi à l’occupation étrangère en massacrant, dans des affres sexuelles, femmes et enfants blancs. Le propos de l’auteur est anti-communiste, anti-colonialiste, anti-politicien, ces faux-culs qui promettent de garder l’Algérie à la France tout en négociant secrètement avec les massacreurs. Les personnages sont inventés, mais s’inspirent de personnages réels, tels Aussaresses ou Bigeard. Hypocrisie des politiciens de la IVe : en Algérie, le préfet Serge Barret signe le 7 janvier 1957, sur ordre du ministre résident Robert Lacoste, une délégation de pouvoir au général Massu, disposant que « sur le territoire du département d’Alger, la responsabilité du maintien de l’ordre passe, à dater de la publication du présent arrêté, à l’autorité militaire qui exercera les pouvoirs de police normalement impartis à l’autorité civile ». C’était reconnaître l’état de guerre, donc suspendre le droit du temps de paix. Mais « la morale » à Paris était contre, les juges contre la torture, d’où le sentiment d’être une fois de plus abandonnés et piégés, d’où l’OAS.
La contre-insurrection, ou « guerre révolutionnaire » en référence à Mao son théoricien, consiste à faire la guerre autrement. Fini « l’honneur » et le matériel, place à l’efficacité et à la psychologie. Il s’agit moins de gagner du terrain que de gagner les cœurs et les esprits. Fini l’esprit bovin de 14-18 où l’on exécutait les ordres, chargé de barda. Le capitaine Raspéguy : « Moi, je veux des types qui espèrent, qui veulent gagner parce qu’ils sont les plus agiles, les mieux entraînés, les plus malins, et qu’ils tiennent à leur peau. Oui, je veux des soldats qui aient peur, qui ne s’en foutent pas de vivre ou de mourir. Les délires collectifs, très peu pour moi, c’était peut être ça, Verdun ? » II.3.
Les actions militaires doivent s’accompagner d’actions civiles pour rallier la population et la séparer de la guérilla, le renseignement est crucial et non accessoire (y compris le syndrome de la « bombe à retardement »), la guerre psychologique use de la propagande pour donner une perspective sociale aux actions, et pour contrer la propagande adverse, le quadrillage du territoire permet de garder le terrain sous contrôle économique et moral. Le colonel Roger Trinquier en fait un manuel en 1961 (réédité en 2008 avec une préface de François Géré) : La Guerre moderne, mais le roman de Lartéguy donne l’essentiel.
Si les Américains, en Irak et en Afghanistan, avaient appliqué ces méthodes, qui les ont longtemps intéressés, ils ne seraient pas partis la queue entre les jambes après avoir dépensé en vain des millions de dollars (la seule chose qui compte à leurs yeux). Si les Français sous Hollande avaient allié la politique des tribus à l’opération Barkhane contre les islamistes, ils n’auraient pas échoué aussi lamentablement…
Prix Eve Delacroix de l’Académie française 1960
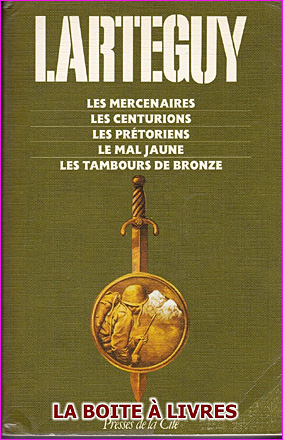
Deux suites aux Centurions : Les Mercenaires 1960, Les Prétoriens 1961 (chroniqués sur ce blog).
Le film américain tiré du roman est nul et ne comprend rien ni à l’Histoire, ni au propos moral de l’auteur.
Jean Lartéguy, Les centurions, 1960, Presses de la Cité 2011, 588 pages, €25,00
Jean Lartéguy, Les Mercenaires – Les Centurions – Les Prétoriens – Le Mal jaune – Les Tambours de bronze, Omnibus 1989, 1200 pages, €74,83
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)


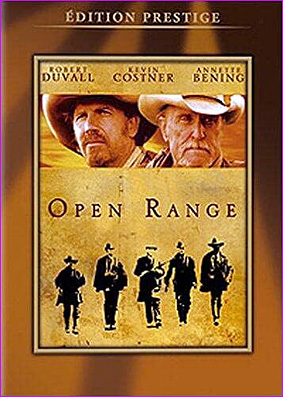










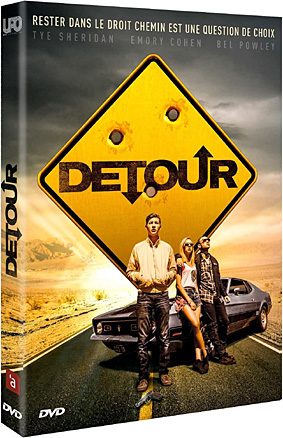










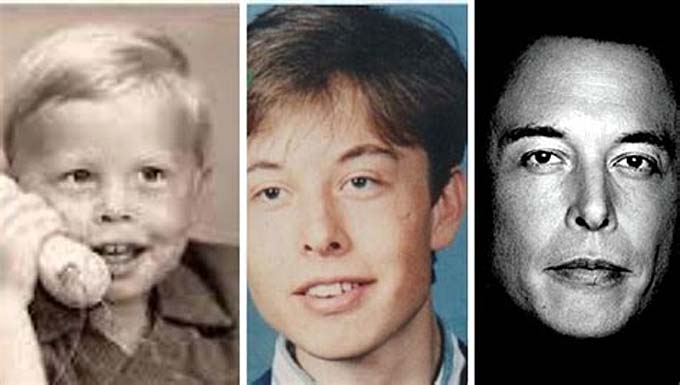








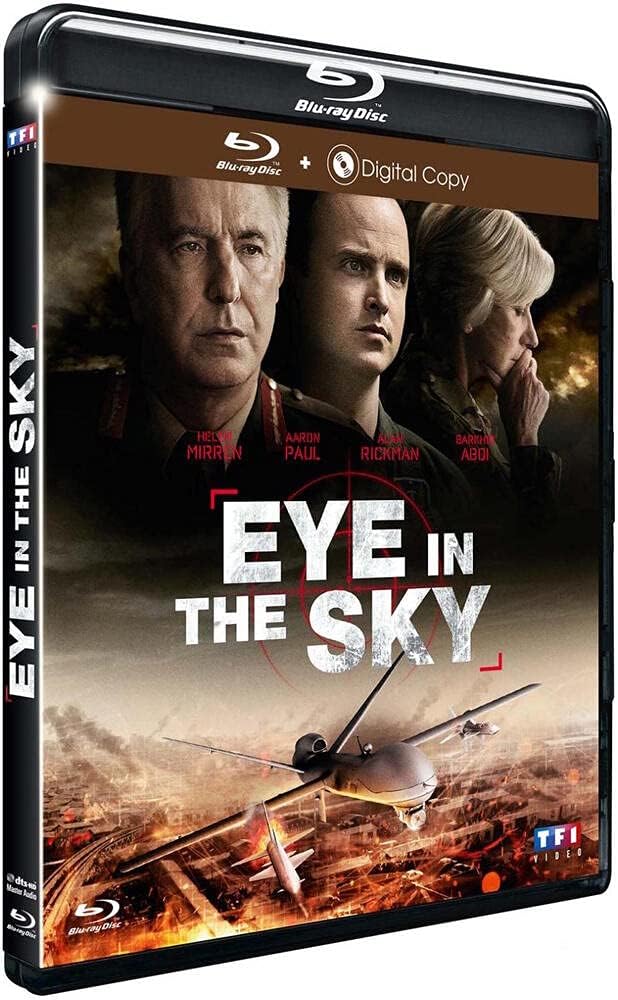







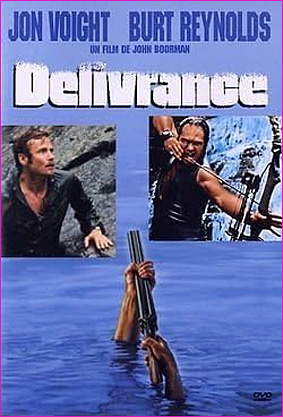





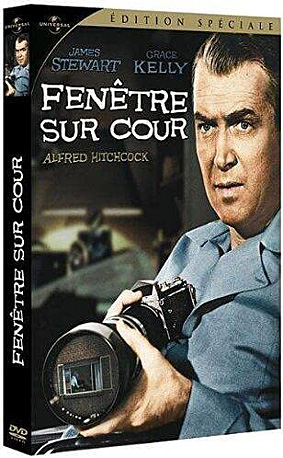













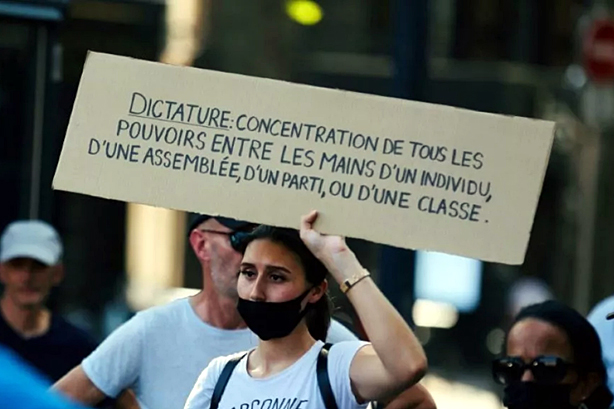
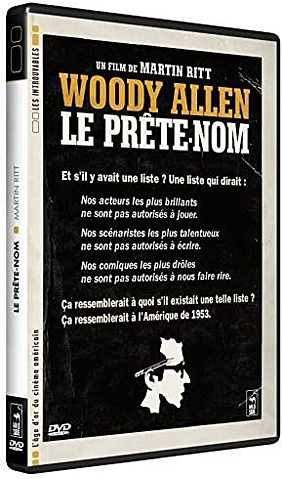











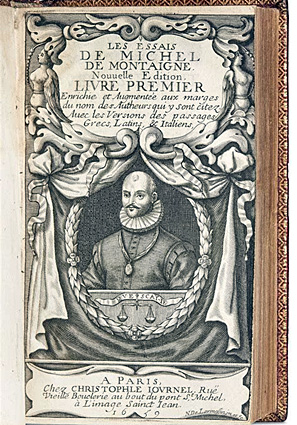

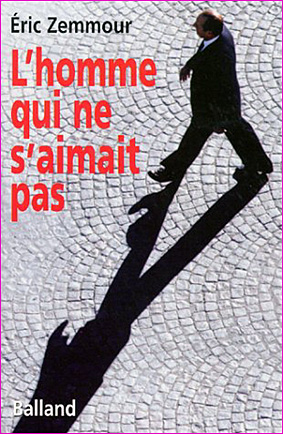


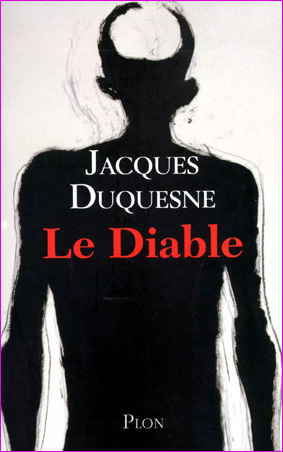


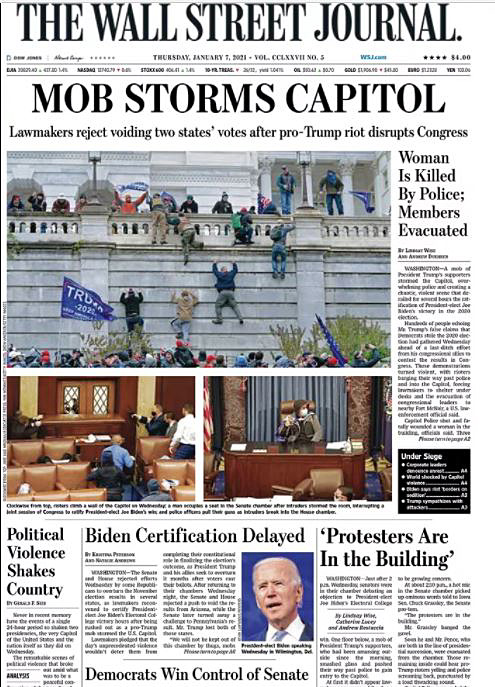
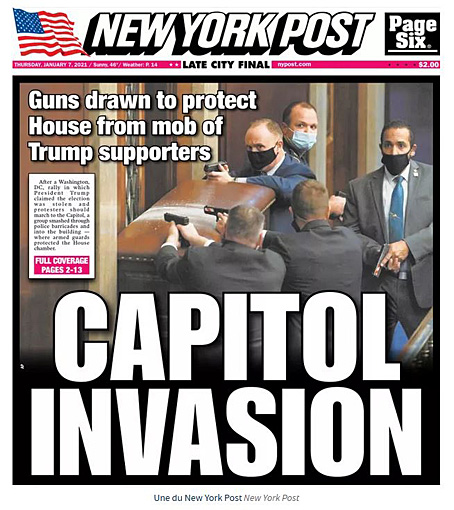

Commentaires récents