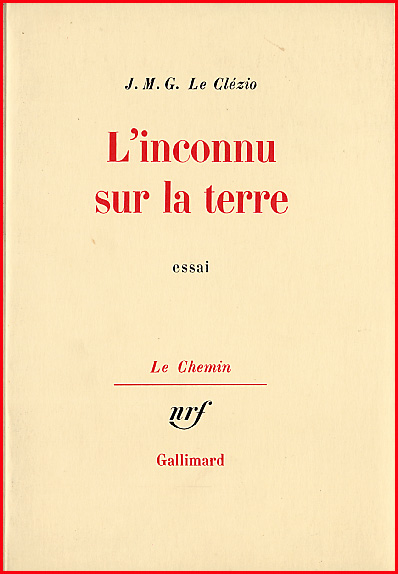 En même temps qu’il écrivait les nouvelles de ‘Mondo’, J.M.G.L.C. (comme il signe la 4ème de couverture) noircissait des cahiers d’écolier italiens d’essais sur la nature et sur les choses, sur la nature des choses et les choses de nature. L’inconnu sur la terre est un petit garçon, celui de Nietzsche, « innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un ‘oui’ sacré » (Ainsi parlait Zarathoustra, Des trois métamorphoses), mais aussi cet élan procréateur qui sourd des hommes lorsque, vers 35 ans, ils n’ont pas enfanté. Jean, Marie, Gustave a cette tendresse absurde pour le gamin de hasard, ses yeux noirs profonds, son corps fragile et sa peau lumineuse. Il appelle son petit prince « le petit garçon inconnu », il en fait ce fils littéraire que Saint-Exupéry, Michel Déon et tant d’autres ont inventé pour combler le manque.
En même temps qu’il écrivait les nouvelles de ‘Mondo’, J.M.G.L.C. (comme il signe la 4ème de couverture) noircissait des cahiers d’écolier italiens d’essais sur la nature et sur les choses, sur la nature des choses et les choses de nature. L’inconnu sur la terre est un petit garçon, celui de Nietzsche, « innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un ‘oui’ sacré » (Ainsi parlait Zarathoustra, Des trois métamorphoses), mais aussi cet élan procréateur qui sourd des hommes lorsque, vers 35 ans, ils n’ont pas enfanté. Jean, Marie, Gustave a cette tendresse absurde pour le gamin de hasard, ses yeux noirs profonds, son corps fragile et sa peau lumineuse. Il appelle son petit prince « le petit garçon inconnu », il en fait ce fils littéraire que Saint-Exupéry, Michel Déon et tant d’autres ont inventé pour combler le manque.
Phénomène d’époque, alchimie de l’auteur, post-modernité : il y a tout cela dans ces essais lecléziens. Bien écrits, malgré l’abus du ‘on’ – cette négation du moi très à la mode après 68 – ces textes montrent l’envers du décor, la trame des romans et nouvelles, l’étonnement qui les fait naître. Ils sont denses, lumineux et font apprécier la démarche de l’auteur.
Le Clézio est un phénomène d’époque. Né en 1940, l’auteur sortait de la jeunesse en 1968 mais il était imbibé des idées du temps, Prix Renaudot à 23 ans pour un premier roman. Mai 68 a marqué la grande révolte contre la société bourgeoise éprise de consommation et prise dans les rets de l’État-providence. Ont été contestés avec vigueur le travail-famille-patrie de l’opinion commune et Le Clézio a bâti sa vie sur ce refus : hédoniste, solitaire, nomade.
Il n’a que mépris pour « notre civilisation moderne (…) Elle qui ose piller les tombes et profaner les lieux saints, elle qui n’a d’autre dieu que son propre savoir, dieu de vanité et de suffisance ; elle qui n’a d’autre foi que celle en sa propre technique, elle qui ne connaît d’autre art que celui de l’intelligence et de l’agression » p.286. Il n’écrit pas pour prouver en logique mais pour communier en sensations. Il n’impose rien, il offre. Il ne crée pas, il rend compte des forces que sont la lumière, les éléments, les astres, la beauté d’un arbre, d’une fleur ou d’un sourire, la vertu d’un être, son élan de vie. Etonnement philosophique qui est le meilleur de mai 68 : « J’aime la lumineuse et pure beauté, celle qui fait voir un monde toujours neuf. Les enfants la portent en eux, dans leurs yeux, sur leur visage, ils la donnent par leur vie, par leurs gestes, leurs paroles. Il y a quelque chose d’inlassable dans leur regard, quelque chose qui ressemble à l’air du matin, après le sommeil. C’est la qualité, la ‘vertu’ » p.241.
 A cette ambiance d’époque, l’auteur ajoute son itinéraire personnel de sans-père exilé, nulle part chez lui. Sensible mais rejeté, il se veut neutre, accueillant le monde et les êtres comme ils viennent. S’il voue un culte à la « beauté », ce n’est pas celle, froide et intellectuelle, des savants qui glosent dans les livres et enferment dans les musées. La beauté, pour Le Clézio est immédiate, elle s’impose ici ou là, au hasard. « La beauté est donnée. Il n’y a rien à acquérir. La beauté n’a pas d’histoire, elle n’est pas la solution d’un mystère. Elle est elle, simplement » p.135. « Mais dans la beauté réelle il y a surtout ceci : l’infini interne. Parfois, je regarde des yeux comme cela, deux yeux dans le visage d’un enfant de cinq ans. (…) Ce sont deux yeux profonds, clairs, qui fixent directement votre regard, qui traversent tout droit l’air transparent de leur lumière que rien ne peut troubler. (…) Ils ne veulent pas juger, ni séduire, ni subjuguer. Ils veulent seulement voir ce qu’il y a et, par les pupilles ouvertes, recevoir en retour le rayonnement de la lumière. Alors dans ces yeux, sans qu’on puisse comprendre pourquoi, on aperçoit soudain la profondeur qui est sous toutes les apparences » p.51.
A cette ambiance d’époque, l’auteur ajoute son itinéraire personnel de sans-père exilé, nulle part chez lui. Sensible mais rejeté, il se veut neutre, accueillant le monde et les êtres comme ils viennent. S’il voue un culte à la « beauté », ce n’est pas celle, froide et intellectuelle, des savants qui glosent dans les livres et enferment dans les musées. La beauté, pour Le Clézio est immédiate, elle s’impose ici ou là, au hasard. « La beauté est donnée. Il n’y a rien à acquérir. La beauté n’a pas d’histoire, elle n’est pas la solution d’un mystère. Elle est elle, simplement » p.135. « Mais dans la beauté réelle il y a surtout ceci : l’infini interne. Parfois, je regarde des yeux comme cela, deux yeux dans le visage d’un enfant de cinq ans. (…) Ce sont deux yeux profonds, clairs, qui fixent directement votre regard, qui traversent tout droit l’air transparent de leur lumière que rien ne peut troubler. (…) Ils ne veulent pas juger, ni séduire, ni subjuguer. Ils veulent seulement voir ce qu’il y a et, par les pupilles ouvertes, recevoir en retour le rayonnement de la lumière. Alors dans ces yeux, sans qu’on puisse comprendre pourquoi, on aperçoit soudain la profondeur qui est sous toutes les apparences » p.51.
L’auteur veut écrire pour dire cela, rien de plus, rien de moins, à la manière post-moderne. Pour être en accord avec le monde, en harmonie avec les forces de la vie qui à tout moment se manifestent. « Je voudrais faire seulement ceci : de la musique avec les mots. (…) Pour embellir mon langage et lui permettre de rejoindre les autres langages du vent, des insectes, des oiseaux, de l’eau qui coule, du feu qui crisse, des rochers et des cailloux de la mer » p.309. Ecrire comme on vit, simplement : « Celui qui danse ne se demande pas pourquoi il danse. Celui qui nage, celui qui marche ne se demande pas ce qu’il fait. L’eau, la terre le portent. Il suit son mouvement, il va de l’avant, il glisse, il s’éloigne. Pourquoi celui qui écrit se demanderait quelque chose ? Il écrit : il danse, il nage, il marche… » p.148
 Nous sommes bien dans le naturel postmoderne, moment où la société sort de la civilisation purement industrielle. « Peuvent-ils vraiment croire que le monde est une leçon à apprendre, ou un jeu dont il suffit de connaître les règles ? Vivre est ailleurs. C’est une aventure qui ne finit pas, qui ne se prévoit pas. (…) C’est comme l’air, comme l’eau, cela entoure, pénètre, illumine (…) Apprendre, sentir, ce n’est pas chercher à s’approprier le monde ; c’est seulement vouloir vibrer, être à chaque seconde le lieu de passage de tout ce qui vient du dehors…(…) Être vide, non pas comme on est absent – le gouffre, le vertige avant la chute – mais en étendant son corps et son âme pour couvrir l’espace » p.133 On reconnaît là le zen, cette pensée orientale redécouverte par les grands physiciens des années 1970 justement, en rapport avec les nouvelles théories du chaos, du fractal et des cordes. Et la vogue écolo, qui est le zen à portée des caniches.
Nous sommes bien dans le naturel postmoderne, moment où la société sort de la civilisation purement industrielle. « Peuvent-ils vraiment croire que le monde est une leçon à apprendre, ou un jeu dont il suffit de connaître les règles ? Vivre est ailleurs. C’est une aventure qui ne finit pas, qui ne se prévoit pas. (…) C’est comme l’air, comme l’eau, cela entoure, pénètre, illumine (…) Apprendre, sentir, ce n’est pas chercher à s’approprier le monde ; c’est seulement vouloir vibrer, être à chaque seconde le lieu de passage de tout ce qui vient du dehors…(…) Être vide, non pas comme on est absent – le gouffre, le vertige avant la chute – mais en étendant son corps et son âme pour couvrir l’espace » p.133 On reconnaît là le zen, cette pensée orientale redécouverte par les grands physiciens des années 1970 justement, en rapport avec les nouvelles théories du chaos, du fractal et des cordes. Et la vogue écolo, qui est le zen à portée des caniches.
Le lecteur trouvera dans ces réflexions denses, parfois ornées de dessins de l’auteur, des pages d’admiration à la Francis Ponge, d’étonnements à la Antoine de Saint-Exupéry ou d’inventaires poétiques à la Jacques Prévert. Il rencontrera (par ordre d’apparition à l’image) la montagne, l’autobus, la route, les insectes, les nuages, l’infini, les paroles, les fumées, les arbres, l’orage, l’air, les rochers, les visages, les oiseaux, les enfants, le pain, les cargos, l’orange, les coquillages, les fleurs, les légumes, le miel.
Mais surtout la lumière, la mer et les étoiles, ces trois pôles leclézien du monde. « Eclairer, illuminer, révéler : les mots de la lumière. Ce sont donc ceux de la magie, de la religion, de la suprême logique, puisque la vérité et la réalité ne peuvent exister que sous le regard de la lumière. ( …) Ce que le langage veut retrouver, avec urgence, lassé des privilèges et des interprétations, c’est cette marche qui irait selon le mouvement du regard : l’aventure simple et tacite, brève, mais intense, comme aux premiers jours après la naissance » p.35. Le lecteur comprendra mieux, dès lors, combien l’apparente simplicité des nouvelles de ‘Mondo’ demande de disponibilité et de travail – juste pour être vrai.
Le Clézio, L’inconnu sur la terre, 1978, Gallimard l’Imaginaire 2001, 317 pages, €9.50
Les livres de Le Clézio chroniqués sur ce blog

















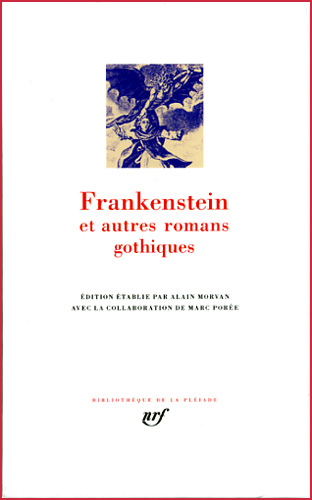
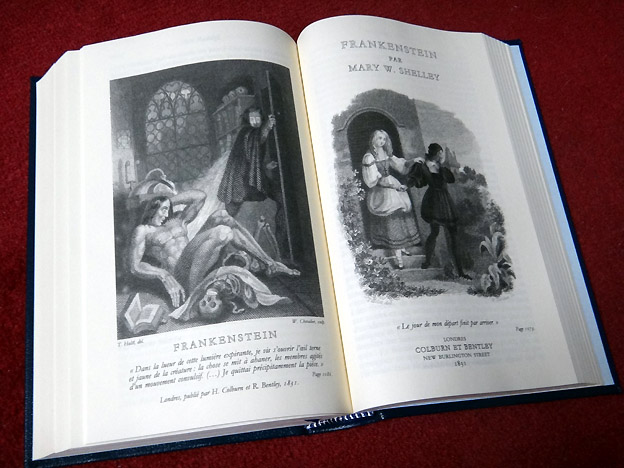
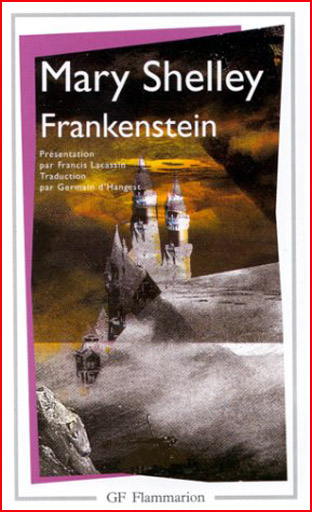
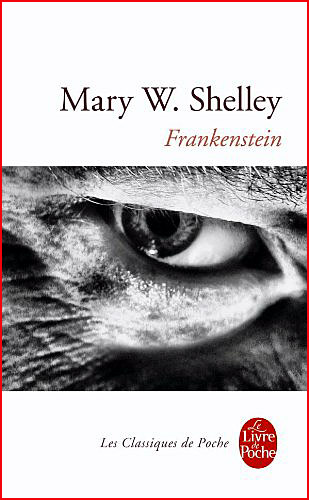
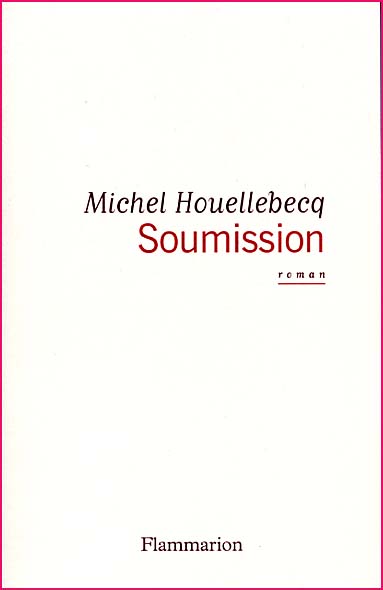
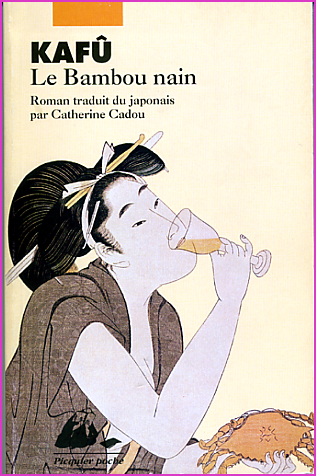
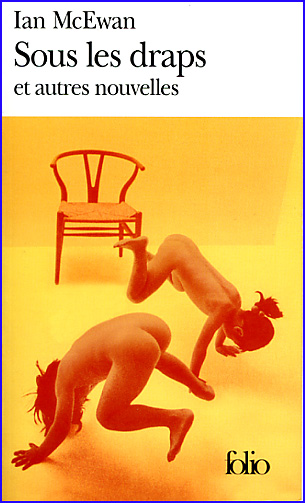
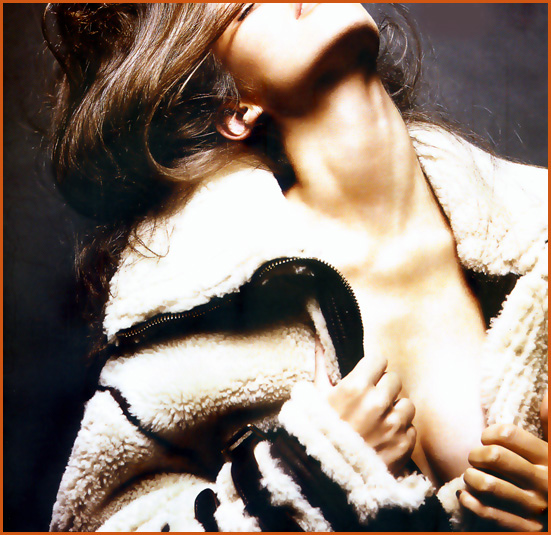
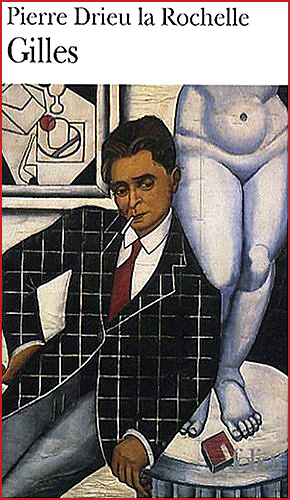











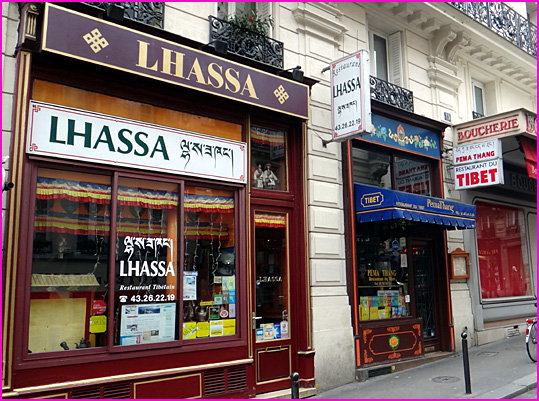




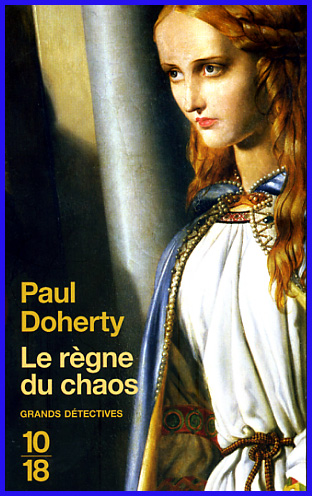

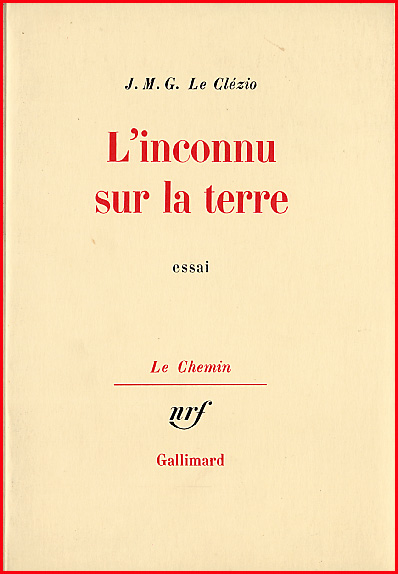





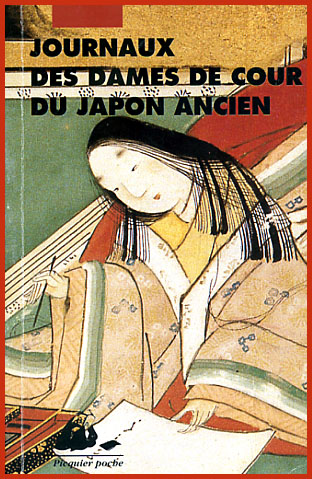

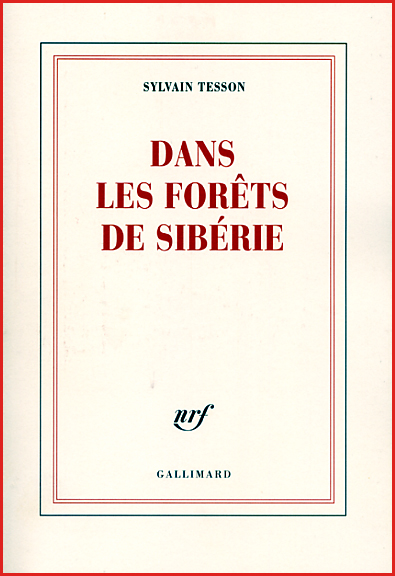

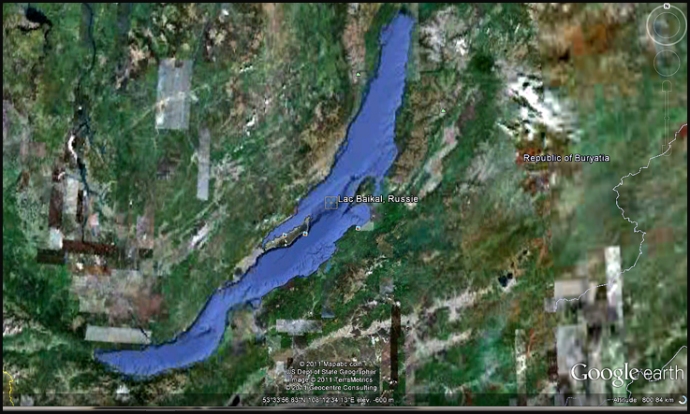
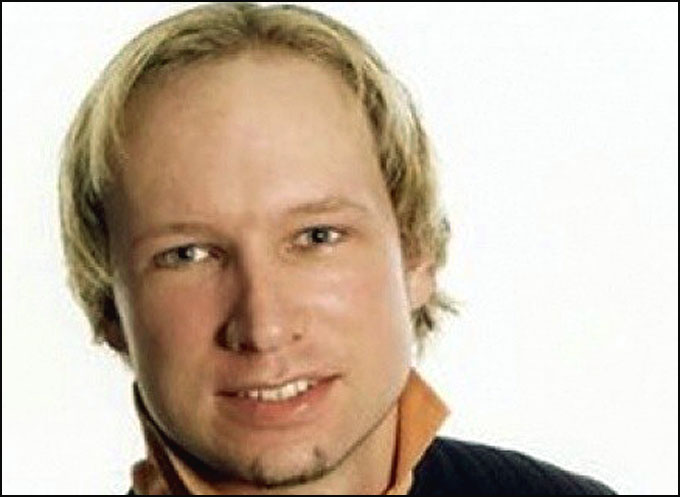
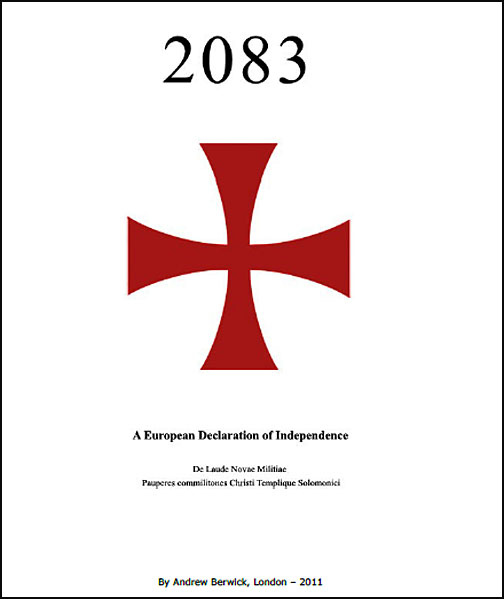










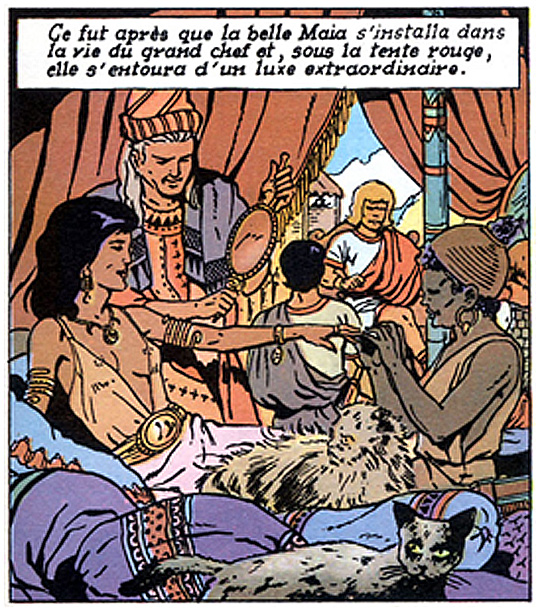
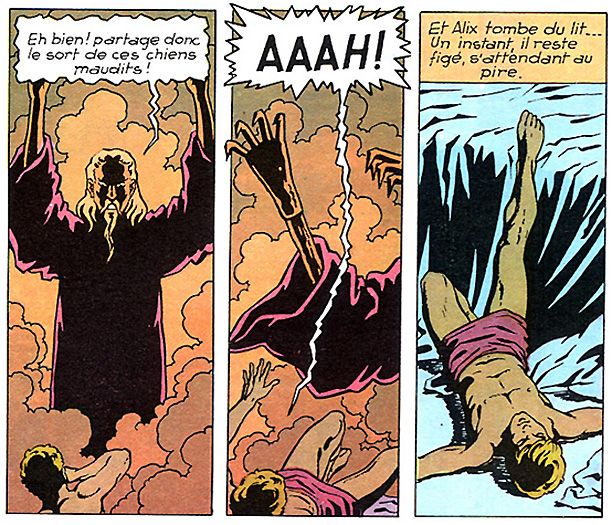

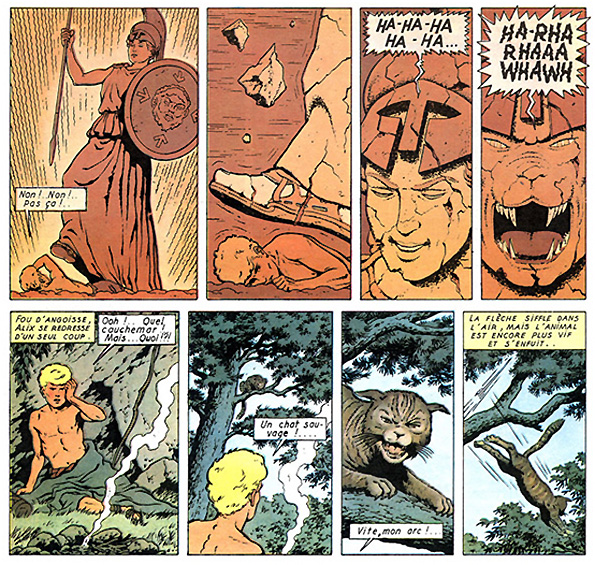
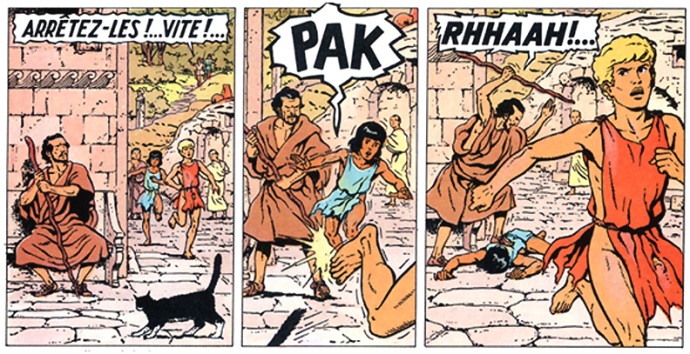

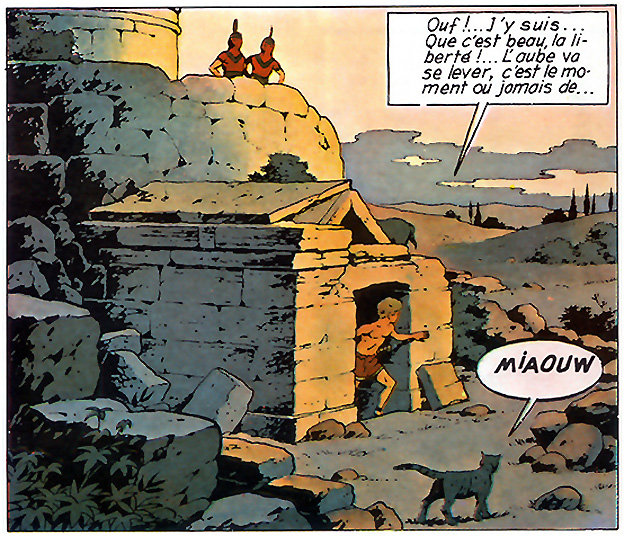
Commentaires récents