Voici le récit d’une Suissesse de 27 ans aussi naïvement allemande qu’obstinément suisse. Cette écervelée tombe raide dingue en 1987 d’un guerrier Massaï qu’elle aperçoit à Mombasa en pagne, paré et torse nu. N’écoutant que sa vulve, elle n’a de cesse que de coucher avec lui. Après cela, de se l’attacher à la Suisse par les liens du mariage. Elle lâche tout, ses affaires, sa famille, son pays, pour s’immerger dans la brousse loin du monde. Ce qui lui importe est seulement d’être prise chaque soir et de passer la nuit entre les bras musclés à respirer l’odeur du mâle.
Moi, lecteur, forcément extérieur au coup de foudre féminin, je prends cet état de fait comme une donnée. Pour le reste, je ne peux qu’être partagé entre agacement et empathie. Agacement pour cette raideur calviniste qui veut que tout soit fait « dans les règles », même les plus manifestes dingueries. Agacement pour cette niaiserie du grand amour sous la case, ce romantisme godiche qui laisse de côté tout fonctionnement d’intelligence. Mais empathie pour cette attirance sexuelle brutale, pour cette puissance immédiate du désir qui sonne comme un destin. Que Corinne s’y abandonne, pourquoi pas ? La jobardise naît plutôt de toutes ses tentatives de justification idéalistes et profondément égoïstes dont elle enjolive le brut appel de la chair. Tous les mythes sont rameutés dans un brouet qui ne donne pas une haute idée de la Suissesse, ni de la femme : le bon sauvage, l’amour-qui-peut-tout, l’envoûtement de l’Afrique, la révolte hippie écologique, la rébellion anti-bourgeoise, le nivellement culturel de tout le monde il est beau tout le monde il est gentil… Le désir primaire ne suffisait-il pas ?
Pourquoi vouloir de force convertir l’Africain guerrier et volage à ses fantasmes de Blanche petite-bourgeoise mal baisée et rêvant au mariage fusionnel ? Les plus belles pages sont de la veine réaliste, les pires sont du rêve égocentrique de la midinette mondialiste. L’attraction virile des muscles Massaï est une évidence bien décrite : « Son visage est d’une beauté si harmonieuse qu’on dirait presque un visage de femme. Mais son attitude, son regard fier et sa musculature puissante ne laissent aucun doute quant à sa virilité. Assis devant le soleil couchant, il ressemble à un jeune dieu » p.9. Le portrait n’est-il pas bien troussé ? Et derechef, la donzelle le piste, le traque, le poursuit. Lui, guerrier de brousse étranger à la ville, en est tout désemparé. Il se laisse faire timidement, la volonté blanche ayant l’obstination d’un sortilège.
Les Massaïs, par coutume, n’embrassent pas, ne touchent pas les femmes sous la ceinture, ne baisent que par assauts brefs et répétés comme des lapins, ne mangent pas avec la gent féminine. Corinne nous énumère ces frustrations avec un souci horloger du détail. Aux femelles de s’occuper des enfants, les mâles passent le plus clair de leur temps avec des guerriers de leur condition. La vie d’une femme compte même moins que celle d’une chèvre. Naturellement Corinne se fait gruger, son capital fond parce que ce son mari ne comprend rien au commerce ni au bénéfice. A vivre en Massaï, Corinne s’anémie, son hygiène devient déplorable. Selon les mythes de la tribu à laquelle Corinne appartient désormais, toute femme est une goule et le fier Lketinga voit en tout autre homme, écoliers pubères compris, un amant potentiel. Il se saoule avec les stocks de bière et souhaite, à la Massaï, promettre la fille issue de leur union à un vieux dès ses 9 ans, après l’avoir fait exciser sans anesthésie… Le mariage « pour la vie » est un désastre.
Mais Lketinga, « avec son torse nu, son pagne rouge et ses longs cheveux roux, est d’une beauté éblouissante » p.32. « Savoir que sous le pagne se trouve directement la peau m’excite beaucoup » p.36. La voilà, l’évidence, et elle est humainement sympathique. Le désir surgit, brut et nu. Pourquoi, dès lors, Corinne veut-elle « se marier » ? Ce n’est pas devant Dieu, dont elle ne parle pas, mais devant la société et pour la bureaucratie. Le lecteur soupçonne, et cela lui est désagréable, une exigence égoïste de ferrer l’amant, d’enchaîner son nègre à son service exclusif. Elle transgresse pour cela les conventions sociales blanches et le revendique parce que cela fait « révolutionnaire » et tiers-mondiste. Mais elle accepte alors la polygamie, le rôle dominé de la femme et les mœurs Massaï d’excision, de baise avec les enfants, et là cela devient irrespectueux, aliénant, colonial. Elle veut garder pour elle « mon chéri » (ainsi écrit-elle sans cesse), l’obliger par contrat, l’enfermer dans une paperasserie irrévocable. Donc se soumettre à ce qui est à ses propres valeurs dégradant.
En Suisse allemande, Corinne ne peut vivre son désir librement, ni accepter la liberté de l’autre. Il faut que tout soit fait dans « ses » règles à elle, celles de la lourdeur précise de son pays : papiers, autorisations, tampons, robe blanche… Et tout cela pour se retrouver arroseuse arrosée, enchaînée à un mari qui a désormais des droits légaux sur elle et sur leur enfant comme sur son capital.
La passion morte, l’obstination l’ayant conduite droit dans le mur, Corinne se trouve obligée de fuir sa destinée comme dans une tragédie grecque, et de quitter le Kenya en usant de procédés illégaux. Une Blanche et un Massaï ne sont pas du même monde et c’est naïveté que de faire comme si, voulant en même temps tout régenter.
Si toutes les Suissesses sont comme cette Corinne, maris potentiels, fuyez !
Corinne Hofmann, La Massaï blanche, 1999, Pocket 2002, 399 pages, €7.60
DVD La Massaï Blanche – d’après le best-seller de Corinne Hofmann, 2005, Hermine Huntgeburth, avec Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint, Lumière, 2h11

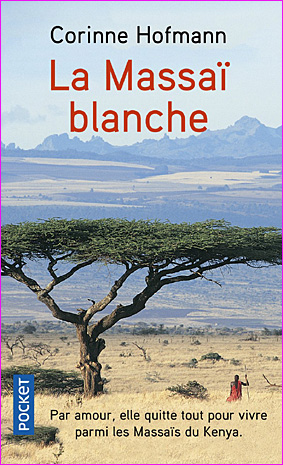
























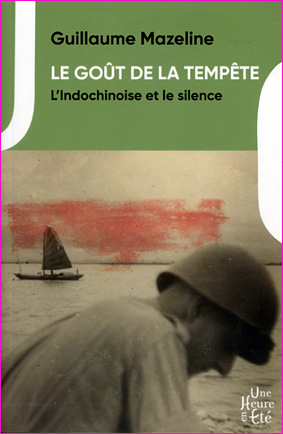


























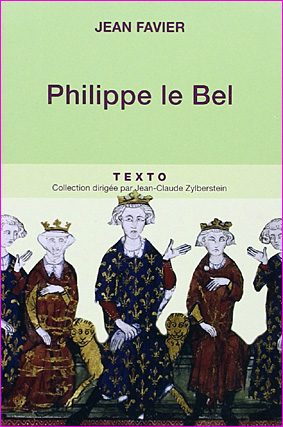





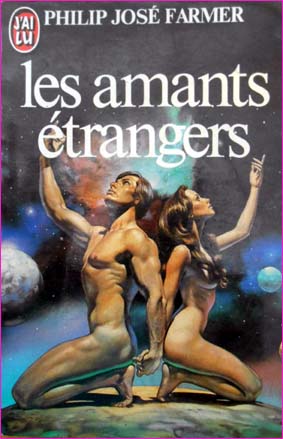

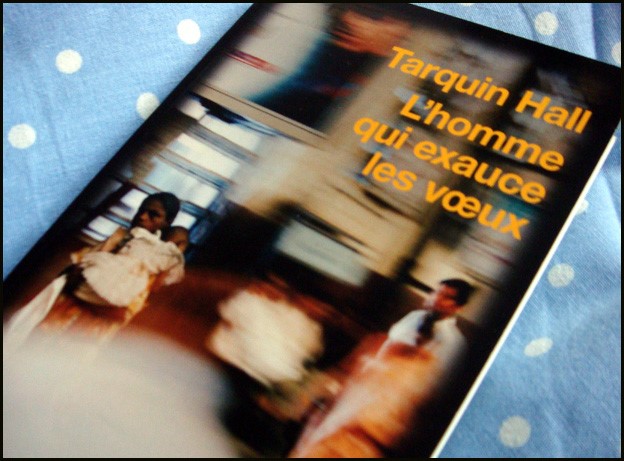








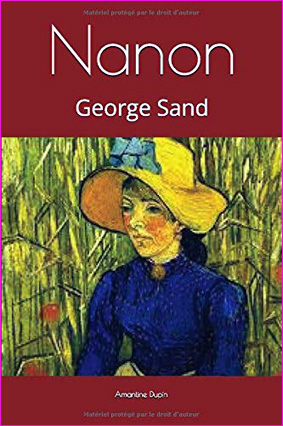


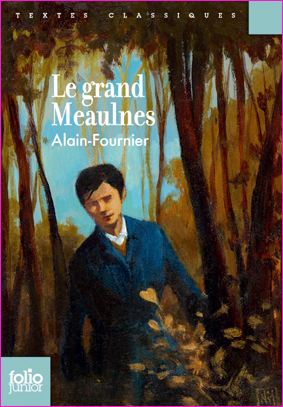
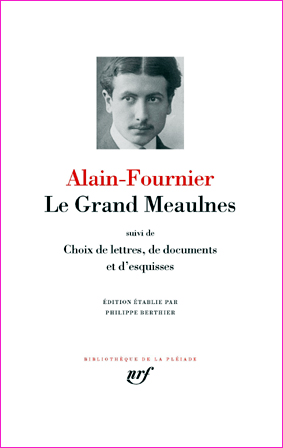
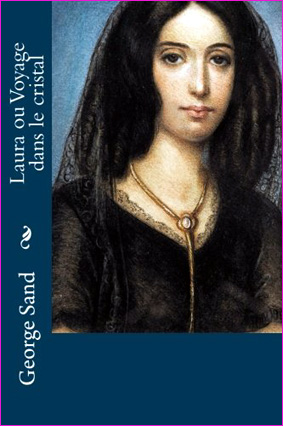


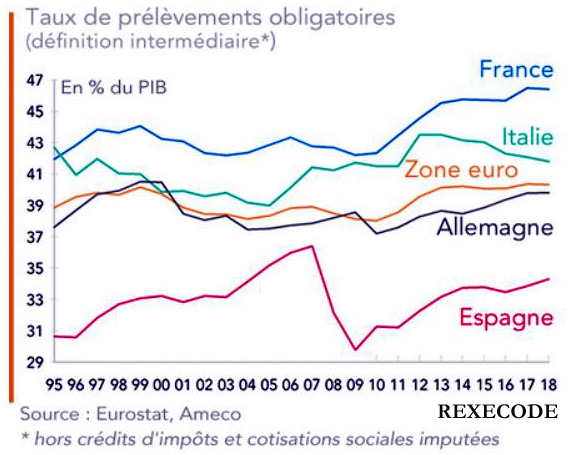
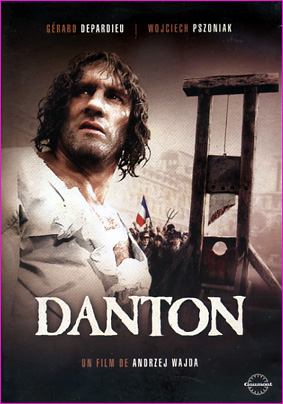






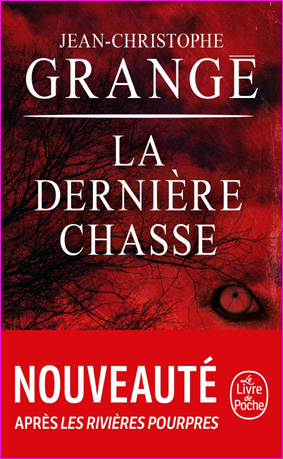









Commentaires récents