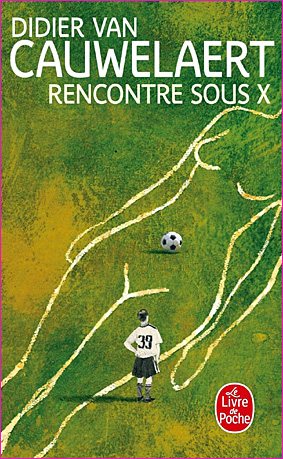
L’auteur adore raconter des histoires inouïes. Il manie le paradoxe à la perfection. Paradoxe que ce joueur sud-africain, mais blanc ; que ce contrat réservé aux majeurs, souscrit par un mineur ; que ce footeux qui ne joue jamais ; que ce riche jeune homme acheté et vendu comme une marchandise ; qu’une cascade de holdings détenus par ses entraîneurs, présidents de club et autres politiciens leur permettent de récupérer la plus grande part de ses gains. Paradoxe encore de tomber amoureux d’une actrice porno lors d’une scène de baise torride où il est la doublure impromptue.
De ces paradoxes, Didier van fait un joli roman. Il décentre la réalité pour nous la faire mieux voir. Avec une ironie féroce, réjouissante.
Ainsi ce milieu pourri du foot télévisé qui exploite les joueurs, les clubs, les sponsors, les hommes politiques, le public.
Ainsi ce cinéma porno industriel qui fait baiser à la chaîne et par tous les trous des filles prêtes à tout pour gagner et des gars prêts à tout pour bander – à l’aide pilules excitantes s’il le faut, au risque de la crise cardiaque s’il le faut.
Ainsi ce « féminisme » qui exige de mettre l’article au féminin pour les fonctions (« la » juge) mais qui « oublie » les expressions communes comme « le bouc émissaire » (« la chèvre », dit le narrateur à « la » juge qui vient de lui faire la leçon, au risque de se faire mal voir).
Ainsi ces injonctions « de santé » aussi assénées que ridicules, nouvelles prières des laïcs en mal de religion : « De toute façon je fume un paquet et demi, je bouffe des vaches folles, des légumes trans, je respire de l’amiante et je me nique le cerveau avec mon portable. Jamais on sait de quoi on crèvera en premier » p.40.
Ainsi cet Hâmour (comme disait Flaubert pour s’en rouler par terre de rire) qui exalte les midinettes soucieuses de coucher avec un champion, mais qui le le voient même plus lorsqu’il redevient ignoré.
Alors, oui, on parle beaucoup de bander, de bourrer, de la lui mettre, de défoncer, d’éjaculer, de sucer, dans ce petit roman par ailleurs bien sous tous rapports. Mais c’est le milieu commercial, l’industrie du sexe comme du foot, qui exige d’employer les mots du métier pour dire le réel.
Lui a 19 ans, elle aussi. Roy vient d’Afrique du sud, Natalia dite Talia d’Ukraine (avant l’invasion russe). Ils ont été pris par l’industrie mondialisée qui les exploite. Lui dans le foot sponsorisé, elle dans le porno. Ils tombent amoureux par le regard, tandis que la mécanique de leurs corps reste détachée, sous le regard des caméras. « Le jour où j’ai rencontré Talia, on a fait l’amour devant quarante personnes. Ensuite, on est allé prendre un verre », écrit l’auteur dans sa première phrase.
Cette « première phrase » d’un roman dit tout du reste selon les critiques pros. Il est vrai que le ton est donné : étonner au risque de choquer, allécher par un paradoxe bien senti jusque dans les fondements, afficher un style direct, sans mots de trop. Et l’histoire se déroule page après page. Faire connaissance, approfondir, jouer au Trivial pursuit, faire raccord.
Jusqu’au finale inattendu, mais au fond inévitable.
Didier van Cauwelaert, Rencontre sous X, 2002, Livre de poche 2004, 252 pages, €7,40, e-book Kindle €7,49
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)
Les romans de Didier van Cauwelaert déjà chroniqués sur ce blog

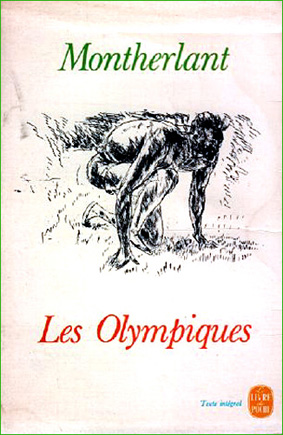






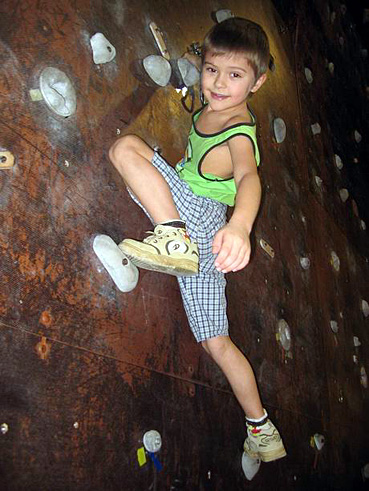


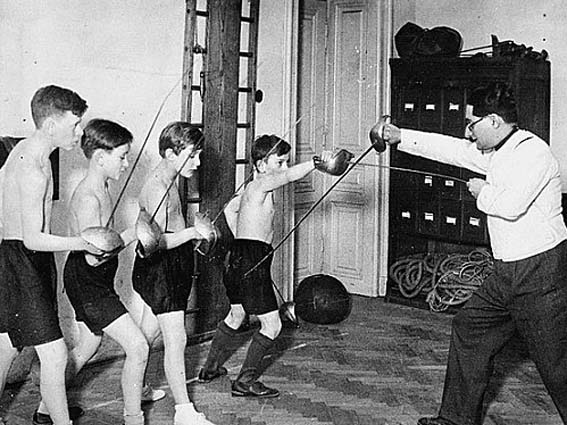


























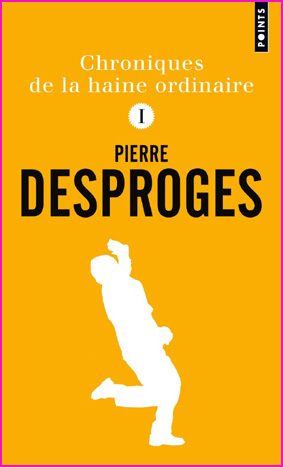
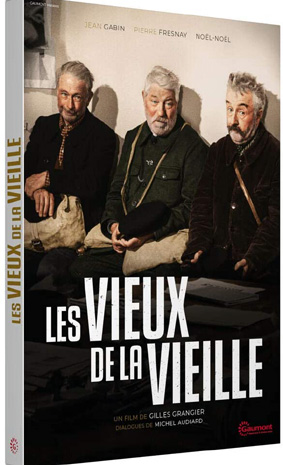






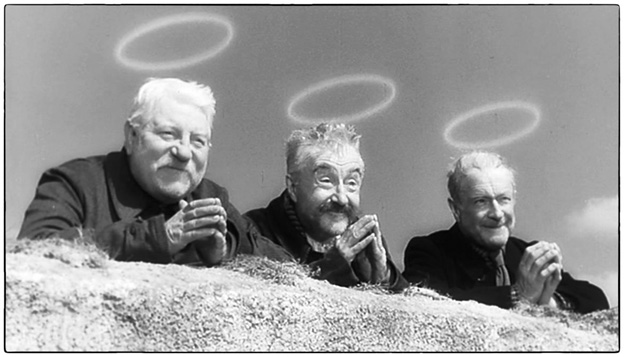

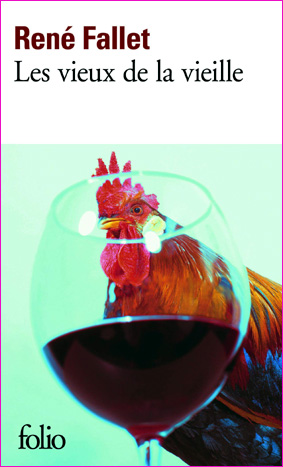














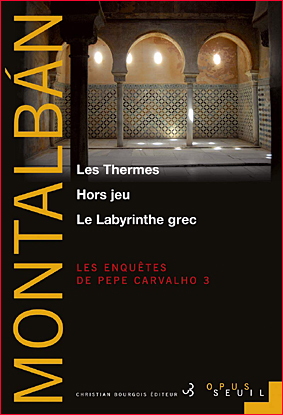

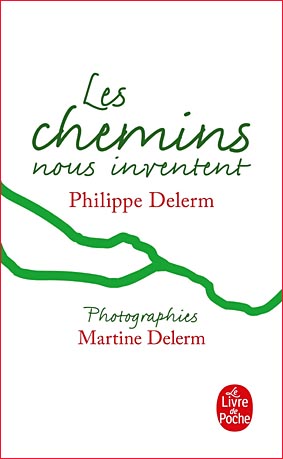






















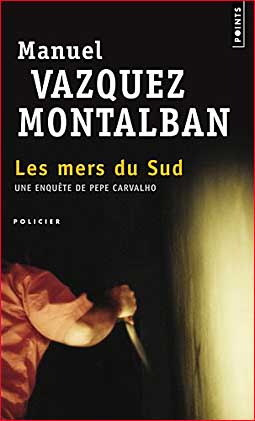
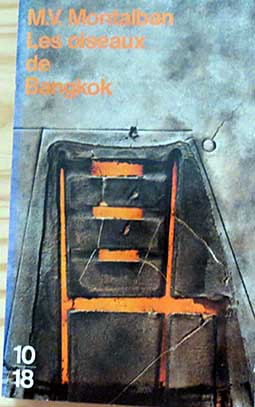
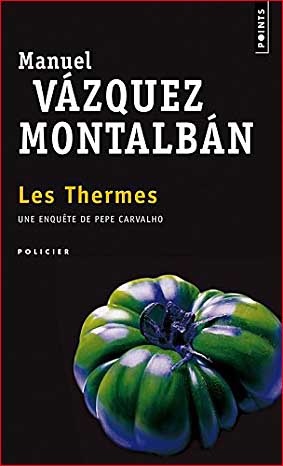

















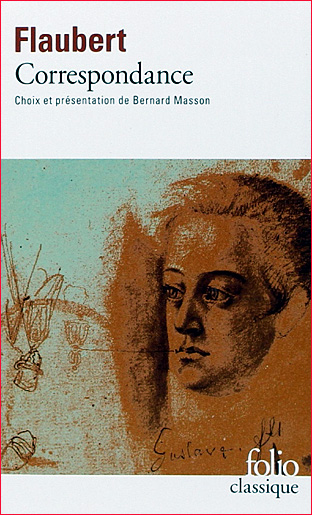




















































Commentaires récents