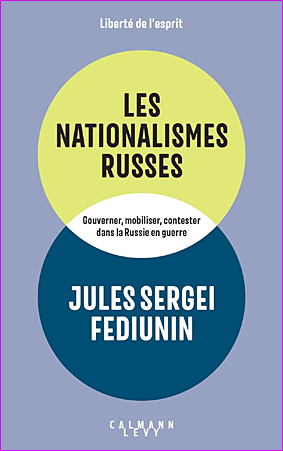
Le nationalisme apparaît trop souvent comme un archaïsme vilipendé et méprisé tant par les humanistes des Lumières, que par les romantiques hugoliens de la « République universelle », et que par l’internationalisme communiste. Hélas ! Il résiste, comme toute réalité ancrée dans les profondeurs de l’humain. L’auteur, docteur en sciences politique de l’Inalco et chercheur post-doc à l’université d’Oslo sur les idées politiques en Russie a enseigné à Sorbonne-Université ainsi qu’à l’Inalco et mené des recherches au CESPRA de l’EHESS. Préfacé par Stéphane Audouin-Rouzeau, historien de la Grande guerre de 14-18 et frère de Fred Vargas, écrivaine de romans policiers, Jules Sergei Fediunin commence par une longue introduction sur ce qu’est « le nationalisme », avant de plonger dans les différentes sectes russes.
Ce nationalisme est idéologiquement bicéphale, comme l’aigle des armoiries tsaristes : un courant stato-impérial voulant dominer des ethnies diverses autour d’un pouvoir centralisé à Moscou considéré comme Etat-civilisation ; un courant ethnocratique porté à valorisé la seule nation russe blanche pour former un État national. Mais cette division masque tout un « écosystème d’acteurs » dans la Russie d’aujourd’hui. Poutine, dirigeant suprême qui se veut dans la lignée de Staline, a louvoyé entre ces courants pour se servir. Il est sans idéologie, en pragmatique exécutant des services de force ; il utilise les idées comme moteur et justificatif de ce qu’il veut : la guerre.
Car Poutine a toujours aimé la guerre, depuis celle de Tchétchénie, ouverte dès ses premiers mois au pouvoir comme nouveau président, étendue ensuite à la Géorgie, à la Crimée, au Donbass, au soutien du régime syrien, jusqu’à cette acmé de l’agression de l’Ukraine en 2022. Sauf que ce « nationalisme de guerre » a son revers : la critique d’un pouvoir trop mou. Evgueni Prigojine s’est mutiné pour cette raison, faisant trembler Poutine. En bon dictateur, il l’a éliminé et réprimé le « nationalisme Z ». Car point trop n’en faut, conserver le pouvoir (et le fric qui va avec) est à ce prix. On a bien vu combien l’armée russe était faible, masquée sous le nombre et l’immensité du territoire.
Mais Poutine a récupéré ce nationalisme pour créer son objet-vaudou : « l’Occident collectif », ennemi héréditaire de la Russie depuis les origines, impérialisme que le « Sud global » doit combattre, l’État-civilisation russe en tête. Si le soutien à la guerre semble minoritaire en Russie (10 à 15 % selon des sondages indépendants début 2024, selon l’auteur), la propagande est intégrée et la méfiance envers « l’Occident » bien installée. Elle agit sur un terreau fertilisé par plus d’un demi-siècle de communisme soupçonneux, qui accusait « la CIA » dès qu’un événement négatif survenait dans feue l’URSS. Nationalisme russe transformé par l’entrée en guerre de 1914 qui a « brutalisé » la société par la banalisation des pratiques radicales des violences de masse contre « l’ennemi étranger », et par l’imaginaire d’une « nation unie et assiégée ». Le « national-étatisme » poutinien enrôle la société civile comme Hitler l’a fait, dès l’enfance, encourageant la xénophobie tout en éradiquant par la prison, le camp ou l’exécution, tout opposant. Car le concept de « guerre totale » de Ludendorff, chef d’état-major des armées allemandes pendant la Première Guerre mondiale, et associé de Hitler avant son arrivée au pouvoir, suppose une implication de la société entière et pas seulement des militaires. La guerre est vécue comme « une crise existentielle collective » et tous les moyens disponibles doivent servir la cause pour conduire à la victoire.
Trois partie, après un introduction substantielle : 1/ Idées et acteurs du « nouveau » nationalisme russe ; 2/ Les nationalismes non et para-étatiques à l’épreuve de la guerre ; 3/ Du nationalisme officiel poutinien.
Passons sur les origines, sur l’opposition du temps de Gorbatchev entre les libéraux plutôt démocrates et les national-communistes plutôt autoritaires, pour en arriver aux années récentes. « Pour les nationalistes orthodoxes comme l’historienne Natalia Narotchnitskaïa(née en 1948), l’empire est d’abord un principe spirituel, associé sur le plan historique à Byzance, avec son principe du césaropapisme. Selon elle, ‘la Russie ne peut être qu’un empire’ car il n’y a aucune contradiction entre le principe national russe fondé sur la tradition orthodoxe et le ‘grand projet’ impérial permettant de renforcer le ‘potentiel historique’ du peuple russe sur les plans démographiques, économiques ou culturels. » Les néo-eurasistes comme Alexandre Douguine font de la position géographique de la Russie, au croisement de l’Europe et de l’Asie, un « pôle de résistance » à la domination atlantiste des États-Unis. Enfin, la mystique impériale d’Alexandre Prokhanov, admirateur de Staline et du complexe militaro-industriel soviétique prône un stalinisme chrétien-orthodoxe et voit dans l’empire russe une symphonie harmonieuse d’espaces, de peuples, de cultures et de systèmes de croyances. Analogue à la « symphonie » (syn-phonia, accord des instruments qui jouent chacun une partition d‘ensemble) à laquelle aspiraient l’empire hellénistique d’Alexandre, la romanité, puis les empereurs de Byzance.
Poutine a choisi dans le catalogue des idées celles qui convenaient le mieux à la stabilité de son pouvoir personnel. « Ainsi, les expressions politiques des ethno-nationalistes sont systématiquement exclues, et les manifestations violentes réprimées. Ces acteurs non étatiques sont jugés trop autonomes du fait de leurs convictions, ou trop dangereux. En revanche, les nationalistes d’obédience étatistes ou impérialistes sont tolérés et, pour certains, cooptés par le régime, dans la mesure où ils acceptent la domination du régime en place ou mieux encore, glorifie ses bienfaits. » Les révolutions de couleur, dont la révolution orange en 2004 en Ukraine, « sont interprétées comme une menace majeure aux intérêts russes dans son ‘étranger proche’ et, par delà, à la stabilité même du régime russe. »
Dès ses débuts, Poutine a valorisé l’État et la notion de grande puissance. « Le poutinisme, c’est aussi un ‘code’ fait d’idées, d’attitudes propres – le désir du contrôle, le culte de la loyauté ou la quête de l’unité, par exemple – ainsi que d’une gamme d’émotions comme le respect, le ressentiment ou la peur. » Ce nationalisme poutinien relève d’une passion de gouverner qui est un désir de jouir du pouvoir. Le conservatisme a été continuellement revendiqué, mais la posture anti-occidentale affirmée progressivement.
« Soutenu par l’Église orthodoxe russe et le patriarche Kyrill, intronisé en 2009, Vladimir Poutine s’est (…) érigé en défenseur des valeurs dites traditionnelles, centrées sur le stéréotype d’une famille hétérosexuelle stable et nombreuse ». Ce n’est qu’au fil des années que l’Occident en est venu à incarner l’éternel ennemi dans le discours du Kremlin. La Russie cherche à se distinguer et à faire valoir son statut de puissance. « Car, historiquement, la Russie n’aurait aucune raison d’être une nation si l’Occident n’existait pas ». Vladislav Sourkov a théorisé une vision autoritaire de la démocratie qui refléterait la spécificité historique et culturelle de la Russie. C’est un système politique dirigé par une élite mandatée par le peuple, pour assurer la puissance et l’identité dans un monde globalisé. Cette doctrine apparaît peu après les révolutions de couleurs entre 2003 et 2005 et promeut une nouvelle normalité de démondialisation, re-souveranisation et nationalisme. En 2013, Poutine a explicitement cité le philosophe conservateur Konstantin Leontiev de la fin du XIXe siècle, qui considérait la civilisation russe comme « une complexité fleurissante. »
« Selon Poutine, les Occidentaux auraient nié les principes moraux et toute forme d’identité traditionnelle : nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle. » Il oppose la mentalité russe spirituelle à une mentalité occidentale individualiste, voire égoïste. Les Russes seraient de « vrais » Européens, attachés aux valeurs traditionnelles que l’Europe délaisse : la morale chrétienne contre l’amoralisme libéral de la ‘Gayrope’ défendant les droits LGBTQIA+ et promouvant le multiculturalisme. Poutine poursuit des stratégies de légitimation contre la pression idéologique occidentale. Au XIXe siècle, on craignait la contagion des idées républicaines ; aujourd’hui, on répudie la démocratie imposée, le droit-de-l’hommisme hypocrite et l’interventionnisme humanitaire de la politique extérieure occidentale (Yougoslavie, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie). « Le poutinisme se lit comme une réaction identitaire plus ou moins systématique au projet libéral-démocratique de l’Occident, dont l’imitation serait nuisible au développement d’une culture et d’une forme politique authentiquement russe. »
Néanmoins, « le Kremlin n’est pas parvenu à formuler une doctrine cohérente et codifiée. (…) Mais une idéologie en tant que forme vide ou technologie de domination qui fonctionne comme un ensemble de pratiques performatives. » Autrement dit, la seule chose qui compte est la stabilité, intérieure en éradiquant toute opposition, extérieure en imposant un glacis d’inféodés, pour garder le pouvoir.
Un livre utile pour démêler les discours idéologiques venus de Russie – comme des naïvetés des éternels commentateurs occidentaux, qui se précipitent pour donner leur opinion alors qu’ils ne savent pas grand chose.
Jules Sergei Fediunin, Les nationalismes russes, Calmann Lévy 2024, 368 pages, €22,50, e-book Kindle €15,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

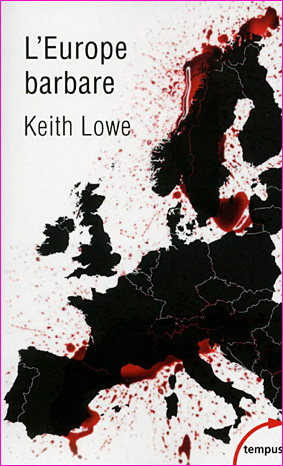






















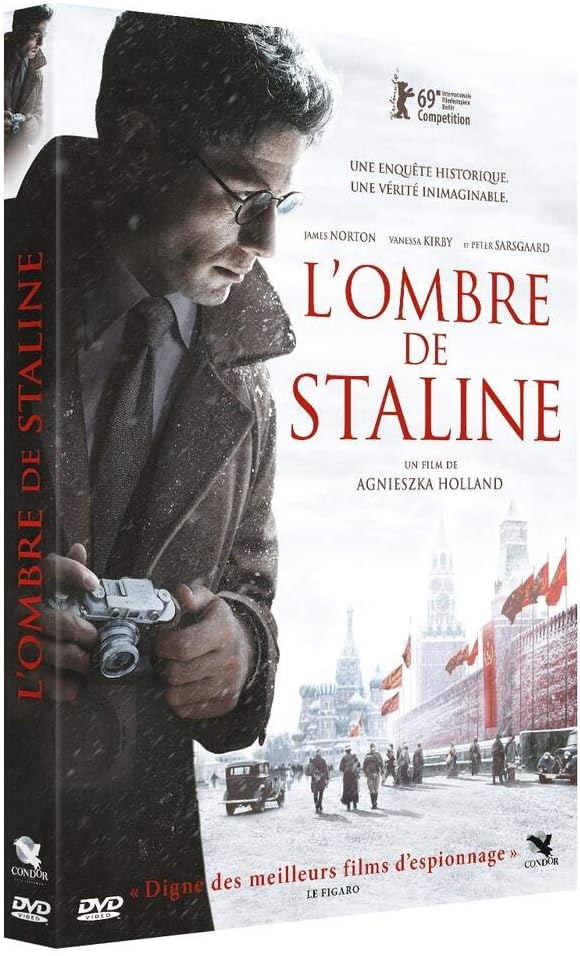











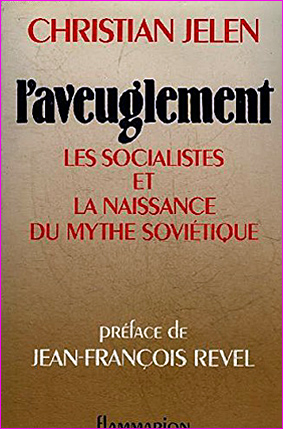



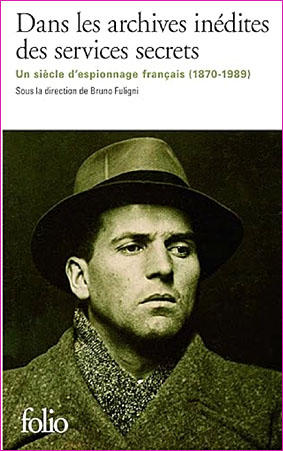







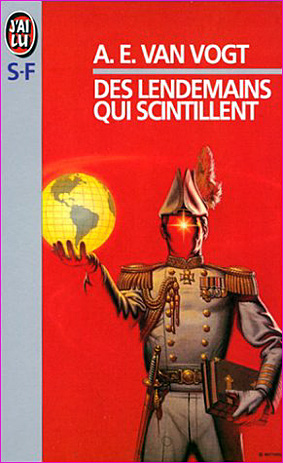



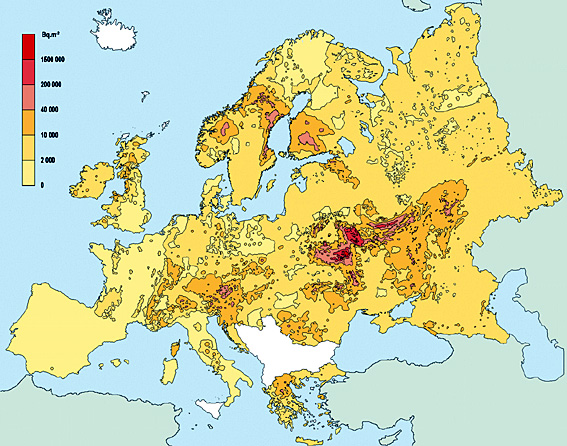
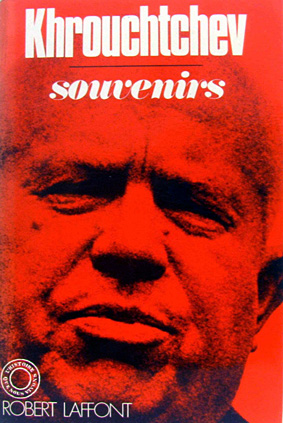



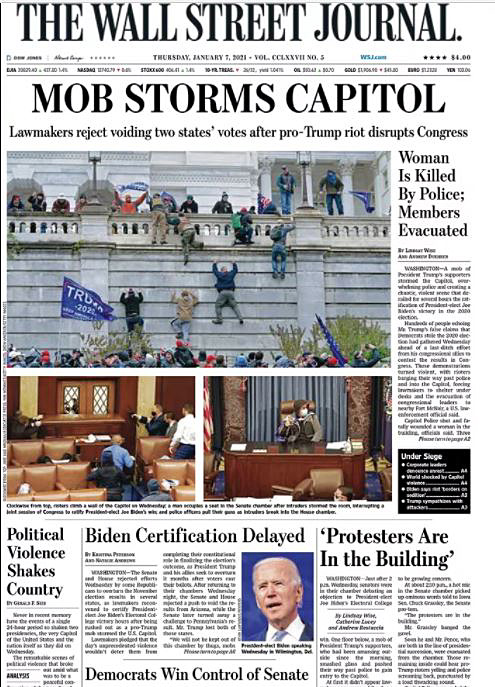
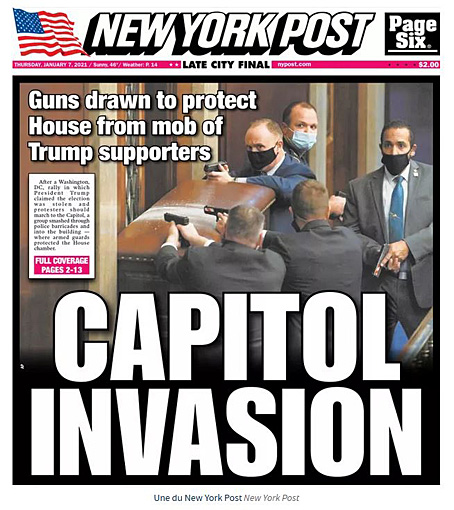









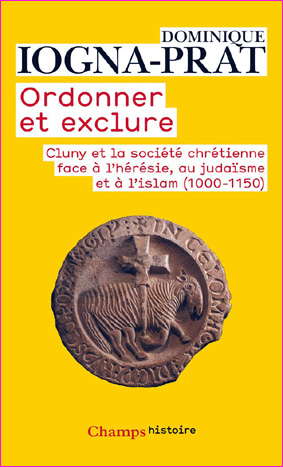
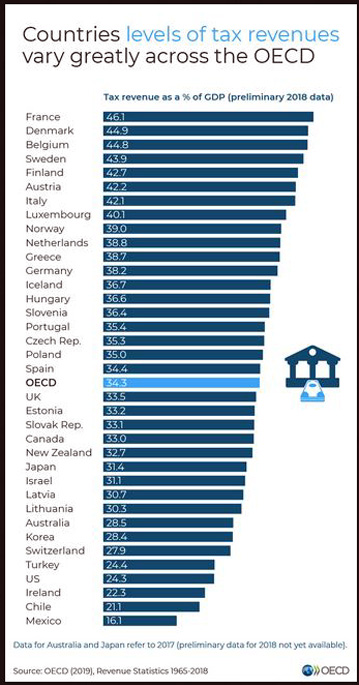
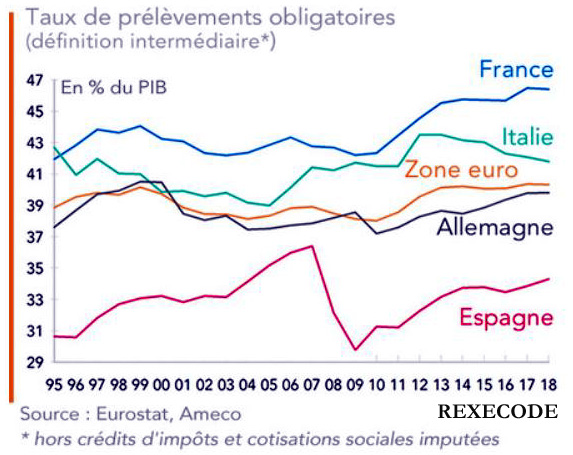
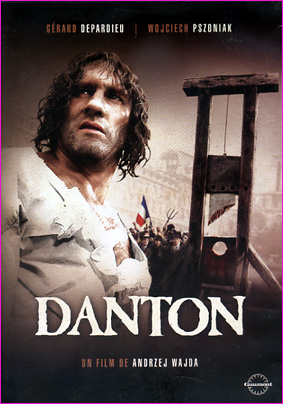























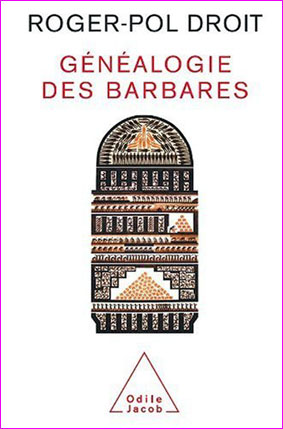
Commentaires récents