Ni yogi, ni commissaire, refusant à la fois l’indifférence individualiste et la contrainte d’État, Albert Camus définit la condition humaine comme une tension permanente. Nous ne vivons pas dans un monde de dieux, le parfait ne saurait exister, le Bien en soi est inaccessible. Nous sommes humains, trop humains et devons faire avec. C’est cela, l’extrémisme de la mesure – cet oxymore.
Dans L’Homme révolté, en sa cinquième et dernière partie intitulée, en hommage à Nietzsche, La pensée de midi, Camus récuse ceux qu’il appelle « les tortionnaires humanistes », ceux qui veulent faire le bien des autres malgré eux, qui vous imposent leurs normes, leur morale, leurs conduite – et qui vous dénoncent à l’inquisition d’église, d’État ou des médias si vous n’êtes pas comme eux. « La révolte n’est-elle pas devenue (…) l’alibi de nouveaux tyrans ? » s’interroge Camus. Le conformisme du rebelle ne s’impose-t-il pas comme nouvelle règle pour être bien vu ?
La révolte est un mouvement de liberté des êtres doués de vie. Mais si le rebelle se rend libre par sa révolte contre l’ordre établi injuste, il risque d’aller trop loin – au détriment de la justice qu’il exige. Ce pourquoi les révolutions dévorent leurs enfants, ne s’arrêtant que lorsqu’une nouvelle caste de maîtres impose sa force. « Le nihiliste confond dans la même rage créateur et créatures » ; au bout d’un temps, la réaction de la société va vers l’ordre, car nulle société ne peut vivre longtemps sans paix pour élever les enfants. Et voilà les révoltés bien avancés, sommés de rentrer dans le rang ou de feindre la révolution permanente pour rester dans la ligne. Leur liberté n’est plus, ils sont esclaves du nouveau tyran ; leur justice n’est pas, puisqu’ils n’ont fait que renverser l’ordre établi pour en établir un autre.
A l’inverse de cette attitude adolescente, montre Camus, « la complicité et la communication découvertes par la révolte ne peuvent se vivre que dans le libre dialogue, tout révolté, par le seul mouvement qui le dresse face à l’oppresseur, plaide donc pour la vie, s’engage à lutter contre la servitude, le mensonge et la terreur, et affirme, le temps d’un éclair, que ces trois fléaux font régner le silence entre les hommes. » La révolte fait le procès de la liberté totale, celle de tuer : elle est incompatible avec les raisons mêmes de se révolter, qui sont l’exigence de justice pour tous les hommes. Est-ce leur faire droit que de les tuer, de les nier en tant qu’humains comme les autres ? Ce pourquoi Camus est resté résolument contre la peine de mort, même pour les grands criminels et tyrans. « Le révolté veut qu’il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain, la limite étant précisément la capacité de révolte de cet être. »
Ni la liberté, ni la justice, ne sont absolues : seul le sens des limites est absolu. « Le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui-même ; mais en aucun cas, s’il est conséquent, le droit de détruire l’être et la liberté de l’autre. Il n’humilie personne. » Il faut savoir se restreindre pour rester libre, canaliser ses instincts, maîtriser ses passions, juger en raison. « Sa seule vertu sera, plongé dans les ténèbres, de ne pas céder à leur vertige obscur. » Est-ce facile ? Non. Est-ce pour cela qu’il faut évacuer la question ? Non.
« S’il y a révolte, c’est que le mensonge, l’injustice et la violence font, en partie, la condition du révolté. Il ne peut donc prétendre absolument à ne point tuer ni mentir sans renoncer à sa révolte, et accepter une fois pour toutes le meurtre et le mal. Mais il ne peut non plus accepter de tuer et de mentir, puisque le mouvement inverse qui légitimerait meurtre et violence détruirait aussi les raisons de son insurrection. » Si la liberté absolue revient au droit du plus fort, la justice absolue veut la suppression de toute contradiction – c’est entre ces deux pôles que se situe la mesure. Ni perpétuer l’injustice par la domination totale des puissants, ni détruire la liberté par le nivellement absolu. L’être humain est imparfait et sa philosophie doit être celle des limites. L’être humain adulte, pas l’adolescent qui ne connaît rien des limites et les teste, jusqu’à ce qu’il les trouve.
Ce sont les pensées nihilistes, selon Camus, qui sont hors limites. « Rien ne les arrêtent plus dans leurs conséquences et elles justifient alors la destruction totale ou la conquête infinie. » La société industrielle, issue des révolutions des Lumières, infantilise les hommes ; elle a tendance, par sa complexité et par son exigence de responsabilité personnelle, à rendre l’adolescence plus longue. Et ce sont les adolescents qui constituent l’essentiel des mouvements révolutionnaires, anarchistes, nihilistes. Aux humains adultes, hommes et femmes, de rappeler les limites d’une vie en société, cette fameuse « fraternité » de la trinité républicaine : liberté, égalité, fraternité. Ni le droit de tout faire, ni la négation de toutes différences – seule la fraternité unit la tension permanente entre exigence de liberté et d’égalité.
Mais les religions aussi sont nihilistes, y compris les religions laïques comme le communisme ou le droit-de-l’hommisme : elles nient tout ce qui n’est pas en elles, elles récusent tout ce qui est contraire à leur dogme, elles massacrent avec plaisir et bonne conscience tous les mécréants – ceux qui ne croient pas comme eux. Le christianisme sous l’Inquisition, le catholicisme à la saint Barthélémy, le marxisme sous Lénine, Staline et Trotski, le maoïsme sous le règne de l’Instituteur promu, le castrisme sous la férule de l’ex-séminariste, le polpotisme sous les Khmers rouges, l’islamisme sous les Chiites d’Iran ou de Syrie et les Sunnites d’Arabie Saoudite ou d’Afghanistan – et même le politiquement correct qui tue médiatiquement dans nos sociétés si policées…
Toute pensée et toute action qui dépasse un certain point se nie elle-même. Telle est la dialectique de la révolte : « En même temps qu’elle suggère une nature commune des hommes, la révolte porte au jour la mesure et la limite qui sont au principe de cette nature. » Tout ce qui est réel n’est pas rationnel et ce tout qui est rationnel n’est pas réel. C’est dans cette ombre d’incertitude et de probable que se situe la mesure. Et Camus en fait une norme de conduite, un extrémisme anti-extrême.
En politique, pour la vie de la cité, Albert Camus distingue ceux qui veulent faire le bien des gens malgré eux et ceux qui s’unissent pour faire le bien ensemble. « Le syndicalisme, comme la commune, est la négation, au profit du réel, du centralisme bureaucratique et abstrait. » Ni la gauche jacobine, ni la gauche collectiviste, ne sont libératrices – comme le dit si bien Jacques Julliard. Seule la gauche libertaire et la droite libérale libèrent : parce que tous deux mettent la mesure au centre de la politique et la justice en balance avec la liberté.
Les oppositions pointées par Albert Camus éclairent son propos :
- L’idéologie allemande vs l’esprit méditerranéen,
- Le romantisme adolescent vs la maturité virile,
- L’État vs la Commune,
- La société absolutiste vs la société concrète,
- La tyrannie rationnelle vs la liberté réfléchie,
- La colonisation des masses vs l’individualisme altruiste,
- Minuit vs midi.
Camus était libéral, de gauche mais épris de liberté, ce qu’on appelle un libertaire – bien que mai-68 ait galvaudé ce terme en le réduisant à l’hédonisme médiatique, content de soi et parfaitement bourgeois. Camus a encore des choses à nous apprendre sur notre temps.
Albert Camus, L’Homme révolté, 1951, Gallimard Folio essais, 240 pages, €7.41
Albert Camus, Œuvres complètes tome 3, Gallimard Pléiade 2008, édition Raymond Gay-Crosier, 1504 pages, €66.50
L’homme révolté de Camus sur ce blog
Les autres œuvres de Camus chroniquées sur ce blog

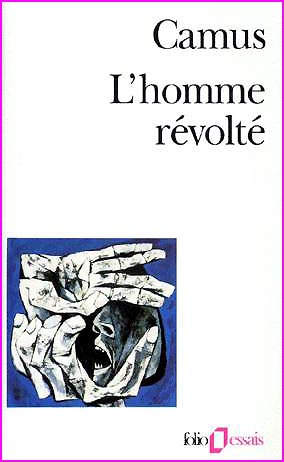






























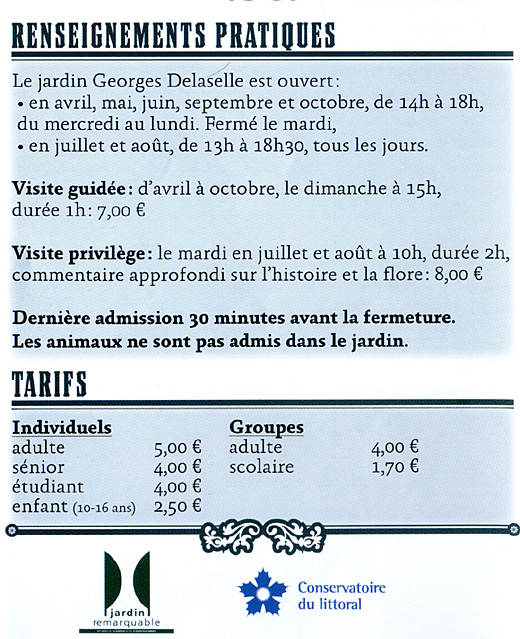











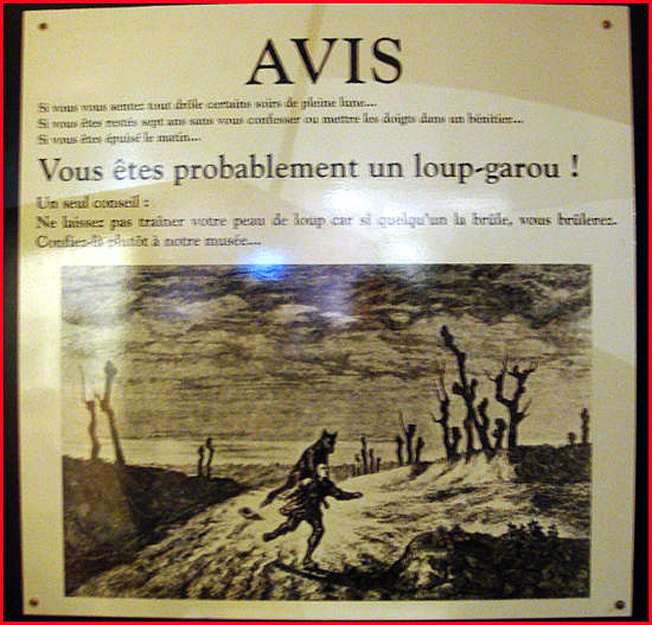
































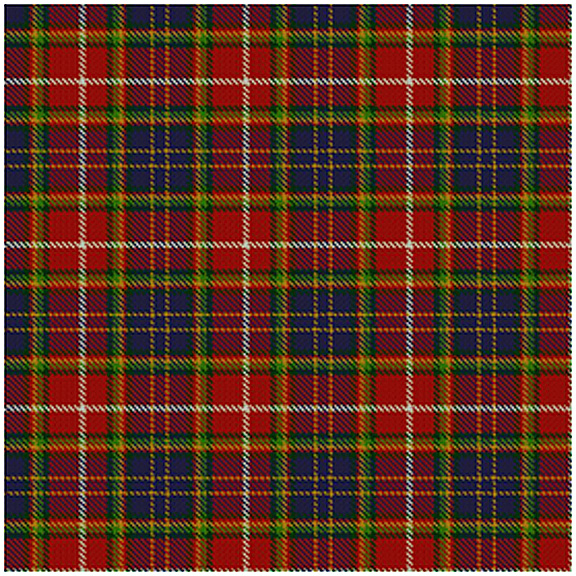





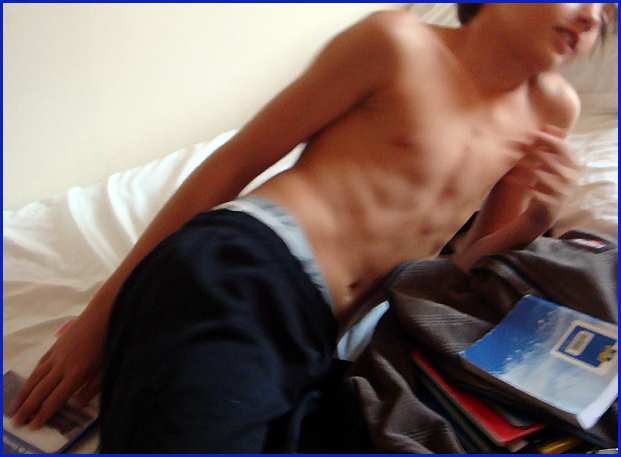




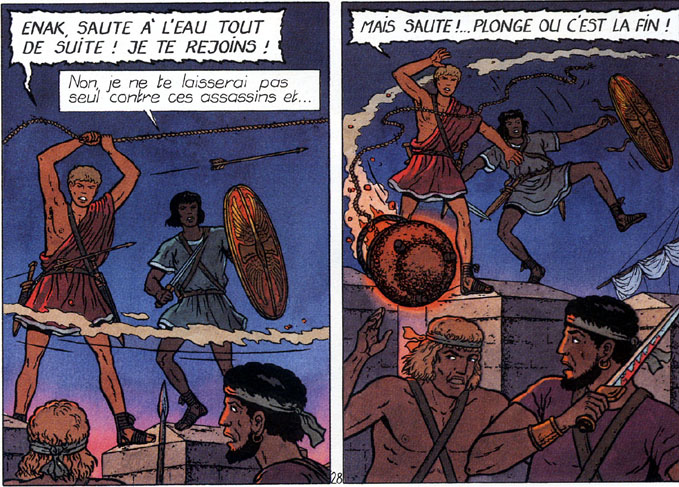

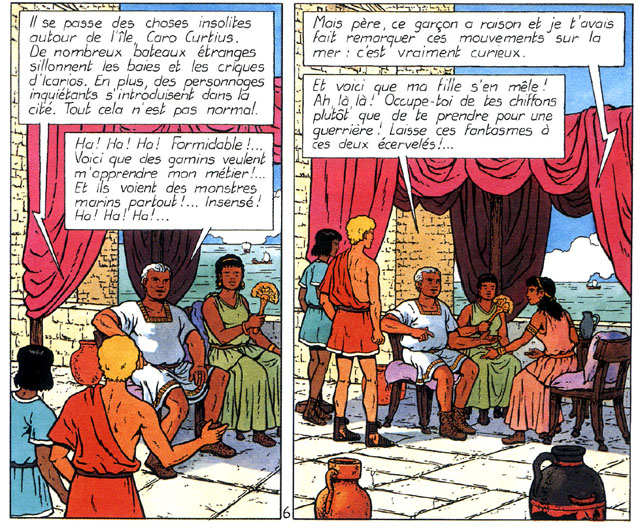


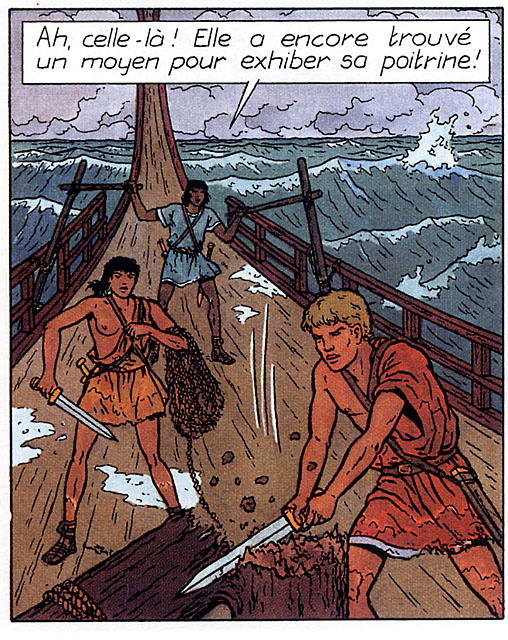
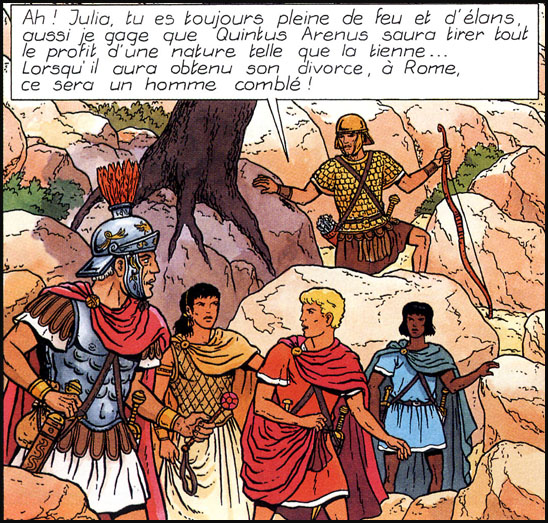

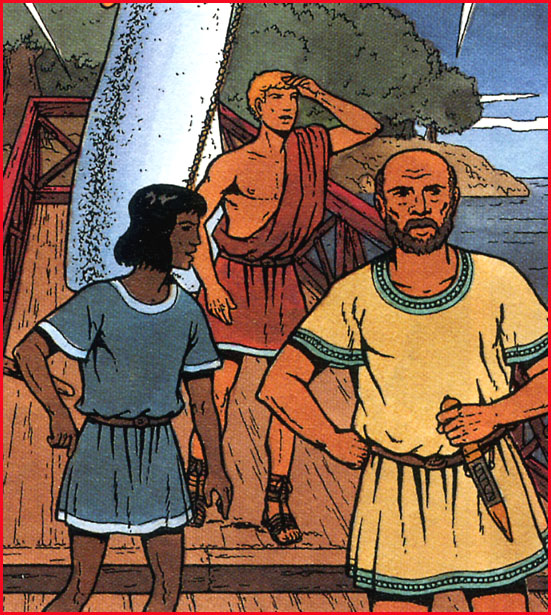
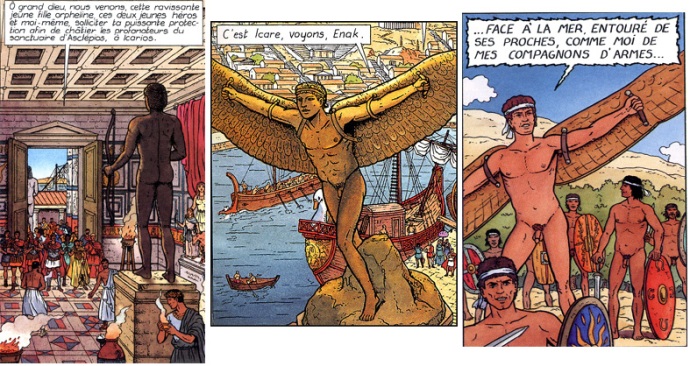







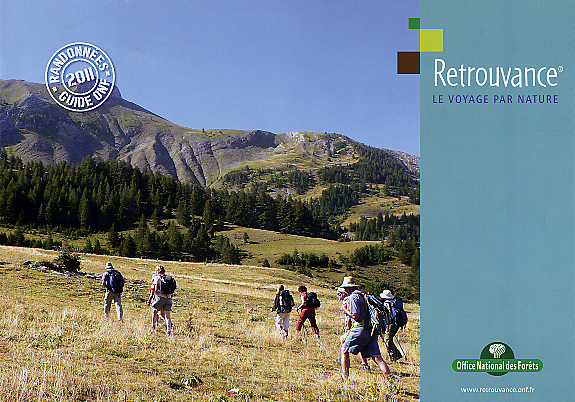




Commentaires récents