Etrange objet que ce DVD publié par StudioCanal avec un livret en français de Charlotte Courson et une couverture en français. Sauf qu’il est… entièrement en anglais – sans bande-son traduite ni même sous-titres (malgré ce qui est indiqué en couverture !) ou alors bien planqués par un technicien retord. Il fait partie de cette « collection » Tamasa classiques en langue originale qui réédite les comédies britishs des studios Ealing. L’accent un brin cockney et le parler rapide font que seuls les bilingues saisissent tout, mais les scènes sont suffisamment explicites pour que le locuteur moyen en anglais prenne plaisir au film.
Nous sommes en effet dans l’aventure. Un gamin de 15 ans, Joe (Harry Fowler – 21 ans au tournage), erre dans les ruines du Blitz en costume cravate tout en cherchant vaguement du travail. Une BD de The Trump lui tombe du ciel, confisquée par un pasteur dédaigneux qui dirige un chœur d’enfants. Hier comme aujourd’hui, The Trump est adepte des « vérités alternatives » : la fiction dessinée calque donc la réalité avec quelques modifications retorses.
Joe dévore avidement le feuilleton avec son gang de kids, The Blood and Thunder Boys (les garçons de tonnerre et de sang). Il entre dans l’histoire en reconnaissant dans la rue le numéro de plaque d’un camion – GZ 4216 – utilisé par des malfrats dans le dessin ! Il use alors d’un stratagème pour éloigner le boutiquier à qui l’on vient tout juste de livrer une grosse caisse – comme dans l’aventure – et fouille sa boutique. Il est pris et doit s’expliquer devant un policier qui, paternaliste, le renvoie jouer. Le fourreur qui a appelé la police a un accent français, autrement dit louche.
L’adolescent ne s’avoue pas vaincu et, s’il trouve du travail au marché de Covent Garden grâce au flic, il suit la suite de l’aventure dans The Trump. Comme il veut savoir, il réussit à découvrir l’adresse de l’auteur et va le voir, accompagné du petit Alec (Douglas Barr) – tout aussi costumé cravaté. Seul l’uniforme bourgeois donnait à l’époque l’air « comme il faut ». Immeuble cossu, silencieux, arabesques menaçantes des ombres, grilles de l’escalier, un mystérieux chat noir… Et une voix menaçante qui vient du haut en proférant des mots sadiques. Il n’en faut pas plus pour épaissir de peur le mystère. Mais Joe ne se laisse pas démonter – et monte en traînant son jeune compagnon par le col. L’auteur, un brin méfiant, les accueille lorsqu’il retrouve son chat (un siamois chassé par le chat noir) et leur sert une boisson. Frémissement lorsqu’il qu’il déclare, alors que le plus jeune prend un verre : « non, pas celui-là, c’est le mien ! » : les deux autres sont-ils empoisonnés ? Pas même. Comme la peur de l’escalier se dissipe dans le boudoir de l’auteur où trône un dictaphone, l’appréhension s’évapore lorsque le vieux déclare que son verre est avec du gin. Toutes les scènes sont jouées dans ce contraste permanent entre l’angoisse de la fiction qui enfièvre l’imagination et le bon gros réalisme de la vie courante.
Les « enfants » eux-mêmes (entre 12 et 18 ans) sont saisis par ce même réalisme social, inclus dans ce Londres aux quartiers détruits par les bombardements nazis dans lesquels ils jouent. Alec mime combats aériens, tacatac de mitrailleuse et explosions, assis sur les décombres. Poussière, gravats, bagarres, les costumes résistent mal à la fougue adolescente. Joe voit les accrocs se multiplier sur son pull, ses coudes de veste, sa chemise. La cravate même est ôtée dès le milieu du film et le second bouton de sa chemise, trop lâche, n’est pas toujours attaché. Tout le contraste, une fois encore, entre les apparences bourgeoises et la réalité adolescente, entre l’ancienne génération collet monté et la nouvelle au col ouvert, entre ceux qui se ferment sur leurs soucis et ceux qui s’ouvrent à la vraie vie.
Le film évolue sans cesse entre les pauvres et les puissants, les vertueux et les malfrats, la génération qui monte et celle qui descend, en bref David contre Goliath comme durant la guerre – mais cette fois à l’aide de la fiction dessinée. Un groupe de bandits détourne en effet le scénario de la BD pour communiquer leurs plans à leurs complices afin de livrer la marchandise, des fourrures volées. L’auteur, aventurier en chambre soucieux de son confort, se désole d’apprendre combien l’on dévie son scénario mais ne veut pas s’en mêler. Les parents ne pensent qu’aux fins de mois, les policiers qu’aux crimes sérieux, les taxis qu’aux clients cossus. Dur d’être un « enfant » (jusqu’à 21 ans) dans la société d’après-guerre.
Mais lorsque l’on n’a pas la force, comme le David biblique on use de la ruse. L’astuce déjoue les stratagèmes et le nombre véhicules et armes. Joe convainc l’auteur de créer un scénario qui envoie les malfrats à Ballard’s Wharf. Et c’est tout une armée de kids tels des rats surgis des décombres qui déferle pour la lutte finale sur les voleurs livreurs, rusés et mordants comme eux. D’où le titre du film : Hue and Cry, à cor et à cri.
Un duel se détache entre Joe et le malfrat en chef dans les ruines d’un immeuble. Mais Goliath est terrassé et la justice triomphe : celle de l’enthousiasme sur l’indifférence, celle de l’aventure sur le confort, celle de la vertu sur le laisser-faire. Le chœur final, qui boucle celui de l’ouverture, montre les gamins pochés, tuméfiés et bandés, rançon réaliste de l’aventure imaginaire. La jeunesse (british) est révolutionnaire, vingt ans avant 1968.
DVD Hue and Cry, Charles Crichton, 1947, avec Alastair Sim, Harry Fowler, Douglas Barr, Joan Dowling, Jack Warner, Valerie White, Jack Lambert, Ian Dawson, Gerald Fox, John Hudson, StudioCanal 2015, 1h23, €24.68

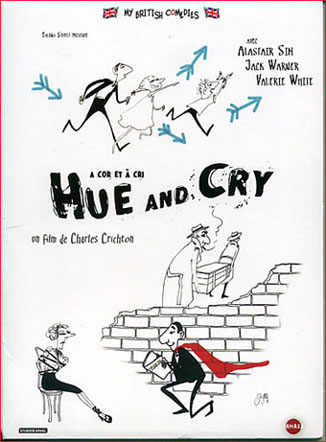








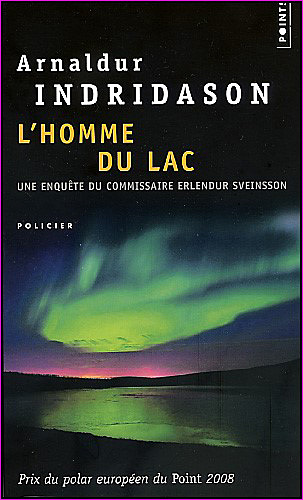



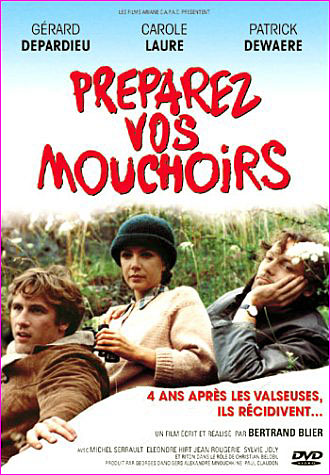






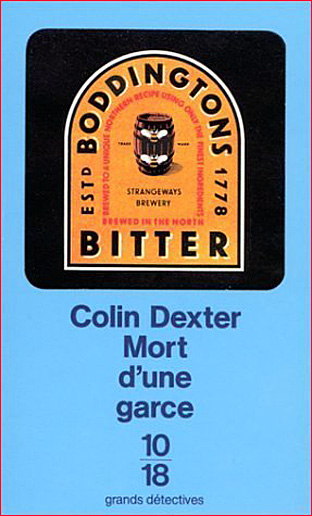










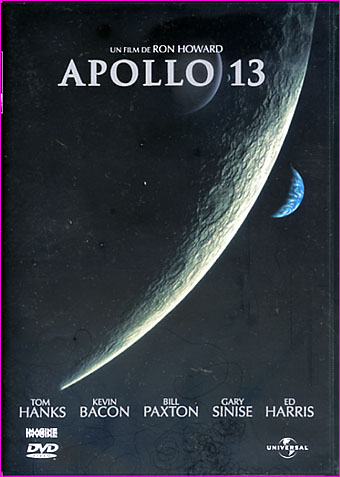



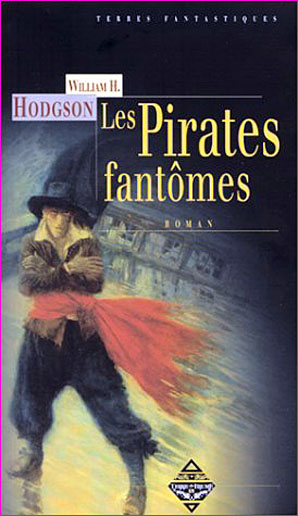
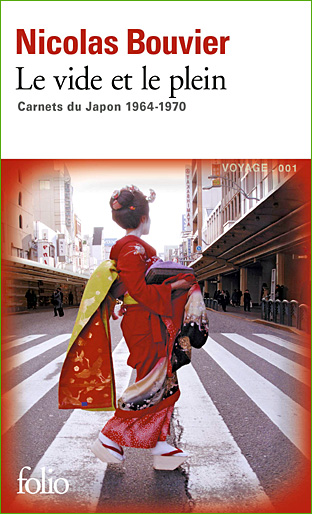


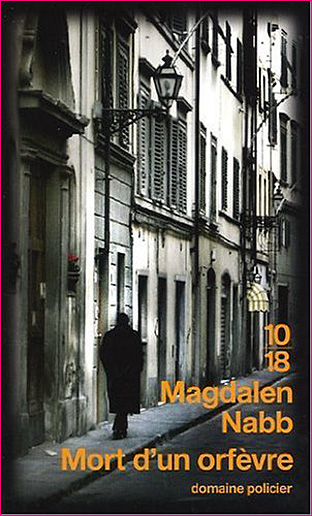
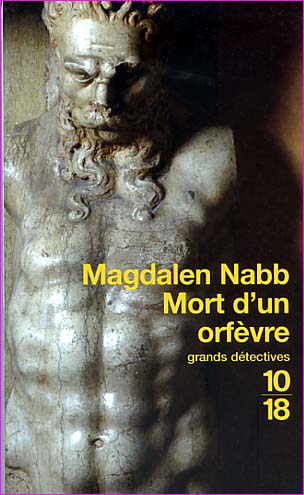




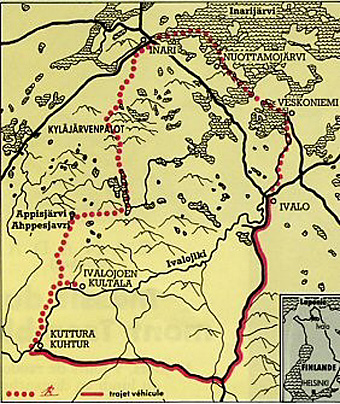































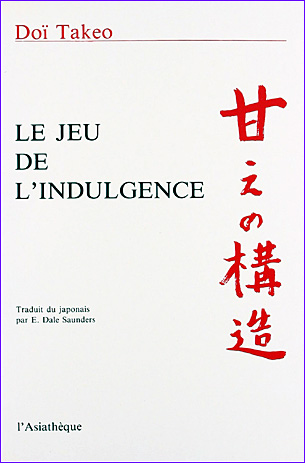















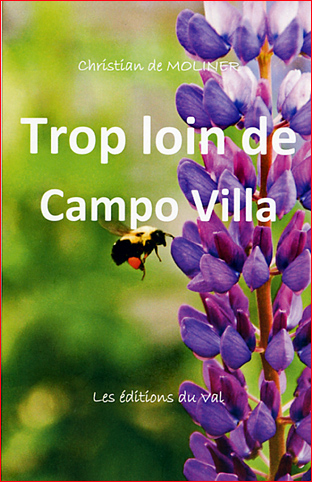

Commentaires récents